Dernier convoi
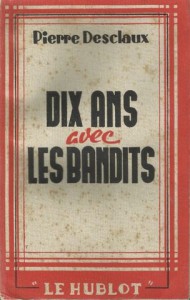 Le décret-loi d’Edouard Daladier du 17 juin 1938 est clair. Seule la transportation est abolie. Le 22 novembre de cette année, 610 relégués, parqués à Saint Martin de Ré, quittent la France. L’ambiance est électrique, l’Administration Pénitentiaire est sur les nerfs. L’évènement attire les familles des hommes punis mais aussi de nombreux journalistes venus de Paris ou encore des Etats Unis. Ils posent des questions, s’entretiennent avec des pères, des mères, des femmes de condamnés ; interrogent des surveillants. Ils cherchent à en savoir plus sur l’émeute qui a éclaté depuis le 19. Charles Péan, dans Conquêtes en terre de bagne, se souvient du départ de ce dernier convoi. Du fait de la guerre qui éclate peu de temps après, il n’y en aura plus d’autres. L’officier de l’Armée du Salut évoque une véritable « folie furieuse »[1] s’emparant des relégués détenus dans la citadelle de Vauban. On la retrouve encore dans le livre de Pierre Desclaux. Le journaliste, auteur en 1946 de Dix ans avec les bandits, travaille à l’époque pour Police Magazine et c’est peu dire que sa vision de l’évènement tranche particulièrement non seulement avec celle de Péan mais surtout avec celle de ses confrères dont il « déplore les exagérations » et qui, depuis les écrits de Londres, n’hésitent pas à critiquer vertement la vieille barbarie pénitentiaire. Loin de s’apitoyer, il considère finalement que ce ne sont alors que des criminels que l’on envoie expier loin de la métropole.
Le décret-loi d’Edouard Daladier du 17 juin 1938 est clair. Seule la transportation est abolie. Le 22 novembre de cette année, 610 relégués, parqués à Saint Martin de Ré, quittent la France. L’ambiance est électrique, l’Administration Pénitentiaire est sur les nerfs. L’évènement attire les familles des hommes punis mais aussi de nombreux journalistes venus de Paris ou encore des Etats Unis. Ils posent des questions, s’entretiennent avec des pères, des mères, des femmes de condamnés ; interrogent des surveillants. Ils cherchent à en savoir plus sur l’émeute qui a éclaté depuis le 19. Charles Péan, dans Conquêtes en terre de bagne, se souvient du départ de ce dernier convoi. Du fait de la guerre qui éclate peu de temps après, il n’y en aura plus d’autres. L’officier de l’Armée du Salut évoque une véritable « folie furieuse »[1] s’emparant des relégués détenus dans la citadelle de Vauban. On la retrouve encore dans le livre de Pierre Desclaux. Le journaliste, auteur en 1946 de Dix ans avec les bandits, travaille à l’époque pour Police Magazine et c’est peu dire que sa vision de l’évènement tranche particulièrement non seulement avec celle de Péan mais surtout avec celle de ses confrères dont il « déplore les exagérations » et qui, depuis les écrits de Londres, n’hésitent pas à critiquer vertement la vieille barbarie pénitentiaire. Loin de s’apitoyer, il considère finalement que ce ne sont alors que des criminels que l’on envoie expier loin de la métropole.
Pierre Desclaux
Dix ans avec les bandits
Editions du Hublot, Toulouse, 1946, p.41-61
Chapitre III : Un départ de relégués pour la Guyane
J’eus la curiosité de revenir à Saint-Martin-de-Ré. Depuis plusieurs années, l’administration pénitentiaire n’avait pas procédé à l’évacuation des relégués. Or, les tribunaux prononçaient régulièrement des peines de relégation, et les maisons centrales étaient remplies d’individus qui menaient grand tapage, affirmant très haut qu’on les détenait illégalement. Le relégué, en effet, doit être éloigné de la métropole, mais n’est pas un prisonnier ordinaire. Toutefois, l’administration pénitentiaire ne se tourmentait pas outre mesure de violer le règlement. Les relégués, comme je l’ai expliqué dans le précédent chapitre, sont des personnages ayant accumulé condamnations sur condamnations et ne peuvent plus être autorisés – ainsi le veut la loi – à résider sur notre territoire.
Le Parlement s’occupait alors d’une réforme du bagne. Et c’est la raison qui incitait l’administration à surseoir aux départs non seulement des relégués, mais aussi des condamnés aux travaux forcés.
A la veille de la guerre, le bagne de la Guyane était théoriquement supprimé, et on avait décidé de ne plus y envoyer personne. Je ne sais comment la nouvelle législation entend régler cette question des individus susceptibles d’être relégués. Il est probable que les règlements concernant cette catégorie de « condamnés » seront radicalement transformés, et que la peine de la relégation se confondra avec celle de l’emprisonnement dans des maisons centrales.
Soit dit en passant, je n’approuverai pas cette mesure. Dans l’esprit du législateur qui institua la relégation, il s’agissait d’établir une différence entre les forçats et les relégués. Les forçats, condamnés pour un très grave délit, devaient purger leur peine dans un pénitencier. Les relégués, au contraire, jouissaient d’une liberté relative. La loi estimait qu’ils étaient devenus de mauvais citoyens ayant lassé la mansuétude des magistrats et indignes de vivre parmi nous. Elle les croyait pourtant capables de se relever dans l’exil, et elle les envoyait à des milliers de kilomètres de la métropole.
L’esprit de la loi était jusqu’à un certain point excellent. Mais l’application se révélait épouvantable. Les relégués se classaient, en réalité, dans une catégorie spéciale de bagnards. Matériellement, ils ne pouvaient se relever, parce que l’organisation même de la colonie où ils étaient déportés ne le leur permettait pas.
Il eût fallu organiser des colonies de relégués dans d’autres pays lointains, en Afrique par exemple, dans des pays neufs. Mais il eût fallu aussi surveiller ces colonies, afin d’empêcher les êtres tarés les composant de continuer à mener une existence de pillages, d’exactions, de malhonnêtetés de toutes sortes.
La difficulté résidait uniquement là. On ne voulait pas avoir l’air de condamner ces tristes individus aux travaux forcés à perpétuité et, en somme, on le faisait. Car, pratiquement, un relégué ne revenait jamais sur le sol natal… sauf quand il s’évadait, ce qui était fréquent.
Le principe de la relégation consistait surtout à éloigner les citoyens indésirables ayant encouru un certain maximum de condamnations. Et il y avait une réelle hypocrisie à déclarer que les relégués n’étaient pas des forçats comme les autres, les grands héros de cours d’assises, les assassins, les voleurs de marque.
Je le répète, ils n’étaient pas astreints à résider dans les bagnes, et c’était tout. Mais leur sort ne devait pas faire envie, car on les livrait presque à eux-mêmes, dans un pays au climat malsain et où les habitants ne les voyaient pas d’un bon œil.
Je me souviens des doléances des directeurs de maisons centrales qui, envahis par les relégués, adressaient à Paris de continuelles protestations, Ils ne savaient plus où les enfermer. Les casernements devenaient trop petits. La discipline s’en ressentait et les émeutes se faisaient fréquentes à Riom, à Clairvaux, à Fontevrault et ailleurs. Aussi, en attendant que des décisions définitives fussent prises par le Parlement, décida-t-on de procéder d’urgence à un transfert.
Près de huit cents relégués furent donc rassemblés au pénitencier de Saint-Martin-de-Ré. Pour les garder, il fallut avoir recours à des effectifs exceptionnels de tirailleurs sénégalais qui furent casernés dans les locaux annexes du pénitencier.
A l’intérieur de celui-ci, les relégués étaient littéralement entassés dans les chambrées, les ateliers, où tout travail avait cessé.
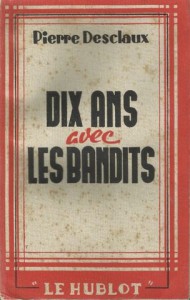 Le directeur, tout nouvellement nommé, ne savait que faire pour calmer ces huit cents hommes fort énervés. Fort énervés, parce que, pratiquement, la surveillance continuelle s’avérait presque impossible. Les hommes passaient la plus grande partie de la journée dans les cours où ils retrouvaient de vieilles connaissances, des amis et… des ennemis. Il y eut d’abord quelques altercations sans importance.
Le directeur, tout nouvellement nommé, ne savait que faire pour calmer ces huit cents hommes fort énervés. Fort énervés, parce que, pratiquement, la surveillance continuelle s’avérait presque impossible. Les hommes passaient la plus grande partie de la journée dans les cours où ils retrouvaient de vieilles connaissances, des amis et… des ennemis. Il y eut d’abord quelques altercations sans importance.
Mais bientôt la nervosité s’accrut. On sait que dans les maisons centrales certains prisonniers, les mieux notés ou les plus roublards, se voient confier des fonctions de prévôts. Le prévôt a des attributions mal définies, par les règlements. En théorie, le prévôt est un prisonnier qui mérite un peu plus d’indulgence en raison de sa bonne conduite. Or, fréquemment, le prévôt est un gaillard qui veut tirer au flanc, bénéficier de certains avantages et qui ne résiste pas à l’envie de moucharder ses camarades. Même quand il ne moucharde pas, il est soupçonné de le faire par les autres prisonniers. D’où jalousies, rivalités féroces.
Tant que la discipline de la maison centrale, très stricte maintenait ces fauves en repos, tout allait bien. Au pénitencier de Saint-Martin-de-Ré, il n’en était plus de même. Les prévôts ne constituaient plus l’armature d’un service d’ordre. L’anarchie commençait à s’installer. Le directeur sentit venir l’orage. Il s’efforça, par tous les moyens, d’amadouer ses terribles pensionnaires. S’inspirant d’idées nouvelles et assez américaines, il fit installer dans une cour un puissant haut-parleur qui lui permettait, de son bureau, d‘adresser la parole aux détenus. Seulement, on ne peut discourir à longueur de journée. Cela deviendrait, à la longue, plus que fastidieux.
Le directeur utilisa donc son haut-parleur pour faire entendre des disques aux relégués. Eh ! oui, des disques! Tino Rossi succédait à Maurice Chevalier. Puis venaient Marie Dubas, Mistinguett, Suzy Solidor, toutes les vedettes du music-hall. Les relégués reprenaient en chœur le refrain.
La population de Saint-Martin-de-Ré, composée principalement de pêcheurs, en était sidérée, car le haut-parleur s’entendait de fort loin. Cette musique s’échappant des murs élevés de la vieille citadelle donnait l’illusion que le pays fêtait quelque joyeux anniversaire. Le bagne en goguette !
Ces flonflons ne purent empêcher la tragédie. La haine animait cet agglomérat sinistre de réprouvés, d’exclus, de hors-la-loi. Les bagarres se multiplièrent et, soudain, elles se généralisèrent. La révolte explosa. Les relégués se divisèrent en plusieurs camps. Le personnel pénitentiaire se voyait réduit à l’impuissance et n’osait intervenir. Des batailles s’engagèrent entre détenus exclusivement. Des armes bien dissimulées dans les vêtements surgirent. Des lames s’abattirent sur les visages, sur les poitrines. Le sang coulait Ceux qui n’avaient pas de couteaux se servaient de pierres, de bouts de bois. La férocité se déchaînait. Il y eut des yeux arrachés, des oreilles coupées.
Les Sénégalais intervinrent et leur présence seule freina quelque peu la fureur de ces démons qui redoutèrent la fusillade et abandonnèrent les prévôts qu’ils voulaient tuer.
De La Rochelle, les secours arrivaient : gendarmes, gardes mobiles. En dépit des consignes sévères, des indiscrétions faisaient connaître à la population de Saint-Martin-de-Ré ce qui se passait. Il y eut alors, parmi cette population, plus que de l’inquiétude. On redoutait une extension de la révolte. Si la force armée ne parvenait pas à avoir le dessus, que se passerait-il ? Tout était à craindre.
La nature s’en mêla et, brusquement, toutes les forces mauvaises se déchaînèrent : le ciel se couvrit de nuages noirs; l’Océan lança à l’assaut des côtes, des murailles de la citadelle des vagues gigantesques; la tempête s’abattit sur l’île, rendant les communications avec La Rochelle et La Palice fort précaires; la pluie tomba, une pluie serrée qui inondait tout ; un vent d’enfer fouettait les maisons, arrachait les tuiles, poussait des débris de toutes sortes dans les petites rues, sur les quais.
Nous étions de peu nombreux journalistes venus de Paris et de Bordeaux. On essayait de paralyser notre action. On nous écartait dans la mesure du possible. Or, nous occupions les rares hôtels de Saint-Martin-de-Ré, en compagnie de magistrats de La Rochelle, de fonctionnaires du ministère de l’intérieur et du ministère des colonies, et aussi de surveillants du cadre colonial, ainsi que de policiers.
Curieux par profession, nous posions des questions auxquelles on ne voulait pas répondre ; et pourtant nous étions au courant de tout. Lorsque la tempête se calmait, nous entendions le haut-parleur du pénitencier qui diffusait toujours des airs joyeux.
Les trombes d’eau s’abattaient à nouveau et les plus courageux d’entre nous revenaient se mettre à l’abri. Il y avait une équipe de cinématographistes qui avaient bien l’intention de filmer le départ des relégués et qui préparaient des plans de campagne. Car l’ordre était formel : les prises de vues ne seraient tolérées à aucun titre, et pas davantage celles de photos. On parlait même de nous supprimer les coupe-file, ce qui provoquait nos protestations.
D’ailleurs, la date du départ demeurait incertaine. Le navire spécialement affecté au transport des forçats en Guyane, le La Martinière, ne pouvait rester au large, en raison du mauvais temps. Il venait de chercher asile dans l’avant-port de La Rochelle. Il fallait renoncer au transbordement prévu avec des remorqueurs du port. Jusqu’à la dernière minute, on nous cacha que le départ était ajourné.
La tempête sévissait de plus belle. Rarement, l’île avait subi un tel assaut de l’Océan. Les communications avec La Rochelle étaient définitivement coupées.
Cela permit aux journalistes d’interviewer, à longueur de journée, les fonctionnaires qui semblaient avoir été réunis pour leur accorder des audiences. Ces conversations, dans les hôtels et restaurants, ne manquaient pas de piquant. Nos « victimes » se tenaient sur leurs gardes, n’entendant pas se compromettre. Et il leur devenait de plus en plus difficile de nous échapper. Elles maudissaient le sort qui les livrait à nous sans défense.
Les magistrats, procureur de la République, substituts, commissaires spéciaux, s’enfermaient dans leur chambre, pour la plupart. Les autres se risquaient quelques minutes au dehors, mais les trombes d’eau les chassaient et ils revenaient à l’hôtel. Nous nous faisions bons apôtres et évitions d’aborder tout de suite le sujet qui seul nous intéressait Nous engagions des conversations d’une banalité charmante, et lorsque notre interlocuteur nous paraissait bien préparé à subir le supplice, nous n’hésitions plus à reprendre l’offensive.
La version officielle concernant la révolte affirmait que l’événement devait être considéré comme peu important : quelques mauvaises têtes avaient manifesté un peu bruyamment ; l’ordre régnait.
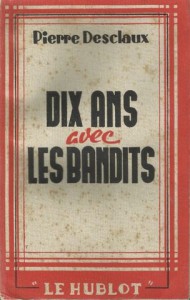 En réalité, la révolte couvait encore. Des relégués avaient même réussi à allumer des bûchers dans la cour, bûchers alimentés avec des meubles et des planches du casernement. On redoutait le pire. Les gendarmes et les gardes mobiles appelés en renfort ne quittaient plus le pénitencier. Et les surveillants de l’administration, consignés depuis quarante-huit heures, ne pouvaient aller prendre leurs repas en famille à Saint-Martin-de-Ré. Deux d’entre eux seulement avaient pu obtenir une ou deux heures de permission à cause de la maladie d’un des leurs.
En réalité, la révolte couvait encore. Des relégués avaient même réussi à allumer des bûchers dans la cour, bûchers alimentés avec des meubles et des planches du casernement. On redoutait le pire. Les gendarmes et les gardes mobiles appelés en renfort ne quittaient plus le pénitencier. Et les surveillants de l’administration, consignés depuis quarante-huit heures, ne pouvaient aller prendre leurs repas en famille à Saint-Martin-de-Ré. Deux d’entre eux seulement avaient pu obtenir une ou deux heures de permission à cause de la maladie d’un des leurs.
Je savais de très bonne source que les relégués voyaient d’un mauvais œil l’ajournement du départ. Des meneurs leur racontaient que ce départ n’aurait jamais lieu, qu’on les maintiendrait longtemps au bagne de Saint-Martin, et que, peut-être, on les réintégrerait dans les maisons centrales. On comprend l’énervement de ces hommes qui n’avaient même plus la ressource de se promener dans la cour à cause du déluge, presque ininterrompu, s’abattant sur l’ile.
L’administration pénitentiaire avait fort à faire, et chacun en secret souhaitait un adoucissement de la température, un retour au calme.
Toute une matinée et toute une après-midi il plut. Le vent continuait à se mettre de la partie. Des pêcheurs déclaraient pessimistes :
– Ça peut durer une semaine !
Vers la fin de la journée il y eut une légère accalmie. On envisagea que le départ pourrait avoir lieu le lendemain matin. Les cinématographistes s’agitaient. On devinait qu’ils échafaudaient quelque magnifique combinaison qui leur permettrait d’enfreindre les ordonnances préfectorales et de braquer les caméras sur le convoi de relégués.
Nous apprîmes plus tard qu’ils avaient loué une maison inhabitée se trouvant au bord d’un bassin d’embarquement et que, profitant de la tempête, ils l’avaient aménagée fort ingénieusement. L’on truqua notamment les persiennes, afin de réserver de petites ouvertures pour les objectifs. Les opérateurs de cinéma ont toujours été des gens fort débrouillards. Les photographes d’agences, eux, avaient compris qu’il leur serait impossible de travailler, car le commissaire spécial dirigeant le service d’ordre les avait prévenus que les appareils seraient impitoyablement confisqués au moment du retour à La Rochelle.
Je n’eus pas à me plaindre de ce séjour forcé dans l’Ile. J’avais remarqué que de nombreux, parents de relégués étaient venus à Saint-Martin afin d’assister au départ. J’employais une grande partie de mon temps à m’entretenir avec ces pauvres gens, dont le chagrin était manifeste.
La maman d’un des détenus habitait le même hôtel que moi. Pendant plusieurs jours elle avait tenté en vain de voir son fils; et je ne sais trop pour quelle raison elle n’y parvenait pas. Un homme de grand cœur, le major Péan, de l’Armée du Salut, la rencontra et comprit à son attitude honteuse qu’elle rougissait de faire une démarche auprès de l’administration pénitentiaire. Il l’aborda carrément et lui arracha son secret. Il s’entremit aussitôt et la pauvre femme put, enfin, communiquer avec son « petit » au parloir, derrière un grillage.
Ces entrevues de la dernière heure avaient quelque chose de poignant. Elles ne pouvaient durer plus de cinq minutes, je ne sais pour quelle raison stupide. Des surveillants y assistaient. Seuls des parents étaient admis dans le si lugubre parloir, que j’ai visité, et qui ressemble plutôt à une sorte de bâtiment pour l’élevage des lapins.
Le major Péan, qui savait se dévouer de toute son âme, était autorisé à voir les relégués. En même temps que lui, le curé de Saint-Martin, M. l’abbé Jean P… se dépensait auprès de ses provisoires et lamentables administrés. Ils prodiguaient tous deux des encouragements, et avaient fort à faire.
– C’est affreux, me déclarait le soir même ce sympathique ecclésiastique, de constater la détresse morale des relégués. Beaucoup ont demandé à me parler, non pas pour se confesser ou faire acte de croyants, mais pour avoir le réconfort d’une parole amie. Je ne m’y laisse pas prendre. Et, d’ailleurs, mon rôle n’est pas de me livrer à une propagande quelconque. Mon devoir consiste à soulager ces pauvres êtres et à leur faire l’aumône d’un peu de compassion. Une poignée de main suffit parfois à calmer un être humain au comble de l’irritation.
M. le curé Jean P… était merveilleux de compassion, de bonté.
Je ne savais comment engager conversation avec la maman dont j’ai parlé plus haut. Je la rencontrai dans un couloir de l’hôtel assez obscur et elle me heurta. Cette femme, d’une soixantaine d’année ; qui cherchait à passer inaperçue, semblait toujours prête à pleurer. Elle s’excusa humblement de m’avoir bousculé. Je lui mis la main sur l’épaule et lui dis :
– Pauvre maman, comme je vous plains ! Quel calvaire vous gravissez ! C’est beau d’être venue…
– Ah! merci, monsieur ! Merci de me dire cela ! fit-elle dans un souffle. Je suis bien malheureuse, en effet Mais j’ai voulu être là pour lui donner un dernier espoir…
– Et lui ? ma pauvre dame, lui ?
– Oh! il est très courageux, vous savez ! Beaucoup plus que moi. Il voit la vie en rose. Il déclare qu’il va recommencer une nouvelle existence en Amérique et que, peut-être, plus tard, il reviendra très riche. Il est fou. Je lui ai recommandé d’être prudent, de ne pas se laisser influencer par les mauvais camarades. Ce n’est pas un méchant petit. Mais il a été toujours trop faible, et c’est ce qui l’a perdu. D’abord, les mauvaises fréquentations; ensuite une marotte de vouloir dépenser beaucoup d’argent pour être comme les riches.
Je ne pus prolonger davantage l’entretien, je n’en eus pas le courage, car l’infortunée pleurait et je ne voulus pas continuer à la supplicier par ma curiosité.
Combien différentes les deux femmes que je vis ensuite !
Celles-là arrivaient de Paris. C’étaient des habituées du boulevard de La Chapelle et chacune avait son homme dans le convoi.
– J’y ai promis que je serais là, me déclara l’une d’elles, et sûr qu’il cherchera à me voir. C’est vrai, qu’il n’y aura pas moyen d’approcher, dites, monsieur ? Même en payant très cher ?
La deuxième femme haussa les épaules et dit :
– T’es bête ! Tu oublies donc qu’on va avoir une fenêtre sur le parcours ? Seulement il faudra se contenter de regarder par un trou des volets, puisque la police a ordonné que tout soit bouclé au passage des gars qui s’en vont.
Elles venaient là comme au spectacle. J’essayai de les faire parler sur les relégués auxquels elles s’intéressaient.
– Ben quoi ! fit l’une, c’est deux pauvres bougres qu’ont pas de chance, car y en a qui passent au travers et qui en ont fait beaucoup plus qu’eux… S’il fallait vider le Barbés, le Rochechouart de tous ceux qui ont déplu à la police, y en aurait du monde, ici !
– Tout n’est peut-être pas perdu pour eux, déclarai-je. Vous êtes jeune.
– Vous voulez dire qu’on les reverra ? Bien sûr ! Faudrait pas être intelligent pour croire le contraire. Ils imiteront les copains qui sont pas plus bêtes qu’eux. Et ce sera la « belle ». Parfaitement ! Même qu’ils nous paieront le voyage et qu’on ira les rejoindre dès qu’ils auront faussé compagnie à tous les salopards. Mais, dites donc, de quoi ont-ils peur, ici, qu’ils ont accumulé tant de flics ? Faut croire que les gars du pénitencier en ont fichu un sacré coup ! Ils sont courageux, hein ! C’est ça qui vous ravigote !
Leur éloquence se tarit brusquement parce qu’un brigadier de gendarmerie, qui avait entendu quelques éclats de voix, s’était approché de nous. Elles eurent peur et préférèrent s’en aller.
Après elles, je recueillis les doléances d’un vieil homme à mise correcte qui me donna l’impression d’être un retraité.
– Cet enfant, Monsieur, je l’ai élevé du mieux que j’ai pu. Il a eu toujours des goûts de grandeur. Je me demande pourquoi, puisque nous avions tout ce qu’il fallait à la maison. Le petit ne manquait de rien. A treize ans, il parlait de gagner des millions et il n’avait pas envie de travailler. J’ai essayé de lui faire apprendre un métier. Il savait, lui, qu’on pouvait amasser des billets de banque sans se fatiguer, en ne menant pas une existence honnête. Je n’y comprends rien.
« Notez que ce n’est pas un mauvais fils. Il s’est bien aperçu que sa conduite irrégulière nous chagrinait tous deux. Ma femme en est morte de désespoir de voir notre enfant passer en correctionnelle si souvent. Mais elle lui a pardonné. Alors, comment ne lui pardonnerais-je pas moi-même ?
« C’est dur, Monsieur, pour un père. Je suis venu. Il me semble que ce petit finira un jour par se rendre compte de la bonne route à suivre. Au parloir, hier, je n’ai pas voulu l’ennuyer avec des remontrances. Et lui, si vous l’aviez vu ! Quelle assurance ! Il riait et il me répétait : « Ne t’en fais pas ! Il n’y a que le voyage qui est long et pénible. Après, ce n’est pas grand’ chose à supporter. Je t’écrirai. Je trouverai bien moyen de me débrouiller. » Se débrouiller ! Voilà son habituel refrain. Voyez-vous, Monsieur, il me semble qu’à partir du moment où le petit aura quitté la France, je n’aurai plus, moi, aucune raison de vivre et que je vais mourir… »
Celui-là aussi avaient envie de pleurer. Mais il parvint à se maîtriser et il me tourna soudain le dos. Je n’eus pas la cruauté de le retenir.
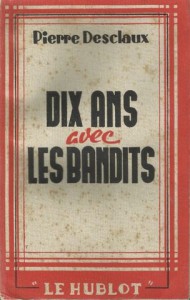 Toutes les conversations que j’eus avec d’autres parents ou amis de détenus ressemblaient à celles que je viens de relater. Toutes aussi navrantes. Je me rappelais cette réflexion d’un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur : « La plupart des relégués appartiennent à la petite bourgeoisie. II y a très peu d’ouvriers dans le convoi. Vous seriez effaré si vous lisiez les dossiers de ces individus. Ils ont voulu, pour la plupart, gagner de l’argent à tout prix, par n’importe quels moyens. »
Toutes les conversations que j’eus avec d’autres parents ou amis de détenus ressemblaient à celles que je viens de relater. Toutes aussi navrantes. Je me rappelais cette réflexion d’un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur : « La plupart des relégués appartiennent à la petite bourgeoisie. II y a très peu d’ouvriers dans le convoi. Vous seriez effaré si vous lisiez les dossiers de ces individus. Ils ont voulu, pour la plupart, gagner de l’argent à tout prix, par n’importe quels moyens. »
Le soir, à la veillée, je fus pris à partie par un chef-surveillant appartenant au cadre colonial, un de ces fameux gardes-chiourme que la pègre exècre.
– Eh bien, me demanda-t-il, vous apprêtez-vous à chanter dans votre journal les éloges de tous les fripouillards qui s’embarqueront demain avec nous ?
– Vous exagérez ! répondis-je. Il n’y a pas de raison pour que je chante les louanges des relégués.
– Alors, vous serez une exception dans la presse.
– Quelle aigreur contre les journalistes ! protestai-je, et aussi quelle injustice !
– Il n’y en a que pour « ces messieurs » ! reprit-il. Jamais un mot pour nous autres, les surveillants. Nous faisons cependant un fichu métier et la société devrait nous remercier du mal que nous nous donnons. Car, si nous n’existions pas, qui donc garderait tous ces gredins ? Je vous assure qu’il y a du mérite à exercer notre métier. Je n’ai pas la crainte d’être ridicule en vous affirmant que je considère notre profession comme une de celles qui nécessitent une véritable vocation.
« Nous risquons tout, nous autres, et les bandits que nous gardons ont les yeux toujours fixés sur nous. Ils épient nos faiblesses. Malheur à nous si nous flanchons ! Je regrette que vous ne puissiez venir en Guyane afin de voir ce qui s’y passe. Certains de vos confrères, après un trop court séjour là-bas, ont consacré au bagne des récits complètement faux. On dirait qu’ils n’ont songé qu’à faire l’apologie de la racaille que nous avons pour mission de surveiller.
« Lamentations continuelles des bagnards ! Mais, au fait, pourquoi ne pas les réintégrer purement et simplement dans la vie civile, puisqu’ils sont si intéressants ? Et leurs victimes ? On n’en parle jamais. Elles existent, cependant. Il y a des enfants qui pleurent leur père lâchement assassiné. Il y a des familles qui ont été massacrées par des scélérats. Et ces relégués, qu’on a tendance à considérer comme des petits agneaux, n’ont-ils pas causé la ruine de braves gens en les escroquant sans vergogne ?
– Vous broyez du noir ! dis-je en souriant. Je suis entièrement d’accord avec vous. Et je déplore, tout le premier, les exagérations de certains confrères qui ont le défaut de s’attaquer sans répit aux services de répression du banditisme, ce qui est assez paradoxal.
– Cela me cause du plaisir de vous entendre vous exprimer de la sorte. Mais ne supposez pas que je suis ce soir en proie à une crise de cafard parce qu’à la veille du départ, et parce que le temps est affreux. Non ! Le hasard nous réunit dans cette salle d’hôtel, et c’est la première fois que je m’exprime de la sorte avec un journaliste. Vous m’excuserez de ma franchise. Il y a une légende qu’il faudrait combattre : celle du méchant garde-chiourme qui s’acharne sur le bon forçat !
« Bon forçat ! Ainsi on fera confiance à l’être dévoyé qui a été rejeté de la métropole par la justice pour son indignité foncière et on taxera de tous les vices celui qui a la consigne d’empêcher le bon forçat de reprendre le cours de ses exploits ! C’est trop grotesque !
« Nous courons des périls réels et nombreux. Chaque fois que l’un d’entre nous tombe dans l’exercice de ses fonctions, on ne lit même pas l’annonce de sa mort dans les journaux. En revanche, dès qu’un crapulard de l’armée du crime réussit une évasion mouvementée, on lui consacre un article où on n’est pas éloigné de le dépeindre comme un héros. J’ai toujours souhaité que quelqu’un dans la presse ait le courage de répéter simplement les paroles que je viens de prononcer.
– Je n’aurai pas grand mérite à vous donner satisfaction, répliquai-je, car j’ai les mêmes opinions que vous sur la question, je déplore seulement que, dans votre corporation, quelques individualités, fort rares je veux bien en convenir, se laissent aller à l’habitude, vite contractée, d’exercer une autorité par trop brutale, par trop exclusive…
Mon interlocuteur s’emporta ;
– Ah! je voudrais vous y voir ! Ces gredins, qui ont l’œil fixé sur nous, ne laissent échapper aucune occasion de nous nuire. Nous sommes des ennemis dangereux et il s’agit de nous abattre. Personnellement, j’ai toujours recommandé à mes subordonnés de ne jamais recourir à la force pour obtenir l’obéissance. Je suis fier même d’avoir imposé mon autorité par la dignité de mon attitude. Les gaillards à qui nous avons affaire, ne sont pas des employés de commerce qui se dirigent normalement et qui ont le respect du patron.
« Ils ont la haine du chef, eux, quel qu’il soit, voilà la vérité. Si nous plions, c’est eux qui l’emportent. Nous ne gardons pas des jeunes filles, mais des, bandits. »
Nous devisâmes longuement sur ces questions délicates, et il était assez tard lorsque nous regagnâmes nos chambres qui étaient voisines. Nous nous séparâmes bons amis, sur une poignée de main.
Nous dormîmes peu, cette nuit-Jà. A la première heure, tous les pensionnaires de l’hôtel étaient debout. Il s’agissait de ne pas manquer le départ. On ne savait encore s’il aurait lieu. Le ciel était plein de nuages. Le vent continuait à souffler. Des vagues formidables déferlaient sur les quais. Le La Martinière ne se tenait pas au large. Le service d’ordre commençait à prendre position, à barrer les rues conduisant au port. Nous n’avions toujours pas reçu de coupe-file. La gendarmerie nous renvoyait à la Sûreté Générale, et celle-ci nous demandait de patienter quelque peu.
Enfin, un commissaire spécial, qui tenait quartier général dans la salle d’attente de l’autocar, se décida à nous délivrer le bout de papier qui nous donnait l’autorisation de circuler à l’intérieur des barrages. A partir de cet instant, la plupart des journalistes disparurent. N’avait-on pas raconté que le départ vraiment intéressant aurait lieu à La Rochelle où, on s’en souvient, le La Martinière était amarré depuis la veille. Presque tous mes confrères cherchaient un moyen de rentrer rapidement à La Rochelle. Mais nous restâmes quelques-uns à Saint-Martin-de-Ré, bien décidés à ne pas abandonner la partie. Car, somme toute, les relégués ne pouvaient quitter le pénitencier sans se rendre au port ; et le premier spectacle le plus intéressant serait à Saint-Martin.
Je demandai un entretien au directeur du pénitencier, au nom des journalistes présents, il me l’accorda aussitôt, je lui fis observer que, lors des précédents départs, la presse avait été admise dans une cour du pénitencier. Il commença par refuser de faire droit à ma requête, puis se laissa convaincre. Mais il nous supplia de ne pas nous servir d’appareils photographiques, ajoutant que si nous passions outre nous serions immédiatement expulsés du pénitencier et de l’île.
Le directeur avait surtout peur des photographes. Le ministre de l’Intérieur venait encore de prescrire à nouveau par téléphone, l’ordre formel de ne laisser photographier le convoi à aucun prix.
J’engageai le directeur à nous passer en revue. Aucun d’entre nous n’était porteur d’appareil photographique. Le fonctionnaire, sous l’empire des émotions vécues depuis quatre jours, nous regardait d’un air inquiet, se demandant si sa gentillesse à notre égard ne lui coûterait pas cher.
Il se décida, enfin, à nous conduire sous une sorte de préau couvert d’où nous serions bien placés pour assister à la formation du convoi.
Plusieurs soldats sénégalais, qui gardaient l’endroit, voulurent d’abord nous faire un mauvais parti. Et il ne fallut pas moins que l’intervention d’un haut fonctionnaire de la police pour qu’on nous laissât en paix. Les relégués sortaient par groupes des casernements. Ils savaient qu’à la moindre alerte les soldats tireraient impitoyablement sur eux. Ne venait-on pas de faire charger les armes, quelques minutes auparavant, à grand renfort de commandements sonores !
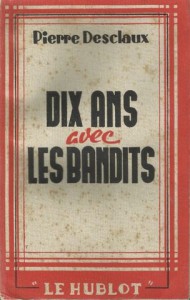 Le curé de Saint-Martin-de-Ré, M. l’abbé Jean P…, M. le major Péan, un pasteur et un rabbin étaient autorisés à parcourir les rangs des relégués, alignés dans un ordre presque parfait, ils distribuaient des encouragements… et aussi des cigarettes. Tous ces hommes avaient exceptionnellement la permission de fumer et ils en profitaient.
Le curé de Saint-Martin-de-Ré, M. l’abbé Jean P…, M. le major Péan, un pasteur et un rabbin étaient autorisés à parcourir les rangs des relégués, alignés dans un ordre presque parfait, ils distribuaient des encouragements… et aussi des cigarettes. Tous ces hommes avaient exceptionnellement la permission de fumer et ils en profitaient.
Auparavant, le curé avait donné sa bénédiction au convoi. Quelques relégués s’inclinèrent, émus sans aucun doute, car pour qui auraient-ils joué la comédie ? Aucun ne s’agenouilla. La cour n’était qu’un cloaque où pataugeaient relégués, soldats, fonctionnaires, surveillants.
J’examinais les relégués, qui se tenaient immobiles et résignés, non loin de moi, formés en colonne par quatre. A leurs pieds, le sac de toile contenant tout ce qu’ils possédaient désormais : le barda. Ils soutenaient le regard, intrigués par ces civils dont ils ne connaissaient pas la qualité. Figures hâves aux traits tirés pour la plupart. Trimballés depuis des Jours à travers toute la France, de centrale en centrale, dans des voitures cellulaires automobiles, ils subissaient le contre-coup de leurs fatigues. Epuisés par surcroît à la suite de la révolte où leurs nerfs avaient « donné ».
– Comme ils paraissent dociles, aujourd’hui, dis-je à un surveillant qui se tenait près de moi.
– Ne vous y fiez pas, me répondit-il. Ce matin, au réveil, on se demandait si ça n’allait pas recommencer. Avez-vous observé des hyènes dans les ménageries ? Tout à fait des hyènes. Ces sales bêtes ont peur quand on leur fait face, mais si vous tournez le dos, elles vous attaquent. En ce moment, il n’y a pas de danger qu’il y ait des rouspéteurs. Ils savent que les fusils des soldats sont chargés et se figurent que nous serions ravis qu’on descende quelques-uns des leurs. Oui, de sales bêtes ! Voyez leurs g… !
Des gueules, en effet. Des gueules sales, avec des barbes de plusieurs jours et presque toutes balafrées, pleines de sang coagulé. Des yeux pochés, des nez écrasés, des oreilles déchirées. Comment l’autorité avait-elle eu l’idée saugrenue de chercher à cacher cette révolte ? Les combattants portaient encore les traces de la lutte. Une cour des miracles ! Des éclopés en quantité qui flanchaient sur les jambes, éprouvant de la peine à se tenir debout.
De mauvaises lueurs incendiaient les yeux lorsque les gardes-chiourme passaient le long de la colonne.
Un commandement de l’officier de gendarmerie à quatre galons qui dirigeait le service d’ordre : on partait pour de bon cette fois. Les. Sénégalais, fusil sur l’épaule, se mirent en route. Les sacs juchés sur le dos, les hommes s’ébranlèrent. Le troupeau de réprouvés avançait, raclant le sol des semelles.
Tous défilèrent devant nous, tantôt hargneux, tantôt crâneurs, nous dévisageant avec une audace qui se nuançait souvent de provocation. De belles figures de gouapes, décidément ! Le surveillant avait raison : l’habit fait le moine et la tenue uniforme fait le relégué.
Lorsque les huit cents déportés eurent défilé, je me mis en devoir de remonter la colonne qui s’engageait dans la fameuse « allée des Tamaris », appelée « l’allée des Veuves ». Partout des soldats, des gendarmes. Nul curieux.
Plus besoin de crâner, puisqu’il n’y avait personne qui les regardait. Ils marchaient lourdement, fatigués par le poids du sac. J’en interpellai quelques-uns. Les plus âgés atteignaient à peine la quarantaine. Ils répondaient par des exclamations qu’ils essayaient de rendre joyeuses. Mais ça sonnait faux.
– Ben oui, on y va ! C’est pas trop tôt. On en a marre !
– Vivement la Guyane ! Les troupes sont fraîches !
– Mieux vaut tard que jamais !
Et j’en passe.
Sur une charrette que traînait un cheval, quelques éclopés sérieux semblaient soucieux. Se demandaient-ils de quoi l’avenir serait fait, puisque le présent débutait si mal ?
Le funambulesque cortège déboucha sur le port. Au lointain, maintenue par un barrage, la foule silencieuse, comme consternée, et qui s’efforçait de voir malgré la distance qui la séparait de nous.
Les remorqueurs étant à quai, les relégués embarquèrent par groupes. On les répartissait par bateaux. Ils prenaient place sur le pont, tassés les uns contre les autres. Certains s’effondraient, s’affalaient, harassés, ne bougeant plus. Ceux-là détournaient la tête, ou la baissaient presque à la hauteur des genoux. Des loques.
Les crâneurs s’enhardissaient, parlaient à haute voix. Un grand garçon, qui n’atteignait pas la trentaine, hissé sur des caisses, dominant ses camarades, pérorait avec effronterie, au point qu’il se fit sèchement rappeler à l’ordre par un surveillant.
Soudain, il y eut des rires. De l’autre côté du bassin où avait lieu l’embarquement, une agitation insolite se produisait. Quelques curieux se tenaient là, mais aussi un gendarme muni d’une longue perche surmontée d’un petit carré de bois. Et ce gendarme promenait ce carré alternativement sur chaque croisée d’une maison aux persiennes closes. C’était la maison dont j’ai parlé et que les opérateurs de cinéma avaient louée.
Le représentant de la maréchaussée cherchait à gêner les prises de vues qui s’effectuaient de l’intérieur de la demeure grâce aux trous pratiqués dans les persiennes. Il courait d’une fenêtre à l’autre, les bras levés, en une posture comique.
Les relégués furent vite au courant. Sachant qu’une caméra fonctionnait, ils prenaient des poses avantageuses, se campaient, agitaient les bras. Le préfet, le commandant de gendarmerie échangeaient des paroles énervées.
– Qui a donné cet ordre ? C’est ridicule.
– Pas moi. C’est grotesque.
– Ce gendarme n’a pourtant pas agi de sa propre autorité.
– Il faut croire que si. En tout cas, qu’on envoie quelqu’un au plus vite pour que cesse ce manège stupide !
Il fallait faire le tour des bassins… à pied, car personne ne disposait de la moindre bicyclette. Pendant ce temps, Pandore poursuivait ses gesticulations effrénées. Et les relégués de ricaner, et de vociférer.
– Mets-y-en, Totor !
– Prends une échelle !
Non loin de là, un opérateur s’était installé dans une cuve retournée, et dont nul n’aurait songé à se méfier. Son objectif, qui sortait par la bonde, ne fut aperçu de personne.
Les opérateurs eurent du mal, d’ailleurs, à ramener les bobines enregistrées à La Rochelle. Ils durent mobiliser des barques de pêcheurs qui échappèrent à la surveillance draconienne que le ministère de l’Intérieur avait organisée.
Toutes ces ruses ne servirent à rien. Le ministère de l’Intérieur fit saisir les films à Paris, et particulièrement ceux qui avaient été enregistrés pour le compte d’une firme américaine. J’ai eu l’occasion, à l’époque, de blâmer cette mesure gouvernementale que je trouve inepte. Que voulait-on donc empêcher ? Craignait-on l’immoralité de ce film, son influence néfaste sur la jeunesse, sur la population ? J’avoue ne pas comprendre. Je vous assure que le spectacle de cet embarquement, s’il avait été filmé dans le moindre détail, n’aurait pas été de nature à pervertir la jeunesse. Au contraire !
Rien de plus écœurant que ce défilé de figures sinistres, tailladées par les coups de couteaux ! Rien de plus écœurant que ces nez écrasés, ces plaies mal fermées, ces hommes qui boitaient ! Quel exemple ! Cherchait-on à détruire des preuves visibles de la révolte, à nier ensuite l’existence de cette dernière ?
N’en ont-ils pas fréquemment, en Amérique, des révoltes dans les pénitenciers ? Que de films yankees nous ont fait assister à ces tragiques soulèvements qui se terminent toujours par la mort de quelques forçats et souvent aussi de gardiens !
Ils n’avaient pas l’air de héros, les relégués de Saint-Martin-de-Ré ; et je prétends qu’en les montrant sur tous les écrans de France, avec un commentaire approprié, on aurait prouvé aux jeunes que, tout compte fait, le crime ne paie pas ! Mais allez discuter de ces choses avec une bureaucratie mesquine, tatillonne, aux idées vieillottes !
Maintenant que les remorqueurs avaient reçu leur lamentable cargaison, les responsables du convoi passaient une inspection générale, avant de donner le signal du départ.
Nous en profitâmes, nous aussi, pour poser aux relégués quelques questions,
– Alors, le moral est meilleur qu’hier ?
– Pas bien fameux tout de même ! On a un peu le cafard.
Je choisissais mes hommes au petit bonheur, cherchant un visage plus sympathique que les autres, un regard moins éteint. Parfois, je m’arrêtais devant un être à face lugubre qui, je ne savais pourquoi, me souriait amicalement» Je lui donnais des cigarettes.
– Merci. Mais ça ne va pas durer, la permission de fumer, quand ils nous auront bouclés sur le La Martinière.
– Fumez donc tout de suite, ça vaudra mieux,
A un garçon relativement jeune qui m’examinait avec morgue, je dis :
– Vous ne craignez pas le mal de mer ?
– Sais pas, répondit-il froidement. C’est la première fois que je me risque sur l’Océan.
Un de ses voisins releva l’expression :
– Ah ! dis donc, toi ! Tu vas fort ! Ce sont les bourres que te risquent sur l’Océan. Et ils se foutent pas mal de nous ! Pour ce qu’elle vaut à leurs yeux, notre peau ! Si les sardines nous bouffaient, les bourres, cognes et Cie, ça ne pleurerait pas !
Une bordée de rires salua la réflexion. Des mots orduriers jaillirent. Un surveillant me dit à mi-voix :
– Vous voyez, avec eux, c’est toujours ainsi que ça finit. Ce sont les plus voyous qui ont raison. Les mieux élevés doivent garder le silence. Plus on est doux, plus on s’exprime correctement et plus ils sont grossiers. On nous accuse de leur parler avec dureté. Mais il n’y a que ce procédé qui rende des résultats.
La continuation de mon inspection me prouva que ce surveillant disait la vérité. Un peu plus loin, je rejoignis un de mes confrères, ancien officier aviateur, mort depuis et grand amateur de grivoiseries. Il tenait tête à trois ou quatre escogriffes, et rivalisait de gauloiserie avec ces gaillards dont les rires sataniques eussent suffi à épouvanter n’importe quel homme dans une rencontre normale.
– Hé, l’enflé, lui disait un des relégués, tu charibotes et tu es peut-être bien un roussin qui cherche à nous faire jaser ?
– Voilà qu’il m’engueule celui-là, déclara en riant le journaliste.
– Sûr que je t’engueule, reprit le relégué. T’as pas pitié de nous. Toi, tu vas en raconter des histoires, sur ton canard, et nous, on fait les imbéciles pour te faciliter ton boulot. Si tu veux changer ta place avec la mienne, je remonte tout de suite sur le quai. Hé ! tu veux ?
Mon camarade préféra briser là cet entretien qui éveillait déjà l’attention d’un surveillant, et évita ainsi l’intervention de ce dernier.
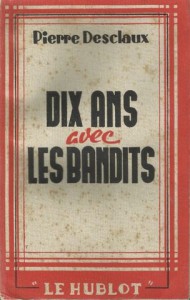 On ne pouvait vraiment espérer tirer, en une pareille minute, rien d’intéressant de ces dégénérés qui souffraient de se voir considérés comme des animaux de ménagerie par tous les officiels et les journalistes qui circulaient là. Et j’approuvais en mon for intérieur ceux qui, affalés sur le plancher du pont, faisaient mine de dormir, pour échapper à tant de curiosités méprisantes.
On ne pouvait vraiment espérer tirer, en une pareille minute, rien d’intéressant de ces dégénérés qui souffraient de se voir considérés comme des animaux de ménagerie par tous les officiels et les journalistes qui circulaient là. Et j’approuvais en mon for intérieur ceux qui, affalés sur le plancher du pont, faisaient mine de dormir, pour échapper à tant de curiosités méprisantes.
Une sirène hulula. C’était le signal attendu. Il y eut des hurlements, des ricanements. Le premier remorqueur s’éloigna du quai pour s’engager dans la passe, les autres bateaux suivirent. Lorsque les bâtiments eurent tous quitté le quai, des cris s’élevèrent.
Un petit nombre de relégués agitaient les bras. Un barrage de police avait été levé. Des civils arrivèrent en courant sur une jetée. Il y avait des femmes parmi eux. Des relégués leur envoyaient des baisers.
Le vent qui soufflait empêchait d’entendre tout ce que criaient les déportés. Cependant, nous perçûmes nettement : « A bientôt ! On se retrouvera à Paname ! On reviendra ! »
En grande majorité, les relégués se taisaient et ne bougeaient pas.
Un canot à vapeur nous amena à La Rochelle, où devait avoir lieu le transbordement sur le grand cargot le La Martinière, spécialement aménagé pour les voyages de forçats. Cargo appartenant au port de Nantes, et qui servait d’habitude à transporter des marchandises. Chaque voyage à destination de la Guyane, entrepris pour le compte du ministère des Colonies, nécessitait une transformation totale qui coûtait une somme assez élevée. L’entrepont était divisé en grandes cages dites « bagnes », munies d’un système de tuyauterie qui permettait d’arroser les passagers avec l’eau bouillante de la chaudière, s’il se produisait une révolte.
Les huit cents relégués, une fois arrivés au port de La Rochelle, passèrent des remorqueurs sur le La Martinière et immédiatement furent enfermés dans les cages. Ils ne criaient plus. Sans doute la fatigue et les émotions produisaient-elles leur effet. En général, une fois dans les cages, ils se jetaient sur le plancher. On eût dit qu’ils étaient exténués. Je pense que le désespoir devait les hanter et les terrasser. Quelques-uns s’accroupissaient derrière les barreaux et saisissaient ceux-ci, comme l’eussent fait des gorilles. Ils ne s’intéressaient pas aux allées et venues des gens du bord et des surveillants militaires. Leurs yeux avaient une expression égarée. Ils réalisaient peut-être, en cet instant, leur misère.
Toutes ces opérations demandèrent des heures. On ferma les cages. Des sentinelles armées furent installées. Les autorités de Paris et de La Rochelle prenaient congé.
Le La Martinière, avec sa cargaison de maudits, appartenait maintenant au ministère des Colonies de qui dépend le bagne de la Guyane. Lui seul, ce ministère, avait à présent le droit de vie et de mort sur les pauvres hères, sur les damnés que la métropole rejetait sans pitié.
Il n’y eut plus bientôt dans le grand navire que des bruits de machine et de commandements. Les relégués n’avaient même plus la force de bavarder entre eux.
Vers la fin de l’après-midi, alors que le soleil venait de disparaître à l’horizon– brumeux et que les phares commençaient à s’allumer, la sirène retentit gravement plusieurs fois.
Les amarres qui retenaient le navire à l’appontement furent larguées. Le La Martinière, lentement, gagna le large. Nous étions demeurés plusieurs sur le quai, ne pouvant nous décider à partir. Nous regardions le cargo qui manœuvrait, afin de prendre sa direction définitive. Il s’estompait dans la brume que perçaient picore ses feux. Puis, d’un seul coup, il disparut.
– Pauvre humanité souffrante, pauvre humanité ! dit quelqu’un près de moi.
Je me retournai. C’était le major Péan, de l’Armée du Salut.
[1] Charles Péan, Conquêtes en terre de bagne, éditions Altis, p.307
Tags: AP, Armée du Salut, Charles Péan, condamné, Conquêtes en terre de bagne, Daladier, Desclaux, Dix ans avec les bandits, émeute, journaliste, La Martinière, La Rochelle, Péan, Pierre Desclaux, relégué, Saint Martin de Ré, Vauban
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail

