Grave et les illégalistes

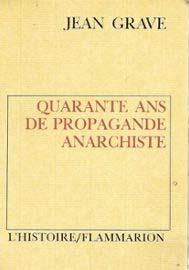 Pour Philippe Pelletier dans L’anarchisme (coll. Idées reçues, Le Cavalier Bleu, 2010, p.49) : Outre le terrorisme, l’illégalisme est l’autre idée reçue qui affuble l’anarchisme. Elle n’est pas fausse, mais tout illégalisme n’est pas anarchiste. Et tout anarchiste n’est pas forcément illégaliste. Tel est Jean Grave (1854-1939), excommunicateur des partisans de la reprise individuelle. Nous pouvons retrouver dans les souvenirs de l’animateur du Révolté, de la Révolte et des Temps Nouveaux tout l’argumentaire du vieil anarchiste assimilant le voleur au bourgeois, considérés tous deux comme des parasites sociaux. Les motivations politiques du cambrioleur, de l’estampeur, du voleur ne constituent chez lui que de faciles prétextes à la jouissance personnelle des fruits collectifs de la production. En d’autres termes, l’illégaliste, dont la collusion avec la police semblerait évidente, ne chercherait pas le bouleversement social. Bien au contraire, il ne viserait qu’à sa conservation et ruinerait toutes les prétentions libertaires.
Pour Philippe Pelletier dans L’anarchisme (coll. Idées reçues, Le Cavalier Bleu, 2010, p.49) : Outre le terrorisme, l’illégalisme est l’autre idée reçue qui affuble l’anarchisme. Elle n’est pas fausse, mais tout illégalisme n’est pas anarchiste. Et tout anarchiste n’est pas forcément illégaliste. Tel est Jean Grave (1854-1939), excommunicateur des partisans de la reprise individuelle. Nous pouvons retrouver dans les souvenirs de l’animateur du Révolté, de la Révolte et des Temps Nouveaux tout l’argumentaire du vieil anarchiste assimilant le voleur au bourgeois, considérés tous deux comme des parasites sociaux. Les motivations politiques du cambrioleur, de l’estampeur, du voleur ne constituent chez lui que de faciles prétextes à la jouissance personnelle des fruits collectifs de la production. En d’autres termes, l’illégaliste, dont la collusion avec la police semblerait évidente, ne chercherait pas le bouleversement social. Bien au contraire, il ne viserait qu’à sa conservation et ruinerait toutes les prétentions libertaires.
Il est vrai que, dès le départ, la question de l’illégalisme suscite de larges débats. Nombreuses sont les réunions, les conférences, les entretiens répondant à la problématique du vol à l’occasion de l’affaire Duval en 1887 ou de l’arrestation de Pini en 1889. Grave et son équipe ne peuvent ignorer le retentissement de ces deux affaires. Ils nuancent alors leurs propos en établissant une double distinction entre, d’une part le voleur professionnel et l’occasionnel motivé par les besoins de l’existence (famine, pauvreté, etc.) et, d’autre part, le voleur qui agit dans un but politique et celui qui est animé par un intérêt uniquement individuel. Cette précision justifie le soutien à Clément Duval mais, par la suite, l’anathème frappe les voleurs, quelle que soit la profondeur de leurs convictions anarchistes.
C’est pour cette raison certainement que Les Temps Nouveaux n’évoquent jamais le procès des Travailleurs de la Nuit en 1905, niant de facto la légitimité du vol affirmé par Jacob dans les colonnes du journal anarchiste Germinal et devant les jurés de la cour d’assises d’Amiens. Jean Grave mentionne pourtant l’honnête cambrioleur dans les Quarante ans de Propagande Anarchiste (Flammarion, 1973). Seulement, s’il reconnait l’attitude crâne de Jacob lors de sa comparution, il dément formellement tout lien avec les « bandits d’Abbeville » dont il se plait à commenter les faits et gestes lorsque ceux-ci résidaient à l’hôtel de la Clef, tenu, par Thériez, ici apparaissant avec la lettre T. Notons juste que cet hôtel ne se trouve pas très loin des locaux … des Temps Nouveaux. Relevons aussi que l’article L’Erreur de Jacob, paru dans les colonnes du Libertaire en date du 19 au 25 mars 1905, prend fait et cause pour l’illégaliste et semble par la répétition du mot « grave » dans son article invectiver « le pape de la rue Mouffetard ».
Quoi qu’il soit, l’exemple de Jacob vient s’insérer dans la longue liste d’exemples donnée par Grave, et ces exemples (Duval, Pini, Parmeggiani, Ortiz, Schouppe, etc.) ne font que servir un propos visant à une condamnation sans appel de l’illégalisme et de ses sectateurs. Même brève, une analyse des discours autorise pourtant le qualificatif de politique accolé à tous ceux qui, illégalement ou violemment, se sont attachés au renversement de l’ordre bourgeois.
 Quarante ans de propagande anarchiste, p. 406 – 408 :
Quarante ans de propagande anarchiste, p. 406 – 408 :
LES MOUCHARDS
C’est pour s’être montré trop tolérant à cette clique d’individualistes mêlés de policiers que le mouvement anarchiste a été inondé de ces anarchistes à âme de bourgeois – dans la pire acception du mot – et que tant de pauvres diables ont été victimes de leurs sophismes, que le mouvement a été amputé d’une foule de bonnes volontés qui furent dévoyées.
Si, aujourd’hui, cette tourbe a pris le dessus, continuant son œuvre de déviation, si le mouvement est tombé au-dessous de tout, les anarchistes à âme de chrétien peuvent en faire leur mea-culpa. S’ils ne sont pas les seuls auteurs du mal, leur tolérance mal placée y entre pour une bonne part.
Ah! oui, j’en ai connu de ces jeunes, venus au mouvement pleins de bonne volonté, pleins de désintéressement, mais qui, s’étant laissé prendre aux raisonnements spécieux des prôneurs de l’illégalisme, se pourrirent dans le milieu où ils s’étaient laissé entraîner, allant échouer au bagne ou en prison.
Pratiquer le vol, c’est se diminuer. Il faut mentir, tromper. Cela n’élève pas les caractères, bien au contraire. Beaucoup de ceux qui commencèrent à pratiquer le vol avec l’idée de servir la propagande, finirent par le pratiquer pour vivre, et jouir crapuleusement, lorsqu’ils avaient réussi « un bon coup ». C’était forcé. L’argent corrompt, surtout lorsque pour l’avoir on a risqué sa liberté, en usant de moyens interlopes.
Si l’on en juge par ce qui fut dit au procès, il y avait mêlés à la bande Bonnot, des individus louches. Il y avait également des individus ayant plus d’appétits que d’idées, et aussi des vaniteux. Mais il devait y avoir également des individus qui avaient commencé par être sincères. Garnier semble avoir été l’un de ceux-là, si j’en crois l’impression que m’a laissée ce qui a été dit de lui.
Bonnot lui-même, qui semble avoir été le type féroce du « struggle-for-lifer », avait peut-être commencé avec des rêves de fraternité et d’émancipation.
Oui, mais !… ils tombèrent dans un milieu où on se moquait de « ces sentimentalités ». « Vivre sa vie », voilà le but de l’homme intelligent. .Et, lorsque la société lui en refuse les moyens, les lui reprendre de force, voilà qui était vraiment anarchiste, vraiment révolutionnaire!
Et pour appuyer sur cela, il y avait les policiers qui avaient fait leurs ces théories afin d’accomplir plus sûrement leur œuvre de désagrégation, qui venaient à la rescousse, démontrant que l’homme qui « a quelque chose dans le ventre » ne va pas prostituer ses bras à un patron, user ses forces et son intelligence à un labeur ingrat, mal payé, qui l’empêche à peine de mourir de faim. [Et, au besoin, indiquant les bons coups à faire.]
Oui, la police, par ses agents, la police chargée de traquer les voleurs et les assassins, ne trouvait rien de mieux que d’en fabriquer pour combattre un courant de revendications sociales qui devenait menaçant pour les privilégiés de la société.
Après tout, les voleurs et les assassins ne sont pas un danger pour l’ensemble de la société. Ils en sont le produit et la justification de son Code, de sa police et de sa magistrature. Aussi, les gouvernants n’éprouvent-ils aucun scrupule à favoriser cette tentative et tourner à l’égout un mouvement d’émancipation qui se développait trop rapidement à leur gré. Et ce, par des moyens antisociaux.
Dès lors, je compris que cela ne servirait qu’à conduire à des controverses sans fin de dévoiler publiquement ceux que je pouvais soupçonner d’être des mouchards.
Il n’y a qu’un moyen d’établir incontestablement l’accusation que l’on porte, c’est d’en donner les preuves. Ces preuves, à moins de cas exceptionnels, manquent toujours. La Préfecture de Police, ni le Ministère de l’Intérieur, ne laissent traîner leurs dossiers à votre portée.
Quant aux présomptions, aux preuves morales, elles ne sont des preuves que pour ceux qui, déjà, ont tiré leurs propres conclusions. Ces preuves n’atteignent pas les « âmes de chrétien ». Aussi, au lieu de perdre mon temps à publier des noms de suspects, je me contentais, lorsque l’occasion s’en présentait, d’avertir ceux avec qui j’étais en relations.
Comme les types étaient ordinairement orateurs de groupes ou de réunions, je mettais au panier les convocations où leur nom était cité. Cela ne ratait pas. A la deuxième ou troisième récidive, ceux qui m’avaient envoyé la communication me demandaient pourquoi je ne l’avais pas insérée? Je leur en donnais la raison. Cela souvent me valait des engueulades. Mais ils étaient avertis. C’était à eux de juger. Tant pis pour ceux qui ne voulaient pas voir clair.
La plupart du temps, du reste, les individus en question finissaient par se « brûler ». Il n’y en eut guère que deux ou trois qui, quoique « brûlés » à moitié, réussirent à se maintenir dans le mouvement, grâce au milieu individualiste.
 Quarante ans de propagande anarchiste, p. 423 – 437 :
Quarante ans de propagande anarchiste, p. 423 – 437 :
LES CAMBRIOLEURS
Passer des mouchards aux cambrioleurs, la transition est tout indiquée. Non pas parce que les premiers font la chasse aux seconds, mais parce que les policiers envoyés parmi nous pour accomplir leur besogne furent, je l’ai déjà dit, mais on ne saurait trop le répéter, parmi ceux qui se distinguèrent le plus en présentant le vol comme un moyen révolutionnaire de revendication sociale.
Sans doute, avant eux, le vol avait été envisagé comme un moyen de fournir de l’argent à la propagande. Les terroristes russes avaient commencé en s’attaquant aux caisses de l’État. Et nombre d’entre nous ne se seraient nullement effarouchés de voir quelque riche banque mise à contribution.
Il y eut une tentative de ce genre, comme je l’ai dit, par un camarade allemand, puis vinrent Duval, Pini[1] qui s’attaquèrent à de simples particuliers.
Seulement, ça n’était pas encore devenu une théorie, et restait plutôt exceptionnel en pratique.
Mais, petit à petit, sous l’influence de certains individualistes plutôt louches, se réclamant, justement, des exemples de Duval et de Pini, on commença à représenter le vol comme un moyen révolutionnaire d’attaquer la propriété. Ensuite ce fut l’intrusion de quelques agents provocateurs qui vinrent à la rescousse, et qui, aujourd’hui encore, continuent à mener systématiquement la campagne.
[L’individualisme ayant proclamé que c’était se prostituer que de louer ses bras à un exploiteur, c’était forcé que les deux questions se juxtaposassent.
Les individualistes eurent de ces trouvailles d’étiquettes faisant images, capables d’illusionner des impulsifs qui s’emballent à la musique des mots.
« L’individu a le droit et le devoir de vivre sa vie, toute sa vie ! » Mais comment vivre toute sa vie, s’il n’a pas de ressources et que travailler, c’est se prostituer? – « C’est bien simple : Reprendre aux bourgeois ce qu’ils nous ont volé ! »
Voilà qui était révolutionnaire ! qui était anarchiste ! Et nombre de ces surhommes, qui avaient des appétits de bourgeois mais non les capitaux pour faire travailler les autres et pas autrement suranxieux de travailler eux-mêmes, acclamèrent cette théorie qui répondait si bien à leur conception des choses.
Seulement, voler c’est très bien, mais il y a des risques après tout. La fabrication de la fausse monnaie était peut-être moins dangereuse. Et la fausse monnaie fut présentée comme un moyen infaillible de bouleverser les relations sociales et de démolir l’État. Et comme il est difficile de s’arrêter dans l’absurde une fois que l’on y a mis le pied, on proclame que, après tout, l’estampage, même d’un copain, n’avait rien de répréhensible. Et cela fut pratiqué.
Et dans cet ordre d’opérations les malins se contentèrent de servir d’intermédiaires, laissant aux « poires » les dangers de l’émission. Contrairement à Pierre Petit, ils n’« opéraient » pas eux-mêmes !]
Laissé à lui-même, ce courant n’eût pas été dangereux. Il fallut l’immixtion des policiers et l’organisation systématique de cette propagande de déviation pour que des jeunes se laissassent prendre à ces sophismes.
Nous fûmes de longues années avant de nous rendre compte de tout le mal qui avait été fait dans nos rangs. La première perception que j’en eus, ce fut lorsque Liard-Courtois revint du bagne. Il me stupéfia par le nombre d’anarchistes qu’il y avait rencontrés, envoyés là pour vol, faux-monnayage et autres actes semblables[2].
Que parmi ceux-là il s’en trouvât qui ne faisaient qu’obéir à leurs appétits, n’ayant pas eu besoin de cette propagande pour être pervertis, nul doute. Mais le nombre était grand encore de ceux qui s’étaient laissé prendre aux sophismes des agents de la Tour Pointue.
« Planter un drapeau[3] » chez son gargotier, est une pratique courante chez quelques-uns. Des camarades de la Chambre syndicale des menuisiers qui, à beaucoup de points de vue, étaient de bons camarades, honnêtes dans les circonstances ordinaires de la vie, ne se mirent-ils pas à ériger en principe l’estampage des marchands de vins ?
C’était en 85-86. Ils s’abonnaient aux maisons de vente à crédit. Une fois la marchandise livrée, ils s’arrangeaient pour ne plus payer.
Parmi eux s’était constitué le groupe des « Pieds-Plats », nom tiré de cette locution d’argot : « Je ne marche pas. J’ai les pieds plats ». Eux ne marchaient pas pour payer leurs restaurateurs.
Quand ils avaient trouvé un gargotier confiant, au crédit facile, ils faisaient monter la note le plus qu’il leur était possible, puis disparaissaient lorsque le gargotier commençait à montrer les dents, à son tour, ne « marchant » plus[4].
 [Le haut fait d’armes dont ils étaient fiers, c’était un « drapeau » dépassant un millier de francs qu’ils avaient réussi à « planter » chez un pauvre diable plus confiant que les autres. Il est vrai qu’ils avaient déployé à son égard une diplomatie digne d’un meilleur but.
[Le haut fait d’armes dont ils étaient fiers, c’était un « drapeau » dépassant un millier de francs qu’ils avaient réussi à « planter » chez un pauvre diable plus confiant que les autres. Il est vrai qu’ils avaient déployé à son égard une diplomatie digne d’un meilleur but.
Ils étaient allés le trouver, lui expliquant qu’ils avaient en commandite des travaux de l’Hôtel de Ville, qu’ils ne pourraient toucher d’acomptes qu’à la fin du mois, qu’il veuille bien leur faire crédit jusque-là.
La fin du mois arrivée, pas d’argent. Le gargotier se montra inquiet et parla de couper les vivres. Ils expliquèrent qu’il y avait quelques petites difficultés à obtenir les acomptes promis, mais que cela allait s’arranger. Pour le rassurer, l’un d’eux le mena à l’Hôtel de Ville, voir quelque fonctionnaire qui lui démontrerait qu’il pouvait avoir confiance en eux.
Arrivés là, justement, en montant l’escalier, le descendait le fonctionnaire qu’ils allaient voir. Ils l’arrêtèrent au passage, lui expliquèrent le cas. Et le « fonctionnaire » expliqua au gargotier que la créance de ses clients était sûre, et que, certainement, il serait averti du jour où se ferait le paiement.
Le pseudo-fonctionnaire était un compère qui, pour l’occasion, s’était affublé d’une casquette superbement galonnée. Mais le gargotier satisfait rallongea le crédit.]
Mais quelques-uns ne s’en tenaient pas là. C’était un principe pour ceux-là, lorsqu’ils allaient chez le marchand de vins, – et ailleurs, je suppose – de rafler tout ce qu’ils pouvaient. Couteaux, fourchettes, serviettes, litres de liqueurs s’il s’en trouvait à leur portée. Tout leur était bon.
Un de nos camarades, nommé Rousseau, qui tenait une boutique de marchand de vins, au coin de la rue Saint-Martin et de la rue de Venise, chez qui on pouvait se réunir en toute sécurité, rendant service aux amis en plus d’une occasion, fut un des plus exploités par cette clique.
[Rue de l’École-Folytechnique, deux pauvres vieux, l’homme et la femme, tenaient un petit débit où ils gagnaient de quoi ne pas mourir de faim. Ils n’avaient aucune idée socialiste ou révolutionnaire, mais deux ou trois camarades mangeaient chez eux, avaient obtenu leur confiance, pouvaient, de temps à autre, y mener quelque pauvre diable crevant de faim et n’ayant pas le sou pour payer.
Découverts par quelques émules des « Pieds-Plats », un ancien blanquiste entre autres, les pauvres vieux furent mis sur la paille.
J’ai déjà raconté de Rieffel qui s’était mis à estamper en grand les commerçants, se faisant livrer des marchandises qu’il liquidait ensuite au-dessous de leur valeur, disparaissant pour recommencer ailleurs… jusqu’au jour où il fut pincé.
Un autre camarade, un tout jeune propagandiste, se livra aussi à ces tripotages. Il se nommait Girier[5]. Orateur, il courait les groupes où il donnait des conférences.
Courir les groupes, ça ne nourrit pas, surtout qu’à ce moment le mouvement anarchiste ne commençait qu’à se développer. D’autre part, se déplacer continuellement, ne facilite pas de trouver du travail. Girier se laissa entraîner à pratiquer l’estampage des commerçants. Tant et si bien qu’à la fin il fut obligé de se cacher sous un faux nom. Il se réfugia dans le Nord sous le nom de Lorion.
Ayant eu le malheur de s’attaquer aux guesdistes, et de leur faire de la contradiction, ils arrivèrent à connaître sa fausse situation. De là à le traiter de mouchard, il n’y avait qu’un pas, qui fut vite franchi par les guesdistes, qui étaient un peu trop aptes à lancer cette accusation contre les anarchistes, imitant, du reste, leur chef de file.
L’accusation fut lancée par un de leurs organes, le Cri des Travailleurs, paraissant à Roubaix.
Quoique déjà sous le coup d’un mandat d’arrêt, Lorion se rendit à Roubaix pour provoquer une réunion contradictoire avec ses accusateurs. Mais, reconnu par les policiers, poursuivi dans la rue par eux et la foule qui s’était jointe à la poursuite, il tira sur la meute.
Arrêté, il fut condamné à dix ans de travaux forcés.
A la décharge des guesdistes, il faut avouer que le genre de vie de Girier était bien fait pour le rendre suspect. Pour mon compte ce ne fut que lorsqu’il m’eut expliqué comment il vivait que je fus relevé de mes suspicions.
Mais, comme je l’ai dit, les guesdistes n’avaient pas besoin que son genre de vie prêtât à suspicion. Il les combattait, c’était suffisant. Girier mourut au bagne.
Avec Duval on sort des chapardages et on entre de plain-pied dans le vol.]
De temps à autre je recevais des communications d’un groupe de camarades italiens signant « Les Intransigenti ». Je fis connaissance avec deux d’entre eux – peut-être composaient-ils tout le groupe à eux deux ? C’était Parmeggiani et Pini. Ils me parurent très énergiques[6]. Ils vinrent me demander de leur laisser composer à notre imprimerie un journal qu’ils se proposaient d’introduire clandestinement en Italie. Je ne vis aucun inconvénient à leur donner cette autorisation, puisqu’il s’agissait de propagande.
Quand je me présentai à l’imprimerie, la mise en pages de leur journal était presque terminée. Ils me montrèrent avec orgueil les épreuves. Le journal s’appelait : Il Ciclone[7].
– C’est très bien leur fis-je, s’il y a des poursuites, la police ne sera pas en peine de trouver l’imprimerie où il aura été composé.
Ces imbéciles avaient non seulement composé leur titre dans les mêmes caractères que celui du Révolté, mais ils avaient donné à leur journal le même format, la même justification. Jusqu’aux titres des articles qui étaient [composés des caractères que l’on employait habituellement pour ceux du Révolté].
Cela ne rata pas. Peu de temps après, je recevais une convocation de M. Clément, commissaire aux délégations judiciaires.
Arrivé chez le personnage, [on me fit attendre dans une pièce où une demi-douzaine de types – que je n’aurais pas aimé rencontrer dans un bois, à minuit – étaient en train de jouer de l’argent aux cartes.
Entre parenthèses, si je ne me trompe, Clément devait être, par-dessus le marché, commissaire de la brigade des jeux.
Pendant que j’attendais, se présenta, en toilette ébouriffante, une dame aux cheveux jaunes, sentant la grue à plein nez. Naturellement, elle fut introduite aussitôt.
Lorsqu’elle sortit, Clément l’accompagna jusqu’à la porte, la saluant jusqu’à terre. Puis] il me fit passer dans son cabinet.
– Connaissez-vous cela, fit-il me tendant un exemplaire de Il Ciclone.
Je pris délicatement le journal. Je l’examinai – faisant semblant tout au moins – attentivement. Puis le retournai à Clément :
– Ma foi, non, c’est la première fois que je le vois.
– Vous voyez qu’il ressemble au Révolté. Mêmes caractères, même disposition.
– Oui. Je vois qu’on a voulu l’imiter. On y a à peu près réussi.
– Alors, vous ne le connaissez pas?
– Ma foi non.
– C’est bien. C’est tout ce que j’avais à vous demander. Vous pouvez vous retirer.
[Et je m’en allai, envoyant au diable mes Intransigenti, ne sachant, au juste, quelle tuile cela pouvait m’amener.
 Je fus une quinzaine sans entendre plus parler de rien, quand] je reçus l’invitation d’avoir à me présenter chez un juge d’instruction [- je dirai « Trois Étoiles », j’en ai oublié le nom. Au Palais de Justice, le couloir des juges d’instruction était désert. Mais je dégotai sur une porte le nom que je cherchais. Je me préparai à entrer quand accourut un garçon pour me dire que l’on n’entrait pas ainsi chez un juge. Que je devais attendre qu’il aille voir s’il pouvait me recevoir.
Je fus une quinzaine sans entendre plus parler de rien, quand] je reçus l’invitation d’avoir à me présenter chez un juge d’instruction [- je dirai « Trois Étoiles », j’en ai oublié le nom. Au Palais de Justice, le couloir des juges d’instruction était désert. Mais je dégotai sur une porte le nom que je cherchais. Je me préparai à entrer quand accourut un garçon pour me dire que l’on n’entrait pas ainsi chez un juge. Que je devais attendre qu’il aille voir s’il pouvait me recevoir.
La porte se rouvrit, et un monsieur excessivement poli – trop poli pour être honnête – me fit signe d’entrer.
– Je vous demande bien pardon d’avoir eu à vous déranger encore. Mais lorsque je vous ai fait appeler chez M. Clément, il n’y avait que deux ou trois questions à vous poser. Et ce sont celles-là que l’on a négligé de vous poser. Mais c’est toujours comme cela avec eux.
Quelles étaient ces questions? Pas grand-chose, je suppose, car, comme Clément, je les ai totalement oubliées.]
L’affaire n’eut pas de suites. Le gouvernement italien n’insista-t-il pas ? Le nôtre pensa-t-il que ça ne valait pas le dérangement ? Je n’entendis plus parler de rien. Et je crois que ce fut la fin de Il Ciclone Outre ce journal, Pini vint imprimer trois ou quatre placards, mais ils étaient principalement dirigés, sous prétexte de divergences d’idées, contre d’autres révolutionnaires : Merlino et Cipriani.
Ce ne fut que plus tard que j’appris que, associés avec les frères Schouppe[8], Pini et Parmeggiani formaient une bande de cambrioleurs dont les opérations se chiffraient par centaines de mille francs[9].
Les Schouppe, paraît-il, se targuaient d’être anarchistes, mais en réalité ils n’étaient que des jouisseurs et de vulgaires voleurs.
De leurs fructueux vols, je n’ai jamais entendu dire que la moindre partie soit allée à une œuvre de propagande. Et cependant j’étais bien placé pour apprendre quantité de choses, même celles qui devaient rester secrètes.
Quant à Pini, ses admirateurs ont vanté sa générosité, célébré les sommes qu’il aurait dépensées pour la propagande, mais j’en suis encore à trouver les œuvres que lui et Parmeggiani subventionnèrent.
Les cinq placards – plutôt de discussions personnelles que de véritable propagande – et le numéro du Ciclone, c’est tout ce que je connais à leur actif en fait de propagande.
[Comme je l’ai dit, j’étais assez au courant des choses de propagande pour que, un jour ou l’autre, j’eusse entendu parler de celles qui auraient pu être subventionnées. Je n’en vois aucune qui n’ait pas été menée à bien par la persévérance et les gros sous des camarades, aucune dont le budget puisse suggérer une aide importante venue du dehors.
Un jour que je causais de cela avec un camarade qui, lui aussi, publiait un journal de propagande, il me confia qu’il avait eu, dès les débuts, connaissance du genre de trafic mené par la bande Pini, et de leur vantardise qu’ils travaillaient pour la propagande. Il était allé les voir pour leur demander de venir en aide à son journal, mais il en avait été pour sa démarche.
Et, après tout, cela est humain. Il leur vient entre les mains des sommes importantes qui, comme on dit, ne leur coûtent que la peur et l’envie de courir. Ils ont couru des risques pour s’en emparer, et la vie journalière leur offre tant de tentations dont ils sentaient fortement la privation alors qu’ils étaient sans le sou. Pourquoi iraient-ils le donner bêtement à d’autres qui, après tout, s’ils veulent enrichir leur propagande n’ont qu’à faire comme eux. La pente est raide. La descente est rapide.
J’ignore si c’est le raisonnement que se sont tenus ceux qui pratiquèrent avec succès la « reprise individuelle », mais c’est comme s’ils avaient raisonné comme cela qu’ils agirent. Il me fut, du reste, raconté que c’était ainsi que s’était exprimé l’un d’eux qui, certainement, avait eu son heure de sincérité. Je ne donnerai pas son nom. Peut-être vit-il encore.
Il était venu jeune dans le mouvement. Lié avec Viard[10], l’ancien membre de la Commune qui avait joint le mouvement anarchiste après l’amnistie, il le soigna, paraît-il, avec un véritable dévouement lorsqu’il tomba malade.
Mêlé au procès Ravachol, il eut une conduite énergique. Mais, par la suite, démoralisé peut-être par la prison, il se laissa entraîner à pratiquer le cambriolage. Et, à des camarades qui lui demandaient pour la propagande, il aurait répondu qu’il n’était pas si bête d’aller verser à il ne savait qui de l’argent qui lui coûtait tant de peine à obtenir, et en courant de grands risques. Que les propagandistes n’avaient qu’à faire comme lui.
Et, je le répète, il avait été un propagandiste convaincu, puisqu’il avait risqué le bagne pour ses idées.]
Mais, je n’ai pas terminé avec la bande Pini. Ce dernier ayant été envoyé au bagne [, ce fut fini avec lui ; mais Parmeggiani] ayant échappé à la police, eut une carrière de héros de roman.
Au temps de leurs opérations, ils avaient volé des tableaux à un peintre espagnol nommé Cossira. Ledit peintre, pour ravoir ses tableaux, se mit lui-même à la recherche de ses voleurs. Comment les découvrit-il ? Comment entra-t-il en relations avec ? Je n’ai jamais su les détails. Toujours est-il que Parmeggiani devint l’amant de Mme Cossira, que Cossira mourut – de ça ou d’autre chose, j’ignore – et que Parmeggiani épousa Mme veuve Cossira, se fit antiquaire et devint millionnaire.
Mais, ayant eu des démêlés avec le nommé Bordes, dont j’ai parlé, ce dernier publia que Parmeggiani – ceci se passait à Londres[11] – était le Parmeggiani de la bande Pini. Parmeggiani prétendait être le frère de l’anarchiste et n’avoir de commun que cette parenté avec l’ex-cambrioleur.
Il intenta à Bordes un procès en diffamation, Bordes soutenant qu’il était à même de le connaître, puisque, autrefois, Parmeggiani s’était présenté à lui avec une lettre de recommandation de moi.
Que j’aie donné à Parmeggiani une lettre de recommandation, c’est fort possible, l’ayant pendant longtemps cru un anarchiste fort sincère. Un homme peu cultivé, mais d’une rare énergie [, il me semblait]. Mais que je l’aie adressé à Bordes, voilà qui est plus contestable, car depuis longtemps j’avais de fortes suspicions que Bordes n’était qu’un mouchard.
[A moins que cela aurait été avant que mes suspicions soient éveillées. Mais cela remonterait trop haut, il me semble.
Quoi qu’il en soit, mon nom fut prononcé au procès.
J’étais, à ce moment, dans la famille de celle qui, plus tard, devait devenir la compagne de mes luttes, joies et tristesses, et dont la famille, quoique étant loin de professer les idées anarchistes, était assez large de compréhension pour ne pas être scandalisée d’avoir un anarchiste chez elle.
Un matin, lorsque je descendis pour le déjeuner, ce fut une des sœurs de ma femme qui, me tendant le Morning Post, me dit : « On parle de vous, là-dedans. Il semble que vous avez de jolies connaissances ! » – J’eus à raconter l’histoire.
Mais, en rentrant à Paris, Delesalle qui, à ce temps, était au journal, me remplaçant, m’apprit que le fameux détective anglais, Melleville, qui avait spécialement la surveillance des anarchistes à Londres, s’était présenté au journal, Bordes me faisant citer comme témoin, et offrant de payer mon déplacement et mes frais de voyage. Delesalle avait refusé de donner mon adresse. Et je n’avais nullement l’intention de me laisser entraîner dans ces histoires de brigands.
Ayant eu, par la suite, à parler de Parmeggiani dans le journal, il eut le toupet de m’envoyer un exploit d’huissier par lequel il prétendait qu’il n’était pas le Parmeggiani que j’avais connu. J’insérai tout en faisant suivre d’un : « E pur, si muove ![12]». Mais j’eus à avaler la chose.]
Après la bande Pini vint la bande Ortiz[13] qui, du reste n’était que la suite de la première.
 Celle-ci, il est probable, fournit quelques fonds à la propagande. Les bombes de la rue des Bons-Enfants, du Terminus, ainsi que la préparation des attentats, ne purent être menées qu’avec l’argent prélevé sur le produit des « reprises » qu’elle fit. Mais lorsqu’on pense que quelques-uns de leurs vols dépassaient cent mille francs, on avouera que c’était maigre. [Possible qu’il y eût d’autres fonds allant à la propagande, mais je ne vois pas.]
Celle-ci, il est probable, fournit quelques fonds à la propagande. Les bombes de la rue des Bons-Enfants, du Terminus, ainsi que la préparation des attentats, ne purent être menées qu’avec l’argent prélevé sur le produit des « reprises » qu’elle fit. Mais lorsqu’on pense que quelques-uns de leurs vols dépassaient cent mille francs, on avouera que c’était maigre. [Possible qu’il y eût d’autres fonds allant à la propagande, mais je ne vois pas.]
Il me fut raconté que certains d’entre eux étant allés à Londres pour négocier les valeurs d’une de leurs opérations, s’étaient adressés à un vieux militant pour que celui-ci les mît en rapport avec quelque recéleur faisant cette sorte de trafic. Le camarade aurait, paraît-il, répondu que s’il acceptait de se mêler de l’affaire, il voulait que sur le produit de la transaction, une certaine somme fût versée pour la propagande. Ces redresseurs de torts auraient refusé, préférant aller se faire « estamper » par un autre trafiquant qu’on leur avait indiqué. Et, l’affaire faite – toujours d’après les on-dit – ils auraient fait la fête avant de retourner en France.
[Par droit de « prise » ou de « reprise », comme ils qualifiaient leurs agissements, c’était leur argent. Ils en faisaient ce qu’ils voulaient, c’était leur droit. Je n’ai rien à dire contre cela.
« C’était leur affaire ! » Peut-être, aussi, un peu celle de ceux auxquels ils l’avaient « pris » ou « repris ». Tout ce que je veux en conclure, c’est que la propagande avait peu de choses à voir dans ces agissements.
Si d’aucuns de ceux qui pratiquèrent le cambriolage furent sincères à leurs débuts dans la propagande, cette sincérité alla tellement s’atténuant lorsqu’ils furent lancés dans cette voie, la propagande devint tellement nébuleuse dans leur esprit, qu’elle ne comptait plus pour beaucoup.]
Du reste, entre eux, ils agissaient ni plus ni moins que s’ils avaient été de vulgaires cambrioleurs.
Un jour, je reçus, d’un nommé Crespin, [que je ne connaissais ni d’Eve ni d’Adam,] une lettre où il me disait qu’ayant des contestations d’intérêts avec Ortiz, il donnait à ce dernier rendez-vous au bureau du journal pour liquider leur affaire sous mon arbitrage.
Je mentirais en disant que je fus flatté de la confiance que me témoignait Crespin. Mais, comme il ne me donnait pas son adresse, que je n’avais pas davantage celle d’Ortiz, force me fut d’attendre leur venue.
Le jour dit, s’amenèrent les deux lascars. Girard, je crois, était avec moi.
– Il vous a plu de me prendre pour arbitre, leur déclarai-je, mais je ne tiens nullement à être mêlé à vos affaires. Puisque vous êtes ici, je consens que vous liquidiez le litige qui vous divise – ce fut une faiblesse de ma part – mais je vous préviens que si, plus tard, mon témoignage est réclamé, je déclinerai d’avoir rien connu de vos transactions, ni assisté à quoi que ce soit.
Et, avec Girard, nous retirant dans un coin de la pièce, nous laissâmes les deux compères faire leur petite affaire.
Ils sortirent des paquets de valeurs, dont il y avait bon nombre, parmi lesquelles des ottomanes que je remarquai à cause des caractères turcs. Ils se les divisèrent entre eux après bien des contestations. Après quoi, ils s’en allèrent.
J’avais oublié l’affaire lorsque je fus appelé chez le commissaire du quartier.
Là, on me fit prêter serment de déclarer la vérité. Serment que je délivrai d’autant plus volontiers que, quel que soit ce que l’on me demanderait, je ne dirais que ce qu’il me conviendrait de dire.
– Les nommés Crespin et Ortiz s’étaient-ils rencontrés au bureau de la Révolte et s’y étaient-ils partagé des valeurs?
Sans broncher, j’affirmai que je ne connaissais que vaguement ces messieurs et n’avais aucune connaissance de cette rencontre. L’interrogatoire ne fut pas poussé plus loin.
Mais de là, je conclus que le Crespin avait été arrêté, qu’il avait dû dénoncer son complice et que c’était pour contrôler ses déclarations que j’étais appelé en témoignage.
Et je compris ma bêtise d’avoir laissé ces deux « cocos » finir leurs démêlés en ma présence, lorsqu’au Procès des Trente, sur la liste des témoins je vis figurer le nom de Crespin, détenu !
Je me grattai furieusement la tête : « Encore une tuile ! pensai-je. » Il est là pour raconter l’histoire de son entrevue au bureau du journal, et l’avocat général en profitera pour dire : « Vous voyez bien qu’ils étaient tous complices ! C’était à la Révolte qu’on se partageait le butin. »
Ce fut un véritable soupir de soulagement lorsque, au procès, Crespin se retira, ayant terminé sa déposition, sans qu’il fût question de l’entrevue.
[Tous ces chevaliers de la « reprise », on peut les prendre l’un après l’autre, il y a toujours quelque histoire malpropre.
Pendant l’instruction du Procès des Trente, revenant un jour de l’instruction, il s’éleva une chaude discussion entre les occupants des autres compartiments du panier à salade qui nous ramenait à Mazas.
Ils pouvaient être une demi-douzaine. Ils se reprochaient mutuellement de s’être dénoncés les uns les autres, rappelant les disputes qu’ils avaient eues devant le juge d’instruction.
L’un d’eux accusait les autres d’être les auteurs de son arrestation, en lui refusant la centaine de francs qui lui aurait permis d’échapper, alors qu’ils avaient de fortes sommes en leur possession. Puis, ils en vinrent aux cambriolages qu’ils avaient commis. – Je n’y étais pas, disait l’un. Moi non plus, disait un autre. C’est toi. C’est pas vrai. Et cela dura tout le voyage.
Un seul prenait tout à sa charge. C’était Marpeaux[14]. – Je sus que c’était lui, parce que ses associés le nommèrent au cours de la discussion. Il pouvait, sans plus de risques, prendre n’importe quoi à sa charge, ayant déjà à son compte le meurtre de l’agent de police qui tenta de l’arrêter dans un bureau de poste.
De la bande Jacob, je n’ai connu personne. Elle fut également fameuse, son chef se réclamant de l’anarchie, et par les fructueuses razzias qu’elle sut opérer.
Des débats du procès, il ressortait qu’ils avaient été dénoncés par l’un d’eux. – Toujours la même histoire.
Seul, Jacob eut une ferme attitude au procès. Il lut une déclaration anarchiste dont j’ai oublié les termes, mais qui fut publiée par un journal anarchiste de la région où eut lieu le procès. Il est vrai que les inspirateurs de ce journal faisaient en petit ce que Jacob faisait en grand.
Mais si je n’ai connu personne de la bande, je connaissais un nommé T., ancien ouvrier ébéniste qui s’était établi patron d’un hôtel meublé dans le quartier Mouffetard.
Ce fut chez lui que plusieurs comparses de la bande vinrent prendre domicile. T. me racontait que, au lendemain de razzias fructueuses, ces contempteurs des bourgeois ne sachant comment dépenser leur argent jouaient le Champagne au zanzibar. Puis ce fut une histoire dont j’ai oublié les détails. C’était au sujet de sa bonne qui avait été salement traitée.
Maintenant, je dois dire que, plus tard, T. fut fortement soupçonné de s’être vendu à la police.]
Quant à la bande Bonnot, elle est relativement trop récente pour qu’on ne se la rappelle pas. D’elle, je n’ai également connu personne, si ce n’est un vague comparse, Gauzy, qui fut abonné aux Temps Nouveaux, et dont je suis encore à me demander comment il s’était fourvoyé là-dedans !
Je ne puis donc en parler que par ouï-dire. Quelques-uns dépensèrent une farouche énergie, digne de meilleurs objectifs. Eux aussi, opérèrent de riches coups, sans que personne ait jamais connu quelles œuvres de propagande ils soutinrent. Les victimes qui tombèrent sous leurs coups furent de pauvres diables de travailleurs ou d’employés. Eux aussi furent dénoncés par un de leur bande. On ne sut jamais comment la police avait été mise sur la trace du dernier refuge de Garnier.
Du reste, ils avaient pris naissance dans le milieu du journal L’ Anarchie où ils reçurent, sûrement, leurs premiers principes d’individualisme et de cambriolage par les « missionnaires » policiers qui infestaient ce milieu.
Pendant que la bande terrorisait Paris, je reçus la visite d’un grand gaillard bien découplé, accompagné d’un jeune garçon d’environ quatorze ans.
Il me raconta que, faisant partie de la bande Bonnot, il était traqué, ne savait plus où se réfugier, et me demanda si je pouvais lui trouver un asile.
 Cet homme aurait été poursuivi pour quelque acte de propagande, j’aurais certainement fait de mon mieux pour le tirer de sa peine. Mais ces gaillards, avec leur théorie de « vivre sa vie d’abord », proclamant que la solidarité était une blague, mais sachant s’en réclamer lorsqu’ils avaient besoin des autres, me dégoûtaient. Aussi lui répondis-je que, adversaire de leurs théories comme de leurs pratiques, je ne voulais rien avoir à faire avec eux. Et que, ce que je ne voulais pas faire moi- même, je me garderais bien de le demander aux autres.
Cet homme aurait été poursuivi pour quelque acte de propagande, j’aurais certainement fait de mon mieux pour le tirer de sa peine. Mais ces gaillards, avec leur théorie de « vivre sa vie d’abord », proclamant que la solidarité était une blague, mais sachant s’en réclamer lorsqu’ils avaient besoin des autres, me dégoûtaient. Aussi lui répondis-je que, adversaire de leurs théories comme de leurs pratiques, je ne voulais rien avoir à faire avec eux. Et que, ce que je ne voulais pas faire moi- même, je me garderais bien de le demander aux autres.
Ceci, parce qu’il m’avait demandé l’adresse de camarades qui auraient pu lui venir en aide.
J’avais grande pitié du gosse qui était avec lui, mais, vraiment, [dans leurs différentes affaires,] ils avaient fait trop bon marché de la vie de pauvres diables. La vérité devait leur être dite une fois pour toutes.
D’autant plus qu’il n’était peut-être qu’un vulgaire tapeur.
Ce n’est pas seulement en France que cette théorie du vol s’était développée comme un chancre rongeur. Kropotkine me racontait tout le mal qu’elle avait fait dans le mouvement russe.
D’importantes sommes avaient été ainsi reprises sans grand profit pour la propagande. L’argent avait été dépensé pour préparer de nouveaux coups, ou pour tenter de faire évader ceux des complices qui avaient été pincés au cours des opérations. Sans compter ceux qui trouvaient mieux de faire la noce avec !
[Chez les Russes aussi cela avait amené des histoires plus ou moins propres. Kropotkine me raconta l’histoire d’un Arménien – ou Géorgien, j’ai oublié – qui, pour faire chanter son père, se prêta à la comédie d’un enlèvement. Le père menacé de l’exécution de son fils s’il ne versait pas à telle époque la forte somme. L’argent ainsi prélevé ne profita nullement à la propagande. L’un des « capteurs » se l’étant approprié.
Ce fut encore Kropotkine qui me raconta aussi que s’étaient présentés chez lui, de ma part, trois Italiens. Le frère de l’un d’eux était ingénieur et avait la surveillance de travaux importants. Comme tel il était chargé de faire la paie aux hommes. Son frère, aidé de ceux qui l’accompagnaient, s’était emparé de la somme et venait demander à Kropotkine ou le conseil ou les moyens d’utiliser la somme. Kropotkine, que ces procédés dégoûtaient, les avait mis à la porte.
Par la suite, il reçut la visite du père des deux frères à la recherche du fils voleur. Pour réparer le vol dont avait été victime son fils l’ingénieur il avait dû se dépouiller de tout. Si mes souvenirs ne sont pas embrouillés, cela aurait fini tragiquement par la mort du père ou du fils volé.
Les types en question étaient bien venus un soir, très tard, me demander l’adresse de Kropotkine, mais sans me dire de quoi il était question. Comme Kropotkine ne cachait pas son adresse, j’avais cru bien faire en la leur donnant.]
[1] L’Italien Pini, qui vivait à Paris, fonda vers 1887 le groupe des « Intransigenti » avec Parmeggiani. Anarchiste convaincu, il était un adepte de la « reprise individuelle ». Arrêté après une perquisition le 18 juin 1889, il fui condamné à 20 ans de travaux forcés, malgré une belle plaidoirie de Me Labori.
[2] Liard-Courtois a raconté ses souvenirs dans Souvenirs du bagne> Paris, Charpentier-Fasquelle, 1903.
[3] « Se faire ouvrir un compte et disparaître sans payer » (note de Jean Grave, édition de 1930).
[4] Cf. un rapport de police du 29 janvier 1886 (P. Po Ba/74) qui signale quatre compagnons menuisiers qui sont partis en novembre 1885 de chez 1111 marchand de vins, avec une dette de 84,30 francs et en emportant des serviettes ; puis, en janvier 1886 de chez un autre, avec une dette de 2 130 francs. (Cité par Jean Maitron, H. M. Ap. 172.)
[5] Girier-Lorion, né vers 1870 dans une famille ouvrière, s’enfuit de chez lui et fit un séjour dans une maison de correction (1883-1886). A sa sortie, il milita, dans la région lyonnaise, dans les groupes anarchistes où son éloquence fut appréciée. Condamné à un an de prison, il partit en 1889 dans le Nord, sous le nom de Lorion. A nouveau condamné, il se réfugia au Havre, mais, traité d’agent provocateur par le journal guesdiste de Delory, Le Cri des Travailleurs, il se rendit à Roubaix pour provoquer une explication et lut arrêté par la police. Il passa en Cour d’assises à Douai, le 17 décembre 1890, et fut condamné à 10 ans de travaux forcés. Au bagne, en 1894, il fut condamné à mort pour avoir participé à une révolte de forçats et attendit, chaque matin, pendant 8 mois, son exécution. On le condamna en définitive à 5 ans de réclusion cellulaire, c’est-à-dire à une mort lente. Les efforts de ses amis et de son avocat ne purent rien pour lui ; le Ier mai 1897 il réussit à faire passer une lettre (que le Journal du 13 juin publia) dans laquelle il appelait au secours. Il mourut vers la fin de 1898.
[6] Pini semble effectivement avoir été un militant convaincu ; Parmeggiani, au contraire, devint par la suite suspect à beaucoup d’anarchistes. Malato avait « la conviction morale absolue » que Parmeggiani réfugié à Londres était devenu un policier (cf. article de Malato dans le Peuple, n° 106, 7 février 1938).
[7] Un numéro unique parut en 1887.
[8] Les frères Schouppe ou Schuppe firent partie de la bande Pini. Ils furent condamnés, l’un à 10 ans, l’autre à 5 ans de travaux forcés. Si le jugement de Grave à leur égard semble un peu sévère, il est certain cependant que leur attitude au procès ne fut guère énergique. Alors que Pini affirmait ses convictions anarchistes, eux, au contraire, nièrent autant qu’ils le purent.
[9] 400 000 à 500 000 francs, ce qui était énorme pour l’époque.
[10] Pompée., Auguste, Vincent Viard, dit l’Éponge, Gagin, Ta vin 1836-1892), membre de la Commune, se réfugia à Londres puis rentra en France après l’amnistie et devint anarchiste.
[11] A Londres, Parmeggiani fonda avec un certain Molas, un groupe, « L’Anonymat », qui critiquait violemment les militants anarchistes.
[12] « Et pourtant, elle tourne »
[13] Ortiz et certains de ses compagnons comparurent, au Procès des Trente (août 1894), au côté des anarchistes. Ortiz fut condamné à 15 ans de travaux forcés, Émile Henry, l’auteur des attentats de la rue des Bons-Enfants (8 novembre 1892) et de l’hôtel Terminus (12 février 1894), fut soupçonné d’avoir été en relations avec Ortiz et sa bande.
[14] Marpeaux, fortement soupçonné d’avoir, le 29 novembre 18933 tué l’agent Colson qui venait l’arrêter pour vol, fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il mourut aux îles du Salut, en même temps que Léauthier, lors de la répression qui suivit la révolte des forçats en octobre 1894.
Tags: anarchisme, Bonnot, Bordes, bourgeois, cambriolage, Crespin, Duval, estampage, Garnier, Gauzy, Girier-Lorion, Grave, illégalisme, individualisme, Jacob, Jean Grave, Kropotkine, La Révolte, Le Révolté, les Temps Nouveaux, Londres, Marpeaux, Mazas, mouchard, Ortiz, pape de la rue Mouffetard, parasite, Paris, Parmeggiani, Pini, police, procès des Trente, Quarante ans de propagande anarchiste, révolution, Russie, Schouppe, Thériez, vol
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail


15 juin 2013 à 11:53
A la prose du pape de la rue mouflard a l’encontre du courant individualiste,de la propagande par le fait et reprise individulel,creneau dont se revendique encore de nos jours d’autres papes et temples.
Grave fut le reflet d’un courant anarchiste, mais au dela quels furent ses relations avec des courants de pensées autre que l’anarchisme ? Un aspect inconnu a ce jour du
personnage ?