Haro sur le Bouhey !
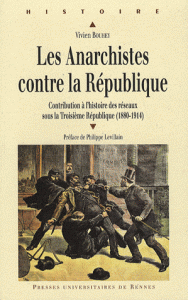 Des poseurs de bombes ? Une internationale noire de la pince monseigneur ? Bien loin de renouveler le genre, comme peut l’affirmer Jean-Marc Berlière dans une communication faites aux Amis de la police en mars 2009, la thèse de Vivien Bouhey, soutenue en 2006, n’en constitue pas moins un élément important et significatif de l’historiographie officielle et universitaire du mouvement libertaire français. L’auteur des Anarchistes contre la République entend démontrer, comme l’indique le titre de son étude parue aux Presses Universitaires de Rennes en 2008, l’existence de réseaux agissants. Agissants et … malfaisants. Sources policières à l’appui, le volumineux ouvrage, parce qu’il ne fournit pas d’appareil critique vis-à-vis de ces sources même, finit par véhiculer, donc par certifier, tout une imagerie d’Epinal sur l’anarchisme hexagonal durant la Troisième République. Force est alors de constater que, plutôt que d’alimenter un débat historique et constructif sur les questions de la propagande par le fait ou encore de l’illégalisme, le livre qui bénéficie de la caution de l’Université suscite nombre de critiques. Haro sur le Bouhey ?
Des poseurs de bombes ? Une internationale noire de la pince monseigneur ? Bien loin de renouveler le genre, comme peut l’affirmer Jean-Marc Berlière dans une communication faites aux Amis de la police en mars 2009, la thèse de Vivien Bouhey, soutenue en 2006, n’en constitue pas moins un élément important et significatif de l’historiographie officielle et universitaire du mouvement libertaire français. L’auteur des Anarchistes contre la République entend démontrer, comme l’indique le titre de son étude parue aux Presses Universitaires de Rennes en 2008, l’existence de réseaux agissants. Agissants et … malfaisants. Sources policières à l’appui, le volumineux ouvrage, parce qu’il ne fournit pas d’appareil critique vis-à-vis de ces sources même, finit par véhiculer, donc par certifier, tout une imagerie d’Epinal sur l’anarchisme hexagonal durant la Troisième République. Force est alors de constater que, plutôt que d’alimenter un débat historique et constructif sur les questions de la propagande par le fait ou encore de l’illégalisme, le livre qui bénéficie de la caution de l’Université suscite nombre de critiques. Haro sur le Bouhey ?
Il est pourtant régulièrement encensé dans la presse, sur le web et à la radio. Sur France Inculture, entre autres, où l’on retrouve Philippe Levillain, animateur de l’émission Les lundis de l’histoire et accessoirement spécialiste du catholicisme. Accessoirement n’est pas vraiment le bon mot. Notre bonhomme, qui a dirigé les travaux du p’tit Vivien, signe ici la préface du précieux et vénérable ouvrage. Etonnante préface d’ailleurs qui nous apprend, qui nous certifie, qui affirme, qui nous assène qu’il y a un anarchisme de droite et que l’anarchisme de gauche est historiquement terminé et dépassé, reclus dans cette Belle Epoque qui suscite tant d’imaginaires. Logique puisque cette idée n’a plus de prise dans le réel, puisque ce mouvement est mort. Fatal : le dit mouvement libertaire devient un sujet d’étude et uniquement cela. Mais CELA est plein d’a priori, de parti pris et de subjectivité. C’est donc peu dire que la préface donne le ton du reste. Bien sûr notre doctorant n’est pas coupable d’une telle prose. Il l’a néanmoins acceptée et nous n’avons nulle part remarqué une quelconque critique de sa part.
Autre personnage appuyant de son nom le propos du futur grand historien de l’anarchisme, Jean Garrigues, coutumier du fait, ne manquait pas d’imagination pour émettre l’hypothèse d’un complot contre Sadi Carnot en écrivant un article dans la soi-disant sérieuse revue de vulgarisation L’histoire (n°191, septembre 1995). Dans ce papier, l’auteur appuyant le travail de Vivien Bouhey, suggérait même la lâcheté des compagnons sétois (et en particulier Ernest Saurel, ami de l’assassin du président et ami d’Alexandre Jacob) qui auraient eu peur d’aller commettre l’attentat contre le président de la République, laissant ce soin à une espèce de benêt transalpin. Car, après tout, Caserio, ne peut être qu’un doux dingue illuminé. CQFD !
Si, nous l’avons dit, le traitement des sources pose un évident problème dans la construction de l’argumentaire développé, Romain Ducoulombier et Marianne Enckell ne manquent pas non plus de souligner, dans les articles qui suivent, les faiblesses d’une telle démonstration, défendue ardemment par son auteur dans les colonnes du RA Forum le 22 mai 2009. A l’imprécise définition de l’organisation anarchiste viennent ainsi se surajouter de nombreuses approximations et incohérences et, surtout, des sujets envisagés comme autant d’éléments prosopographiques.
Le cas du voleur vosgien Charles Bernard est, par exemple, monté en exergue pour mettre en lumière un plan illégaliste bien établi. Il est alors des plus surprenants de voir que Vivien Bouhey, se basant sur les seuls rapports de police conservés aux archives départementales de Meurthe et Moselle, ait pris comme vérité absolue les dénonciations d’un homme qui, après le fructueux cambriolage commis aux Rosières aux Salines près de Nancy en 1900, cherche de toute évidence à se disculper ou, tout au moins, à amoindrir son cas. Charles Bernard donne alors aux flicaillons venus le serrer le nom d’une cinquantaine de militants anarchistes, résidant partout en France et à l’étranger (Angleterre, Suisse, etc.). Certains sont connus : Libertad, Malato, Matha, Marocco … De là à affirmer une volonté révélée et un vaste réseau de comploteurs, il n’y a bien sûr qu’un pas. Alea jacta est ! Mais Charles Bernard sait que, si le crime ne paie pas, la délation, elle, peut s’avérer fort utile. Avril 1903. Alexandre Jacob, Félix Bour et Léon Pélissard tombent dans les mailles du filet de la police et de la justice française. L’instruction menée tambour battant révèle une immense organisation de voleurs libertaires. Les Travailleurs de la Nuit sont démantelés. Le juge Hatté ne retient pourtant pas comme preuve à charge les dénonciations d’un obscur bagnard de la Guyane qui, du tréfonds de son enfer carcéral, écrit qu’il a très bien connu Jacob puisque celui-ci l’aurait initié au vol en compagnie de son beau-père Placide Schouppe. Charles Bernard fait fi d’un anachronisme flagrant qui démentit de facto ses allégations, passées et présentes. Charles Bernard tente de sauver sa peau. Nous y reviendrons dans un très prochain article. L’histoire est vérifiable aux Archives contemporaines de Fontainebleau, aux Archives départementales de la Somme ou encore aux Archives de la Préfecture de police de Paris.
Mais de cela, le doctorant Bouhey semble n’en avoir cure. Il prend un exemple, lui-même pris tel quel sur une source. Le fait démontré peut alors devenir généralité. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.
A trop vouloir faire une étude comptable du mouvement libertaire, ou de quoi que ce soit d’autre, on finit par oublier un axiome de base de la science historique : l’homme est au centre. Et ce, qu’il soit actif ou non, au sein d’un groupe, d’un mouvement ou d’un réseau. Vivien Bouhey produit ainsi une démonstration sans vie et sans réelle prise dans la réalité de ce que fut par exemple l’illégalisme. Jean Maitron, dont il cherche par tous les moyens à montrer les errements, (ce qui au demeurant n’est pas totalement faux), nous dit pourtant que cette « anarchie dans l’anarchie », pour reprendre la phraséologie des tragiques, eut de nombreux adeptes. Vivien Bouhey élargit cette thématique et c’est tout le mouvement libertaire qui vient comploter pour assassiner la République. Retenons en fin de compte que le fantasme de l’anarchiste violent, voleur et assassin, a encore de beaux jours devant lui et n’a pas fini de faire couler de l’encre, ni de faire entrer dans la carrière. Et ce n’est pas enfoncer des portes ouvertes que de dire cela.
La vie des idées
http://www.laviedesidees.fr/Ni-Dieu-ni-maitre-ni-organisation.html
mis en ligne le 11 mai 2009
Ni Dieu, ni maître, ni organisation ?
Les anarchistes et la République, 1880-1914
Romain Ducoulombier
De la fin du XIXe siècle à nos jours, le mouvement anarchiste n’a cessé d’alimenter les fantasmes sur l’existence d’une Internationale terroriste noire. Le livre de Vivien Bouhey est l’occasion de comprendre comment les autorités ont voulu réduire l’anarchisme des années 1890, fortement ancré dans la classe ouvrière, à la menace d’un complot contre la République.
Vivien Bouhey, Les Anarchistes contre la République. Contribution à l’histoire des réseaux sous la Troisième République (1880-1914), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 496 p., 24 €.
À la fin du XIXe siècle, l’anarchisme français est en plein essor. Deux décennies après la répression de la Commune et la dissolution de la Première Internationale en 1876, il peut défier l’ordre républicain établi et affirmer son originalité contre les socialistes au sein du mouvement ouvrier. Au début des années 1890, plusieurs attentats à la bombe sont perpétrés en plein Paris par Ravachol puis par le jeune Émile Henry. Des anarchistes dits « individualistes » prônent la « propagande par le fait » pour démasquer les « ambitieux » qui trompent le peuple et la République qui le corrompt. Le vol, la production de fausse monnaie, les déménagements à la cloche de bois sont autant de pratiques « illégalistes » qui visent à détruire la propriété et à éduquer les dominés. Au moment même où le mouvement anarchiste se tourne progressivement vers l’action collective et syndicale, les « individualistes » lui lèguent sa légende héroïque et sacrificielle par des « actes » qui fascinent l’opinion.
L’anarchiste individualiste est-il pour autant seul ? Les historiens de l’anarchisme n’ont cessé de diverger sur cette question. En 1971, Jean Berthoud avait contesté la thèse dominante avancée par Jean Maitron, selon laquelle l’action terroriste anarchiste des années 1890 était résolument personnelle : toute action politique, et tout spécialement terroriste, réclamait en effet, selon Berthoud, un minimum de concertation et la mise en œuvre de réseaux militants pour espérer réussir. Dans l’intention de renouveler l’histoire de l’anarchisme sous la IIIe République, Vivien Bouhey reprend ce débat, dans l’impasse où il avait été laissé, afin d’y mettre un « point final » (p. 16).
La thèse de l’auteur est simple : les anarchistes sont plus et mieux « organisés » qu’ils ne veulent bien le dire. Cette problématique lui permet de rassembler toutes les traces archivistiques des liens, échanges, rencontres, groupes, ligues, comités et syndicats où apparaissent des anarchistes. Si le livre porte sur l’ensemble de l’histoire de la IIIe République jusqu’à la Grande Guerre, c’est en fait sur l’épisode terroriste des années 1890 qu’il concentre son attention et teste son hypothèse. Une telle approche possède un inconvénient majeur : elle condamne l’ouvrage à osciller entre la tentation de l’exhaustivité et la discussion fine d’un problème historique circonscrit. Le livre ne parvient pas à échapper à cette difficulté – et ce, bien qu’il apporte, grâce à une écriture claire et efficace, des éléments utiles à une réflexion plus générale sur la place de l’anarchisme dans le mouvement ouvrier français. L’ampleur des dépouillements effectués dans les dépôts d’archives départementaux l’a contraint semble-t-il à ignorer d’autres gisements, en particulier les très riches fonds de dossiers personnels de police du Centre d’Archives Contemporaines (CAC) de Fontainebleau. La bibliographie, même sous sa forme intégrale proposée en accès libre sur internet, ne comporte aucune référence en langue étrangère, ce qui est paradoxal pour un ouvrage qui entend démontrer l’existence – en fait discutable – de « bases arrières du terrorisme international » anarchiste (p. 54), et même d’un « exécutif anarchiste pour la France (voire pour l’Europe occidentale) » (p. 443).
Un débat historiographique dépassé
Dans les années 1960, l’historien Jean Maitron avait jeté les fondements d’une histoire ouvriériste du mouvement ouvrier. Convaincu de la nécessité de doter les méprisés des cultures officielles d’une histoire et d’une dignité propres, Maitron avait entrepris son grand œuvre, toujours continué : un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Des origines sociales populaires et des actes de « sacrifice » à la cause prolétarienne étaient les critères d’une biographie militante idéale. Maitron partageait autrement dit avec les militants du mouvement ouvrier une culture aujourd’hui démantelée.
Dans ses travaux, Maitron avait pris position contre l’anarchisme individualiste. L’illégalisme était un « mal » qui rongeait l’anarchisme et le détournait de l’action syndicale. Il portait ainsi un jugement moins scientifique que politique et moral sur une expérience à la fois traumatique et exceptionnelle. L’entrée progressive des anarchistes dans le mouvement syndical avait pour lui une portée militante plus décisive que la fièvre terroriste sans lendemain des années 1890. Un tel jugement, quoique discutable sous cette forme, n’est pas tout à fait faux. Maitron, par ailleurs, avait conscience du fait que conclure que l’anarchisme était « organisé » revenait à accréditer les accusations de « complot » que les services de police se sont toujours efforcés d’établir. Cela, d’ailleurs, n’est pas nouveau. Lorsque l’ouvrier sellier Pierre-Louis Louvel avait poignardé le duc de Berry en 1820, les Chambres réunies en Haute Cour avaient tenté sans succès de démontrer la thèse du complot. L’accusation devait avouer la même impuissance lors du procès d’Émile Henry en 1894.
Jean Berthoud, en 1971, avait critiqué cette interprétation de Maitron, trop conforme aux dires des acteurs eux-mêmes. Il voulait démontrer que les anarchistes s’étaient organisés pour assassiner le président Sadi Carnot, le 24 juin 1894. Cet acte n’était pas, contrairement à ce qu’affirmait Maitron, un « acte pensé, élaboré, exécuté par un seul individu ». Jusqu’au renouvellement historiographique de l’histoire de l’anarchisme engagé dans les années 1990, le débat en était resté là. Fallait-il le rouvrir tel qu’il s’était fermé au début des années 1970 ? Il est en fait profondément tributaire d’une époque désormais révolue, marquée par la toute-puissance du modèle du parti de masse, du militant et du principe de l’organisation.
Une définition imprécise de l’organisation
Tout au long de sa démonstration, Vivien Bouhey recourt à une définition imprécise de l’« organisation », qui est pourtant un instrument heuristique doté d’une histoire complexe. L’auteur rassemble sous ce terme des phénomènes très différents en réalité – aussi bien l’existence de réseaux épistolaires, que les organisations partisanes et syndicales ou les phénomènes de « bandes » et de banditisme. En fait, être un « organisé » à la fin du XIXe siècle, c’est d’abord appartenir à des structures permanentes, dont le caractère public apparaît contradictoire avec leur vocation révolutionnaire. C’est pourquoi l’engagement progressif des anarchistes dans le mouvement syndical est un tournant majeur de leur histoire. Mais l’existence de réseaux épistolaires ou même de relations personnelles entre les anarchistes ne saurait être tenue pour de l’« organisation ». À l’inverse, les « bandes » célèbres de Bonnot ou de Jacob – singulièrement absentes du livre – sont des formes de banditisme social [1] étrangères au militantisme politique organisé. C’est pourquoi d’ailleurs elles révulsaient Maitron.
Qu’est-ce que l’anarchisme ?
Le mouvement ouvrier a largement débattu, dans le dernier tiers du XIXe siècle, de la nécessité et de la forme de son organisation politique. Les anarchistes ont pris une part à la fois active et originale à ce débat, au moment même où le mouvement ouvrier se dote de structures partisanes et syndicales permanentes. Vivien Bouhey montre très bien comment l’anarchisme, issu du socialisme anti-autoritaire, peine d’abord à se distinguer du socialisme dans les années 1880. Ces controverses vont lui permettre de dégager et d’affirmer une part de son originalité. Les anarchistes, au fond, se dressent moins contre toute organisation que contre toute autorité, même s’ils ont conscience que toute organisation secrète de l’autorité.
Il ne s’agit donc pas vraiment de savoir si l’anarchisme est ou non « organisé » : là-dessus, l’auteur apporte suffisamment d’éléments pour conclure qu’il l’est en effet bien plus qu’il n’a pu le prétendre. Mais sa démarche le contraint, malgré lui, à décréter l’impossibilité a priori de la démarche anarchiste : il ne serait pas possible d’échapper à l’organisation. L’anarchisme se serait donc bâti sur un contresens d’une évidence flagrante. En quoi peut-il dès lors consister ? L’identité anarchiste ne tient pas qu’au refus du principe de hiérarchie. Elle découle aussi de la revendication d’un mode de vie « en-dehors », de la confiance dans la toute-puissance de l’intériorité contre la détermination sociale par le « milieu ».
Existe-t-il une Internationale terroriste noire ?
La thèse de Vivien Bouhey se durcit lorsqu’il aborde l’épisode terroriste des années 1890. L’auteur rappelle que la série d’attentats anarchistes parisiens des années 1891-1894 n’est pas un accident dans l’histoire anarchiste. Elle est préparée par le bouillonnement idéologique des décennies précédentes. Il montre aussi comment les « anarchistes individualistes » qui se sacrifient alors pour la « cause » se forment, se préparent, et passent à l’action, aidés, puis cachés par des compagnons. C’est dans cette perspective qu’il affirme l’existence de « bases arrières du terrorisme international » anarchiste en Europe occidentale (p. 213) qui auraient permis aux compagnons de planifier et d’exécuter leurs attentats.
L’hypothèse, cependant, nous semble assez faiblement étayée. L’auteur ne lui consacre vraiment qu’une page, où il n’apporte guère de preuve documentaire de ce qu’il avance. L’étranger – Genève, puis Londres et la Belgique – est plutôt un refuge qu’une base arrière pour les anarchistes poursuivis par la police française. L’argument est plus convaincant lorsque Vivien Bouhey montre comment un groupe d’anarchistes espagnols, soutenus par quelques anarchistes français, tente d’assassiner le roi Alphonse XIII, rue de Rohan à Paris, en 1905, ou comment un « commando » anarchiste opère en Belgique en 1908. Mais, là encore, s’agit-il au fond d’une « organisation » au sens où l’historien du mouvement ouvrier l’entend ? Les « bandes » illégalistes des années 1900 sont organisées sur un mode étranger à l’univers politique ou syndical. C’est leur caractère alternatif qui séduit ceux qui s’y engagent. L’amalgame entre vocabulaires policier et ouvrier, compliqué par l’usage de terminologies marquées par le terrorisme international contemporain, interdit finalement à l’auteur d’opérer les distinctions méthodologiques nécessaires à son analyse.
Les « en-dehors »
Vivien Bouhey montre très bien, il est vrai, qu’au-delà de sa diversité, le mouvement anarchiste est fortement ancré dans la classe ouvrière. Il restitue également de manière convaincante les fluctuations des effectifs et les ruptures générationnelles. Loin de l’image du jeune militant célibataire et déraciné, le compagnon anarchiste est souvent « du coin », doté d’un métier, voire d’une famille – en somme, mieux enraciné que la légende anarchiste ne veut le reconnaître. C’est là un acquis du livre. L’anarchisme est bien, à n’en pas douter, une branche distincte du mouvement ouvrier, doté d’une solide base ouvrière, malgré la présence à sa tête d’intellectuels ou même d’aristocrates, comme le russe Pierre Kropotkine. Cette caractéristique permet de mieux comprendre certaines lignes de force de l’histoire anarchiste avant 1914 – sa proximité problématique avec les frères ennemis socialistes, la séduction du syndicalisme qui s’exerce sur lui, son attitude pendant l’affaire Dreyfus.
Cependant, lorsque l’auteur évoque les trajectoires individuelles des anarchistes passés à l’acte terroriste, les caractéristiques de l’idéal-type anarchiste resurgissent : célibat parfois contraint par le militantisme, marginalité sociale subie et/ou choisie, radicalité individualiste. Le cas de l’anarchiste belge Joseph Pauwels, tué par l’explosion accidentelle de la bombe qu’il portait dans l’église de La Madeleine à Paris, le 15 mars 1894, est très significatif à cet égard : né en 1864, marié en 1886, il s’est séparé de sa femme du fait de ses activités militantes qu’il pousse à l’extrémité de leur logique. Il y aurait ainsi une sorte de tension interne à l’anarchisme – entre sa base ouvrière qui le pousserait à l’organisation revendicative radicale, et une frange de marginaux qui en constituerait le versant individualiste spectaculaire. Sans doute faut-il se garder de prendre au mot les catégories d’« individus douteux » dressées par la police. Le terme « anarchiste » est aussi une étiquette placée sur des formes de déviance sociale violente dont le degré de conscience politique est inégal. L’auteur ne se confronte jamais vraiment aux difficultés évidentes que comporte cette assignation constante d’identité opérée par les services de police français. L’anarchiste offre un personnage idéal à l’esprit public, habitué par le XIXe siècle à penser les déviances sociales et identitaires les moins conformes au travers du schème de l’enquête.
L’effondrement presque complet du mouvement anarchiste en 1914 est constaté, sans être vraiment interprété par Vivien Bouhey. En 1894-1895, le mouvement anarchiste s’était redéployé sous l’effet de la répression. Mais en 1914 ? En quoi le constat d’un « minimum » d’organisation anarchiste permet-il de comprendre l’effondrement anarchiste du début de la guerre ? Faut-il conclure avec l’auteur que le mouvement anarchiste a fait « beaucoup de bruit pour rien » (p. 432) ? Sur l’insoumission ouvrière et la sociologie des insoumis, qui nous fait toujours défaut pour comprendre tout à fait le moment 1914, le livre n’apporte malheureusement que peu d’éléments. Malgré la qualité de certains de ses développements et la clarté de sa démarche, l’ouvrage de Vivien Bouhey laisse bien des interrogations en suspens.
http://mouvement-social.univ-paris1.fr/document.php?id=1488
mis en ligne le 28 juin 2009
Vivien Bouhey, Les Anarchistes contre la République, 2008. Constance Bantman, Anarchismes et anarchistes en France et en Grande-Bretagne (1880-1914), 2007.
Vivien Bouhey, Les Anarchistes contre la République, contribution à l’histoire des réseaux sous la Troisième République (1880-1914), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, 491 pages. Constance Bantman, Anarchismes et anarchistes en France et en Grande-Bretagne, 1880-1914 : Échanges, représentations, transferts. Thèse sous la direction de François Poirier, Université de Paris XIII-Villetaneuse, 2007, 730 pages.
Dans son Histoire du mouvement anarchiste en France, Jean Maitron use d’une formule peu heureuse, quand il écrit que de 1882 à 1894 « il n’existe que des groupes locaux, sans liens entre eux ». Affirmation bien vite démentie par ce qu’il écrit ensuite sur les tournées de conférences ou la diffusion des journaux anarchistes. Mais affirmation prise à la lettre – pour la contester – par Vivien Bouhey, qui croit pouvoir démontrer qu’il aurait existé des comités secrets, un réseau efficace, des chefs et des exécutants disciplinés. Constance Bantman, quant à elle, relève « l’irréalisme » de cette théorie, le mythe récurrent « d’une organisation tentaculaire préparant la révolution depuis Londres » notamment (p. 318). Tous deux ont fait un énorme travail de lecture des périodiques, de dépouillement d’archives et d’analyse des travaux antérieurs sur la période considérée. Ils en tirent toutefois des enseignements bien différents ; pour des questions de méthode, essentiellement.
Bouhey parle de « réseaux » dans son titre, mais il traite surtout d’associations de malfaiteurs, de pôles structurants, de concertation, sans discuter de la notion d’organisation d’un point de vue politique ou sociologique. Ses anarchistes ont peu de chair, rarement un prénom ou une biographie ; leurs relations de groupe, de « clique », voire de complot n’ont guère plus de réalité. Tout serait parti selon l’auteur d’une réunion secrète à Vevey, en septembre 1880, qui aurait prôné l’étude et l’application des « sciences techniques et chimiques ». Il recopie Maitron, qui citait à la légère un « rapport sans date » conservé aux Archives nationales1. Or, il est facile de constater qu’il s’agit là d’une brève synthèse rédigée douze ou quinze ans après les faits : rien d’étonnant si le mouchard mélange une résolution adoptée à Londres en 1881 avec un prétendu programme antérieur d’un an. Les hommes réunis à Vevey étaient en fait surtout des Allemands, partisans de la Freiheit de Johann Most, et même la grande enquête suisse de 1895 sur les menées anarchistes n’y accorde guère d’importance2. Maitron avait fait l’erreur de ne relever que les noms des Français (hormis Kropotkine) qui y auraient participé, et Vivien Bouhey n’a pas pris la peine de vérifier sur pièces ; il aurait constaté que l’auteur du rapport contredit sa thèse, puisqu’il conclut que « l’autonomie de ces groupes est la seule chose qui rende très difficile la surveillance et la découverte des attentats ».
Bouhey cite systématiquement les sources policières sans les vérifier ni les croiser avec aucune autre. « Si l’on synthétise les informations rapportées par les indicateurs londoniens tout au long de l’année 1893, Malato, Malatesta et surtout Marocco paraissent au centre des opérations décidées sur le continent », affirme-t-il péremptoirement (p. 273). Ces « informations » proviennent essentiellement de deux dossiers de la Préfecture de police parisienne (BA/1503 et 1504). Le rapport qui les résume dit textuellement : « Un comité directeur établi à Londres donne le mot d’ordre à la faction : ses principaux membres sont Kropotkine, Malatesta, Malato, Marocco etc. »3 Que penser de ce raccourci ? Le nom de Pierre Kropotkine n’est pas retenu par Bouhey, bien qu’il soit un de ces « hommes de Vevey » qui le fascinent. Les mouvements d’Errico Malatesta à Londres étaient surveillés au jour le jour par des agents de la police italienne, dont les rapports sont connus et documentés par Giampietro Berti ou Carl Lévy dans des travaux solides4, mais il faut lire l’italien ou l’anglais. Charles Malato, qui fut mêlé à certaines actions « illégalistes », a raconté avec franchise ses Joyeusetés de l’exil5. Quand à Alexandre Marocco, Égyptien d’Italie établi à Londres, il est probablement plus receleur qu’anarchiste, utile pour écouler les marchandises volées : on fréquente donc sa boutique. Un an plus tard, son nom est négligemment remplacé dans les rapports de police par celui de Saverio Merlino – bien que ce dernier se trouve alors en prison en Italie. Londres serait ainsi une des « vraies bases arrières du terrorisme international » (Bouhey, p. 213) ?
L’absurdité des allégations policières n’aurait pas été difficile à contrôler. Placide Schouppe se serait évadé de Guyane en même temps que Pini, lequel est repéré à Liverpool en 1898 (Bantman, annexe 2) ? Pauvre Vittorio Pini, qui s’était fait reprendre à Paramaribo déjà, et mourut au bagne en 1903 sans plus jamais parvenir à en sortir… Clément Duval rapporte que pendant qu’Emile Henry « faisait parler la dynamite […] un crâneur idiot se faisait interviewer par des journalistes, se donnant comme étant Pini, sur le compte duquel tombèrent les attentats. Toute la presse parla tellement de Pini que l’administration s’en émut, et le gouverneur de Guyane vint aux Îles pour s’assurer que Pini était bien là et non en France »6. Les soi-disant aveux de Charles Bernard en 1900 (Bouhey, p. 407-408), donnant le Journal du Peuple de Sébastien Faure pour le centre d’une vaste organisation de malfaiteurs, sont si invraisemblables qu’il aurait mieux valu ne pas s’y arrêter. Parmi les nombreux lieux de réunion mentionnés, le débit de vins de Louis Rousseau, rue Saint-Martin à Paris, devient la « salle Rousseau, rue du Faubourg Saint-Martin », voire la salle Jean-Jacques Rousseau. Je pourrais multiplier les exemples.
La propagande par le fait va de pair avec la propagande par l’écrit et la parole. Visites, échanges, tournées de conférences, diffusion des journaux font partie du quotidien militant, hier comme aujourd’hui. Constance Bantman, à la suite de Maitron, qualifie les propagandistes itinérants de trimardeurs, un terme utilisé par la presse de l’époque ; Vivien Bouhey en fait des « gyrovagues » diffusant un « évangile » ; il les cite « au hasard des sources » (p. 50) tout en leur attribuant des « stratégies » (p. 311). Le tableau est peu cohérent : Sébastien Faure est un conférencier quasi professionnel ; Robert Lafon dit Lanoff est chansonnier, il voyage donc par métier ; parmi les personnages cités, certains ont déménagé deux ou trois fois, d’autres ont bien fait des tournées de conférences, mais cela ne suffit guère à en faire des moines errants. On retrouve sans cesse chez Bouhey, qui a été fort mal conseillé et encadré, cette lecture biaisée et ces interprétations abusives des sources. Pour parler de la multiplication des tendances dans la première décennie du xxe siècle, il se réfère aux « contemporains », à « quelques observateurs du mouvement » (p. 394-395) et définit cinq manières individualistes, cinq tendances communistes et des inclassables ; or il se fonde sur quatre rapports réunis dans un unique dossier de la Préfecture de police (BA/1498, 1900 à 1910). C’est bien court pour refléter les avis des contemporains. Pour la dernière période, Bouhey entre enfin en matière sur la question de l’organisation, citant un certain nombre de débats bien connus. Mais il est difficile de comprendre le pourquoi de ces débats, qui semblent rester purement formels, par exemple lorsque est mises sur le même pied la constitution d’un groupe néomalthusien et celle d’un syndicat.
Constance Bantman, qui distingue deux grandes périodes, donne dans sa troisième partie des éléments passionnants de comparaison entre syndicalismes français et britanniques. Les réseaux, pour elle, ce sont les échanges, les visites, les traductions, la solidarité. Les acteurs sont identifiés par de très brèves biographies, résumés exemplaires d’un grand nombre de sources et de travaux. Enfin, par le cadre théorique qu’elle lui donne, son travail est largement contextualisé et mis en perspective, contrairement à celui de son prédécesseur.
N’imputons pas à Vivien Bouhey la préface de son directeur de thèse ni la quatrième de couverture de son ouvrage, elles sont conformes aux lois du genre et du marché. On pourrait même lui passer les graves défectuosités et lacunes de l’index, qui peuvent être le fait de l’éditeur. Il reste que ce livre est tissé d’approximations et d’incohérences. Bien heureusement, l’internationale terroriste anarchiste n’a pas réussi à faire trembler la République sur ses bases.
Marianne Enckell
1 Archives Nationales, F7 12504. Je remercie Anne Steiner pour la transcription du texte.
2 Berne, Feuille fédérale 1885, aisément consultable en ligne, et en français.
3 AN, F7 12504, rapport du préfet de la Seine en réponse à la circulaire du 13 décembre 1893, cité par Constance Bantman, p. 318.
4 Voir notamment G. Berti, Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale, 1872-1932, Milano, Franco Angeli, 2003 ; C. Levy, « Italian anarchism, 1870-1926 », in : D. Goodway (dir.), For anarchism, history, theory and practice, Londres, Routledge, 1989.
5 Ch. Malato, Les Joyeusetés de l’exil : chronique d’un exilé à la fin du 19e siècle ; Paris, Stock, 1897 (rééd. Acratie, 1985).
6 C. Duval, Moi, Clément Duval, bagnard et anarchiste, Paris, Éditions ouvrières, 1991, p. 184.
N°23
Automne 2009
Vivien Bouhey. – Les Anarchistes contre la République, contribution à l’histoire des réseaux sous la Troisième République (1880-1914), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, 491 p. 24 euros de trop.
En page 4 de couverture, l’éditeur dit que l’auteur s’est intéressé à ce sujet en raison des « questions posées ces dernières années aux historiens et aux journalistes par le développement de mouvements terroristes dans le monde ». Sa méthode fonctionne-t-elle pour l’histoire récente ?
Je connais une revue sous le couvert de laquelle se regroupent aujourd’hui des repris de justice (quelle perversité d’avoir nommé directeur un avocat !), des personnes aux sources de revenus peu claires, des spécialistes de l’internet douteux, des gyrovagues (cherchez dans le dictionnaire ; la police belge les appelle « péroreurs meetinguistes », c’est plaisant), voire des étrangères, à en juger par leurs noms de famille. Le financement de cette revue luxueuse n’est avoué nulle part ; les rédacteurs et leurs invités logent sans payer dans plusieurs capitales du monde, sans doute pour donner des directives à leurs troupes. Et les articles vantant la propagande par le fait et l’action directe ne se comptent plus.
C’est ce genre de « méthode » qui a donné à Vivien Bouhey un titre de docteur en histoire à Paris-Nanterre et qui lui permet d’affirmer que les anarchistes sous la Troisième République étaient constitués en réseaux, avec des chefs qui tiraient les ficelles depuis Londres, Paris et Genève.
Que l’auteur n’ait aucune empathie pour les anarchistes, libre à lui. Mais qu’il ne sache pas faire une lecture critique des textes est moins admissible. Informations provenant de mouchards ou d’indicateurs, interrogatoires d’inculpés, lettres saisies, voire rapports de synthèse des autorités, il donne à tout ce matériau la même valeur, la même vérité, comme si cela constituait un ensemble permettant de démontrer l’existence d’une association de malfaiteurs au niveau international.
On comprend que l’ouvrage soit apprécié sur la Toile, sur des sites comme amis-de-la-police ou Criminocorpus ; ne lui manque que le délicat site consacré à la guillotine.
Il est notoire qu’il y eut des anarchistes cambrioleurs à cette époque comme à d’autres – et qu’il était aisé pour la police de qualifier d’ « anarchiste » le premier marginal venu -, les produits des vols pouvant servir à la survie ou à la solidarité. On sait toutefois depuis longtemps que les inculpés mentent ou déforment les faits ; que les indicateurs en rajoutent ; qu’il suffit d’être signalé deux fois à la police ou à la justice pour devenir un « anarchiste particulièrement dangereux », dans les catégories de ces dernières. Qui ne devraient pas être celles de l’historien.
Marianne Enckell
On trouve en ligne des comptes rendus plus sérieux de cette histrionnerie : http://www.laviedesidees.fr/Ni-Dieu-ni-maitre-ni-organisation.html (Romain Ducoulombier) ou http://mouvement-social.univ-paris1.fr/document.php?id=1488 (moi-même).
Tags: Alexandre Jacob, anarchie, anarchisme, archives, attentat, Charles Bernard, complot, en-dehors, Ernest Saurel, Jean Garrigues, L'Histoire, La vie des idées, Le mouvement social, Marianne Enckell, organisation, PUF, PUF Rennes, RA Forum, Réfractions, réseau, Romain Ducoulombier, Vivien Bouhey, vol
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail

 Réfractions
Réfractions
