Les Bagnes de Maurice Garçon
 Le 4 janvier 1968, André François Poncet dresse un portrait pour le moins dithyrambique de l’immortel pourtant trépassé six jours plus tôt. Maurice Garçon, Homme de lettres et ancienne vedette du barreau de Paris était né à Lille le 25 novembre 1889. Devenu avocat en 1911, il a acquis bâti sa notoriété sur une extraordinaire éloquence lors de procès retentissants, défendant entre autres Louise Landy, René Hardy, Georges Arnaud ou encore Jean Jacques Pauvert. L’homme était-il aussi attaché aux valeurs humanistes et aussi prompt à dénoncer les injustices que semble le prétendre le directeur de l’Académie Française prononçant son éloge funèbre ?
Le 4 janvier 1968, André François Poncet dresse un portrait pour le moins dithyrambique de l’immortel pourtant trépassé six jours plus tôt. Maurice Garçon, Homme de lettres et ancienne vedette du barreau de Paris était né à Lille le 25 novembre 1889. Devenu avocat en 1911, il a acquis bâti sa notoriété sur une extraordinaire éloquence lors de procès retentissants, défendant entre autres Louise Landy, René Hardy, Georges Arnaud ou encore Jean Jacques Pauvert. L’homme était-il aussi attaché aux valeurs humanistes et aussi prompt à dénoncer les injustices que semble le prétendre le directeur de l’Académie Française prononçant son éloge funèbre ?
Maurice Garçon avait profondément réfléchi à la justice, aux problèmes qu’elle soulève, aux institutions dans lesquelles elle prend corps. Il ne cessait de penser aux moyens de l’affermir et de la purifier, toujours prêt à protester par la parole et par la plume contre les abus commis en son nom et à défendre les droits de l’homme et du citoyen. De cette activité subsistent d’innombrables articles de journaux, brochures et livres de toute sorte.
Le 24 mars 1929, Alexandre Jacob écrit à son ami Eugène Humbert et lui annonce la tenue d’un débat contradictoire sur le mécanisme éliminatoire de la transportation. L’anarchiste, ancien bagnard, espère pouvoir convier comme adversaire – qui est l’apôtre de ce régime – Maurice Garçon. Le choix du célèbre avocat s’explique alors aisément. Ce dernier, « toujours prêt à défendre les droits de l’homme », a donné quatre ans plus tôt un long papier au magazine Le Mercure de France que lit assidument Alexandre Jacob. Avec l’article Les bagnes, il prend ouvertement la défense du système pénitentiaire français remis en cause, selon lui, par une espèce d’hypocrite sentimentalisme issu du reportage d’Albert Londres en 1923.
Après avoir retracé à grands traits l’histoire carcérale française, Maurice Garçon s’insurge contre l’idée d’une suppression du bagne dans le contexte de crise et surtout d’une insécurité qu’il juge réelle. Le retour des bagnards, et pire encore des libérés, devient de facto inopérant pour le spécialiste pour qui l’institution pénitentiaire coloniale serait viable si ses agents faisaient preuve … de plus de sévérité. Car l’auteur aimerait voir le bagne s’humaniser plutôt que disparaître ! De toute façon, nous dit-il, la métropole n’a pas les moyens de construire massivement de nouvelles prisons.
Maurice Garçon propose finalement une conception pénale classique : l’auteur estime que, si une société veut survivre au crime, le criminel doit être châtié à la hauteur – et même au-delà – du crime commis : Avant tout, la société a pour devoir impérieux de se préserver, et si, la peine faite, le malfaiteur reste un danger, il le faut éloigner : la transportation est le meilleur remède qui ait été donné jusqu’à présent. De fait, les débats parlementaires ne viseraient qu’à apaiser l’opinion publique et si le bagne venait à être supprimer, il faudrait alors appliquer massivement la peine de mort. Mais la guillotine sèche ne meurt que treize ans plus tard. Le bagne demeure une machine à broyer les victimes d’une société qui répugne à prévenir le crime et le délit, et qui a opté pour l’élimination du délinquant. Pour Alexandre Jacob, comme pour le docteur Louis Rousseau, c’est encore le principe du Vae Victis qui prévaut.
Les six décrets des 18 et 3 septembre 1925 induisent quelques adoucissements. Le silence absolu et la mise aux fers sont supprimés. Le forçat quelle que soit sa classe peut désormais disposer d’un hamac et ne dormira plus a priori sur un bac flanc. Le libéré ne doit plus répondre qu’à un appel annuel et peut résider hors de Saint Jean du Maroni … Pour Louis Rousseau, la vieille habitude de répression perdure. Pour Maurice Garçon, le bagne est sauf. Il est mourant en réalité.
Mercure de France
n°638, 15 janvier 1925, p.308-331
LES BAGNES
Le Parlement sera prochainement saisi par le gouvernement d’un projet de loi tendant à la suppression de la transportation et de la relégation. La question est grave, mais elle n’est pas neuve et il est permis de s’étonner quelque peu de voir les pouvoirs publics la découvrir à la suite de l’enquête d’un journaliste à la Guyane et d’une campagne de presse.
L’affaire a fait grand bruit. M. Albert Londres, rédacteur au Petit Parisien, ayant obtenu l’autorisation de visiter les bagnes, a passé quelques semaines dans les pénitentiers. Il en a rapporté un récit où il a déployé tout son talent et qui est digne d’émouvoir. L’opinion s’est émue grandement. Avec trop de hâte elle a cru trouver le remède dans la suppression pure et simple de l’institution.
Le ministre a désigné une commission chargée d’examiner les résultats actuels de la transportation et de proposer les modifications qui paraîtraient utiles. Cette commission travaille, mais il semble que, dans sa hâte de satisfaire l’opinion, le gouvernement manque un peu de sang-froid. Il ne veut même pas attendre les résultats de l’enquête. M. René Renoult, ministre de la Justice, a prononcé le 28 septembre un discours à Toulon pour annoncer qu’il avait résolu de proposer aux Chambres une loi portant abrogation de l’exécution des peines aux colonies. M. Daladier, ministre des Colonies, a déclaré au cours d’une interview qu’il était convaincu de l’impossibilité d’améliorer le bagne et qu’il fallait radicalement le supprimer.
Déjà des mesures qui, nous le verrons, sont actuellement illégales ont été prises.
A l’heure où le Parlement va être appelé à statuer, il ne paraîtra pas inutile de rappeler les véritables données du problème. On paraît trop avoir oublié les raisons qui ont fait, en dépit de graves inconvénients, admettre ce principe de la transportation. On n’en montre que les inconvénients, on propose avec une inconcevable légèreté de supprimer une institution qui fut en son temps un progrès, pour la remplacer par un régime pénitentiaire déplorable qui n’a rien de nouveau, et que précisément on a dû abandonner en raison de ses dangers.
Il parait impossible de bien comprendre ce qu’est la transportation et d’en juger le principe si l’on.ne connaît, au moins dans ses grandes lignes, l’histoire des divers régimes pénitentiaires adoptés en France depuis deux siècles. On oublie trop, en effet, que le principe des bagnes coloniaux, tel qu’il est actuellement réalisé, n’a pas été conçu au hasard et sans avoir été précédé de longues expériences. C’est parce qu’aucune autre solution n’a donné satisfaction qu’on s’est résigné à considérer la transportation comme pouvant être le seul remède aux inconvénients graves que les autres systèmes avaient révélés.
M. Albert Londres, annonçant prématurément que le bagne était supprimé et que tous les forçats de la Guyane seraient, grâce à lui, ramenés en France, ajoutait :
Tout le problème de la répression renaît. Heureusement ! Depuis le moyen âge rien n’a été fait, sinon en paroles, dans ce domaine en France.
Assurément l’éminent journaliste a voulu plaisanter. Mais un pareil badinage est dangereux parce qu’il est susceptible de tromper l’opinion publique mal informée et souvent ignorante. Les travaux du XIXe siècle ont au contraire été considérables. S’il fallait énumérer seulement les ouvrages écrits sur la question, un gros volume y suffirait à peine des hommes de bien ont consacré de longues années à l’étude de la science pénitentiaire et lui ont fait en moins de cent vingt ans faire plus de progrès qu’on n’en avait fait pendant tous les siècles précédents.
Ce qui est vrai, c’est que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle rien n’avait été entrepris et qu’on s’occupait beaucoup plus des questions de répression que de la manière dont les peines devaient être exécutées.
La détention du coupable n’a pendant longtemps pas été considérée comme une peine. Jusqu’au XVIe siècle les prisons ne servaient pas aux châtiments des condamnés. Elles étaient réservées à la garde provisoire des prévenus et à la contrainte par corps.
Vers le début du XVIIe siècle, on organisa les premières maisons de travail pour les filles et les vagabonds. La prison était généralement un cachot obscur et puant. Elle était tenue dans le plus déplorable état « Le corps y souffrait, a dit Tocqueville, il y était fréquemment chargé de chaînes, la nourriture y était insuffisante et malsaine. On y était mal vêtu. On y couchait d’ordinaire sur la paille, on y endurait le froid et la faim. Toutes les précautions de l’hygiène y étaient inconnues d’une manière inhumaine : la mortalité y était très grande. »
Le pouvoir royal n’avait presque rien fait pour améliorer un tel état de chose. Le titre XIII de l’ordonnance de 1670 qui est relatif aux prisons, geôliers et guichetiers, signale surtout des abus. Souvent les hommes et les femmes étaient détenus dans une prison commune et l’ordonnance s’efforçait surtout d’empêcher les geôliers de voler les voleurs. Pour n’en donner qu’un exemple, l’article 14 défend aux gardiens, « sous prétexte de bienvenue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivre quand même il serait volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou les maltraiter ou excéder à peine de punition exemplaire ».
Une autre ‘ordonnance avait enjoint aux geôliers de changer la paille des prisonniers tous les mois si la prison était au jour, tous les quinze jours si elle était noire. C’était bien sans métaphore la paille humide des cachots.
La religion avait cependant essayé d’apporter des améliorations. La visite aux prisons était une œuvre recommandée par l’Eglise et des sociétés charitables s’étaient fondées :
Si l’on vient pour me voir, je vais aux prisonniers
Des aumônes que j’ai partager les deniers,
disait Tartuffe.
 Les criminels plus graves étaient envoyés aux galères. Ainsi le roi recrutait une partie de sa marine. La pratique en remontait, au moins au XVIe siècle. Charles IX, en l’article 104 de l’Ordonnance d’Orléans, avait enjoint aux Bohémiens ou Egyptiens, leurs femmes, enfants et autres de leur suite, de vider le royaume à peine des galères et de punition corporelle sans autre forme de procès s’ils étaient trouvés sur son territoire après un délai de deux mois.
Les criminels plus graves étaient envoyés aux galères. Ainsi le roi recrutait une partie de sa marine. La pratique en remontait, au moins au XVIe siècle. Charles IX, en l’article 104 de l’Ordonnance d’Orléans, avait enjoint aux Bohémiens ou Egyptiens, leurs femmes, enfants et autres de leur suite, de vider le royaume à peine des galères et de punition corporelle sans autre forme de procès s’ils étaient trouvés sur son territoire après un délai de deux mois.
Un édit de Marseille en 1564 défendit ensuite tant aux cour souveraines qu’à tous autres juges de condamner aux galères pour un temps moindre de dix ans. L’absence de tout moyen anthropologique pour retrouver les récidivistes fit accompagner la peine de la flétrissure ou impression d’un fer chaud sur l’épaule droite. Quiconque, pour ne pouvoir servir sur le navire, se mutilait volontairement après la condamnation, voyait sa peine commuée en peine capitale.
Après l’ordonnance de 1670 on distingua deux espèces de condamnation aux galères celle à temps qui était de 3, 5, 6 ou 9 années et celle qui était prononcée à perpétuité.
Le régime était dur et inhumain. Les condamnés étaient d’abord livrés au supplice du fouet, puis conduits enchaînés de ville en ville jusqu’à leur destination. Ils étaient alors rivés à leur banc. Cette peine disparut avec les galères et en 1748 les condamnés furent employés aux travaux du port et des arsenaux.
Rien n’était tenté pour l’amendement du condamné.
La Révolution ne fit rien, sinon poser le principe de la suppression des peines corporelles et les remplacer par les peines privatives de liberté.
Le code pénal du 25 septembre 1791 maintint ce qui existait déjà sous le nom de peine des fers. Les condamnés à cette peine étaient employés à des travaux forcés au profit de l’Etat, soit dans l’intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l’extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles qui, sur la demande des départements, pourraient être déterminés par le corps législatif. Cette peine était temporaire et son maximum de 24 ans.
Le Code de Brumaire an IV maintin cette formule et le code Pénal de 1810 n’abandonna pas les bagnes. Son article 15 prescrit que les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles, qu’ils traîneront aux pieds un boulet ou seront attachés deux à deux avec une chaîne lorsque la nature du travail auquel ils seraient employés le permettrait.
La flétrissure demeurait : l’empreinte portait T. P. pour les travaux forcés à perpétuité et T. pour les travaux forcés à temps. On ajoutait un F. si le coupable était un faussaire.
Dès la Restauration une réaction se forma contre ce supplément de châtiment. Un magistrat écrivait en 1825 :
Cette marque indélébile, qui sépare à jamais le condamné du reste de ses semblables, ne le force-t-elle pas à en devenir l’ennemi et l’ennemi implacable ? Il faut donc enchaîner à jamais les hommes que l’on a flétris, ou si l’on se décide à leur rendre la liberté, il faut s’attendre à voir se former, au sein de la société, une société d’hommes féroces, unis entre eux par un lien d’infamie, acharnés au crime par l’impossibilité même de se réhabiliter.
La loi du 28 avril 1832 supprima cette aggravation de peine le rapporteur s’était exprimé ainsi :
La marque, flétrissure ineffaçable, est inconciliable avec une peine temporaire et ne se concilie pas mieux avec une peine perpétuelle que la Grâce peut abréger et que la réhabilitation peut effacer. La marque dégrade le condamné de l’humanité, supplice irréparable que les souvenirs du criminel lui retracent et lui infligent à toute heure, qui décourage le repentir et désespérerait la vertu, et qui, n’ayant pas même l’utilité d’un avertissement public puisque l’empreinte est cachée, n’a d’autre avantage que d’être un moyen de police, en cas de soupçon, et un signalement d’infamie.
Ce qu’étaient les bagnes ? Il faut se reporter aux écrivains de la Restauration et du gouvernement de Juillet pour le connaître. Témoins oculaires ils en ont laissé des descriptions saisissantes. Déjà, au temps de Charles X, Saint-Edme écrivait dans son Dictionnaire de la pénalité :
Le scélérat incorrigible, l’homme seulement égaré, la victime de l’erreur de l’opinion, le criminel de convention, tel que le bigame, enfin tous les délits qui graduent le crime, sont proclamés, et chaque condamné peut opter entre tous les forfaits des moyens d’instructions dans chacun lui sont offerts : le faussaire pourra apprendre du voleur comment se fait une fausse clef, comment se crochette une porte ; le voleur à son tour apprendra du faussaire à calquer une signature, à faire des compositions chimiques qui enlèvent l’écriture en même temps qu’elles collent le papier et lui conservent sa couleur : l’insubordonné pourra devenir faux monnayeur et le bigame empoisonneur.
On fait d’une maison instituée pour corriger des hommes en les châtiant, un moyen de perversité, une école du crime, d’où ils sortent presque toujours des monstres, quoiqu’ils n’y soient souvent entrés qu’égarés…
… La grande affaire des gardiens d’une chiourme est d’empêcher l’évasion des parias.
Ainsi se trouvait posé un double problème. D’abord celui de la contagion criminelle venue d’une promiscuité dangereuse et qui fit inscrire en épigraphe d’une brochure anonyme parue en 1823 sous le titre Considération sur les Bagnes : « On y entre égaré, l’on en sort coupable. » Ensuite la crainte du libéré et de l’évadé qui constituait un danger permanent pour la société. Cette crainte du forçat redevenu libre se trouve dans toute la littérature pénitentiaire de la première moitié du siècle, et dans certains auteurs elle est décrite de façon saisissante.
Autour des bagnes, dans les campagnes, des bandes s’organisaient, sans cesse grossies de nouveaux libérés ou d’évadés. Ils répandaient la terreur, se livrant à d’abominables excès et à de redoutables forfaits. Parfois un coup de canon tiré dans la maison de force annonçait à la ville une évasion nouvelle c’était pendant quelques heures une chasse ardente. On savait le péril social causé par le bandit en rupture de ban, et lorsqu’il échappait aux recherches, on attendait avec angoisse la marque de son passage dans quelque crime éclatant.
Paris était souvent le plus sûr refuge, une vaste fraternité réunissait les anciens compagnons de chaîne, créant d’utiles complicités pour le plus grand trouble de la sécurité publique.
Sans doute des œuvres excellentes s’étaient formées qui s’efforçaient d’introduire un peu de moralité dans la conscience .des condamnés pendant leur séjour au bagne. L’organisation même des établissements rendait vains les plus louables efforts.
Pour être juste, une considération s’impose toutefois. Il ne faut pas oublier que les travaux forcés s’appliquent aux plus grands crimes, mais qu’il est des degrés dans l’infraction. S’il est vrai que les délinquants condamnés à des peines correctionnelles peuvent souvent être ramenés au bien et que rien ne doit être négligé pour leur amendement, tout autres sont des délinquants punis de peines afflictives et infamantes dont quelques-unes sont perpétuelles et dont les moins longues ont encore une durée très appréciable. Les infractions qu’elles répriment sont particulièrement graves.
Pour ceux-là, l’idée de prison moralisatrice n’est souvent qu’une dangereuse utopie. Enfermés à perpétuité ou au moins pour de longues années, il ne s’agit pas de leur imposer une peine expiatrice. Il n’appartient point aux hommes de faire expier : le croire, c’est confondre la morale avec le droit positif.
La société serait impuissante à infliger une peine purement expiatoire et à mesurer cette peine à la culpabilité. La culpabilité morale ne peut être appréciée par les hommes.
Sans doute la peine peut avoir un certain caractère expiatoire, mais, au point de vue positif du droit, ce caractère n’est ni le seul ni même le principal.
 La Société a d’abord, et au premier chef, le droit et le devoir de se défendre et, en y regardant de près, on voit que chaque infraction crée un double péril social : il y a à craindre que le malfaiteur, qui a déjà montré que le précepte légal ne l’arrête pas, renouvelle sa mauvaise action, et il faut redouter aussi que d’autres hommes encouragés par son exemple l’imitent.
La Société a d’abord, et au premier chef, le droit et le devoir de se défendre et, en y regardant de près, on voit que chaque infraction crée un double péril social : il y a à craindre que le malfaiteur, qui a déjà montré que le précepte légal ne l’arrête pas, renouvelle sa mauvaise action, et il faut redouter aussi que d’autres hommes encouragés par son exemple l’imitent.
Si, donc la loi veut frapper utilement, il faut que la peine soit exemplaire et réformatrice.
Exemplaire, elle doit produire un mal que tout le monde redoute. Rossi dit :
L’exemple est très utile lorsqu’au sentiment de la crainte se joint une impression morale, solennelle et durable. Il est efficace lorsque l’exécution de la peine suit de près le délit et qu’elle est publique.
Ainsi la peine est moins un châtiment individuel qu’un remède social. Le coupable doit être frappé parce qu’il a commis l’infraction, alors même que le juge aurait la certitude qu’il ne récidiverait pas, parce que l’impunité crée le péril.
Les législations primitives l’ont si bien compris que leurs peines ont toujours été d’une sévérité excessive et cruelle, entourée souvent d’un appareil solennel afin de mieux intimider. Lorsque la civilisation se perfectionna et que le pouvoir social eut été plus fortement organisé, l’exemplarité résulta moins de la sévérité du châtiment que de la sûreté dans la répression : mieux la police judiciaire est organisée, moins le châtiment a besoin d’être rigoureux. Ainsi c’est moins l’homme coupable qu’on punit que ceux qui pourraient le devenir qu’on effraie. Plus le crime est grand, plus la crainte inspirée doit être considérable. Il vaut assurément mieux prévenir que réprimer, et l’on doit malheureusement compter sur la crainte révérencielle du châtiment comme un moyen efficace de prévenir.
Mais la peine n’a pas atteint son but complet lorsqu’elle n’a été qu’exemplaire elle doit encore, nous l’avons dit, être réformatrice. Elle doit tendre à l’amendement du coupable. Lorsque le délinquant sort de la prison où il a été enfermé, il faut qu’il rentre corrigé dans la société. Il faut qu’il soit instruit de ses devoirs et ne se laisse plus entraîner à commettre de nouveaux délits : Parum est coercere improbos poena nisi probos efficias disciplina.
Si le condamné revient au bien, s’il a compris la nécessité de se plier aux exigences sociales, le but est atteint, mais il faut reconnaître que le problème qui commence avec la libération du délinquant est le plus grave et le moins aisé à résoudre. La question du libéré est une des plus angoissantes de la science pénitentiaire.
La prison, a dit Lamartine, est une impasse et un criminaliste a trouvé cette formule exacte « Le difficile n’est pas d’emprisonner un homme, c’est de le relâcher. »
Tant qu’il est détenu, le condamné n’offre plus de véritable danger social, mais le danger recommence lorsqu’on lui rend la liberté s’il n’est pas amendé. Ainsi s’impose cette idée que la simple peine privative temporairement de liberté constitue parfois une défense insuffisante et qu’en l’absence d’une peine perpétuelle qui ne peut être envisagée pour telle infraction déterminée, l’organisation sociale doit trouver une solution nouvelle : elle ne peut tolérer la présence libre d’un élément dangereux qui a fait les preuves de son irréductible indiscipline.
De même que l’organisme se défend et élimine les poisons qui lui sont néfastes, de même la société doit, avec regret mais sans s’attendrir, éliminer les individus qui constituent un danger permanent, même s’ils ont terminé la peine dont la loi les a frappés.
C’est la conception de peine éliminatoire : elle est nécessaire et n’est pas neuve. Les Romains avaient connu la relegatio in insulam.
Dans les temps modernes, l’Angleterre a donné l’exemple. De bonne heure elle avait compris que certains criminels ne pouvaient plus être tolérés dans le cadre social et devaient en être chassés. Maîtresse en Amérique de pays, neufs, lointains, et de vastes colonies non peuplées, elle songea à y envoyer les individus dangereux pour la métropole. En même temps qu’elle prenait une mesure de salubrité, elle espérait que, sous un ciel nouveau, loin des tentations qui avaient fait succomber le délinquant, celui-ci trouverait des forces pour se reclasser.
En 1718, le Parlement adopta un bill qui ordonnait de déporter dans les colonies de l’Amérique septentrionale les individus condamnés à une détention de trois ans et au-dessus. Le but de cet acte législatif était bien plutôt de trouver un réceptacle pour les malfaiteurs de la vieille Angleterre que de contribuer à l’amendement des condamnés et à la prospérité des établissements coloniaux.
Le résultat fut déplorable. Jamais mesure n’a été plus mal ordonnée que le système de déportation suivi à cette époque. De nombreuses plaintes parvinrent en Angleterre de toute l’Amérique du Nord, et Franklin s’écria :
En vidant vos prisons dans nos villes, en faisant de nos terre l’égout des vices dont les vieilles sociétés de l’Europe ne peuvent se garantir, vous nous avez fait un outrage dont les mœurs agrestes et pures des colons auraient dû les garantir. Que diriez-vous si nous vous envoyions nos serpents à sonnettes ?
Ce grief ne fut pas sans influence sur la révolte de l’Amérique anglaise.
Après 56 ans d’expérience, l’Angleterre supprima la transportation en 1775 en raison de la guerre maritime et de l’insurrection des colonies. Cette suppression fut décidée à regret. La métropole avait eu lieu de se féliciter de l’éloignement de ses convicts, et au bout de quelques années il fut décidé d’y recourir à nouveau. On songea au Canada, mais on dut y renoncer en raison de la proximité des nouveaux Etats dont l’indépendance avait été proclamée en 1783.
L’Australie venait d’être explorée par Cook en 1770.
Le ministère de Georges III, résolu à coloniser, voulut que la déportation précédât l’émigration, et le commodore Arthur Phillip, chargé du premier convoi, mit à la voile le 13 mai 1787. Il emmenait 11 navires portant 575 hommes, 192 femmes et 18 enfants qu’on avait laissés avec leurs parents. Le 18 janvier 1788 il jetait l’ancre devant la terre nouvelle. Les convicts furent débarqués et par eux fut créée la ville de Sydney.
Sir Arthur Phillip éprouva d’abord les plus grandes difficultés à organiser sa colonie pénale. La population disparate, dangereuse et criminelle dont il disposait, rendait particulièrement difficile l’emploi de la main-d’œuvre. A force d’effort et d’énergie, la colonie initiale accrue de nouveaux arrivants devint pourtant prospère. Les résultats furent excellents. Mais à mesure que le pays devenait peuplé et organisé, les inconvénients précédemment constatés en Amérique réapparurent. Les colons libres élevèrent des protestations et refusèrent de continuer à recevoir le rebut de la population anglaise qui apportait le trouble dans une population calme. On comprenait la nécessité d’une discipline sociale.
L’Angleterre dut renoncer à la transportation en 1863 et revenir à ses anciens errements. Les condamnés restèrent dans la métropole et subirent une peine de détention baptisée du nom de servitude pénale.
II est bien nécessaire, étudiant le système de la transportation, de marquer clairement la raison qui fit abandonner à nos voisins d’outre-Manche l’institution que la France a conservée jusqu’à ce jour. C’est seulement parce qu’elle n’a plus trouvé de colonie pour recevoir ses condamnés, que l’Angleterre a conservé chez elle ses bagnards. C’est devant le mécontentement des colons libres, mécontentement qui menaçait de tourner en révolte, que l’Angleterre dut céder mais au congrès de Stockholm, plus de trente ans après la suppression de la transportation, Sir Georges Arney, ancien grand juge à la Nouvelle-Zélande et délégué de ce pays, vint affirmer :
C’est sous la pression de l’opposition des colonies que la transportation a été abandonnée en Angleterre et non parce que le système a été reconnu mauvais.
C’est à l’exemple de l’Angleterre, devant la faillite des bagnes métropolitains, en raison aussi et surtout de la terreur inspirée par les libérés et les évadés, dont la récidive atteignait 95% que la France résolut d’adopter le système de la colonisation pénale.
Déjà en 1828 le gouvernement l’avait mis à l’étude sur le vœu exprimé par la majorité des conseils généraux. Puis on l’avait abandonné et repris plusieurs fois. Le 12 novembre 1850, le Prince Président avait dit dans son message :
Six mille condamnés, renfermés dans nos bagnes, grèvent le budget d’une charge énorme, se dépravent de plus en plus et menacent incessamment la société. Il semble possible de rendre la peine des travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et en même temps plus humaine, en l’utilisant au progrès de la colonisation française.
Une loi fut mise à l’étude. L’exposé des motifs est très significatif. On peut y lire :
De redoutables associations se forment au sein même des bagnes pour l’exploitation du bagne. C’est la guerre organisée contre la société. Il n’y a pas de remède en France contre cette plaie profonde, incurable. On ne peut en débarrasser le pays qu’en la portant au loin, par delà les mers, sur quelque terre où le forçat trouvera les moyens de vivre sans crime, du prix de son travail, où la loi lui fera ces moyens s’il ne s’en montre pas indigne, et l’aidera, par de sages combinaisons, à se créer, dans sa nouvelle patrie, des intérêts de famille et de propriété. C’est le système de colonies pénitentiaires appliqué à l’exécution de la peine des travaux forcés.
Ainsi fut votée la loi du 30 mai 1854 qui institua que la peine des travaux forcés serait, à l’avenir, subie dans des établissements créés par décrets sur le territoire d’une ou plusieurs possessions françaises autres que l’Algérie.
Cette loi envisageait un régime progressif, disposant que les forçats seraient employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d’utilité publique, mais que ceux qui se rendraient dignes d’indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourraient obtenir l’autorisation de travailler soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales et que même ils pourraient obtenir des concessions provisoires de terrains avec la faculté de cultiver pour leur propre compte.
Ainsi la loi voulait encourager l’amendement des condamnés et s’efforcer de les amener à la vie régulière d’ouvrier et de cultivateur.
L’article 4 de la loi laisse facultative pour l’administration la transportation des femmes.
Tous les condamnés aux travaux forcés furent dirigés sur la Guyane, mais à la suite d’épidémies survenues en raison du manque d’hygiène, un décret du 2 septembre
1863 décida de changer et d’envoyer les délinquants à la Nouvelle-Calédonie.
Les résultats furent excellents. La métropole était débarrassée de la population dangereuse dont jusque-là elle n’avait jamais éprouvé que du trouble. Bien mieux, en 1885, voulant prévenir la récidive, les législateurs estimèrent qu’il fallait étendre à d’autres condamnations que celles des travaux forcés le principe de la transportation. M. Bérenger, dans l’exposé des motifs d’une nouvelle loi, exprimait clairement l’intention du législateur :
La multiplicité et l’audace croissante des attentats commis par des récidivistes, depuis longtemps signalées à la fois comme l’élément dominant de notre criminalité et comme la preuve de l’insuffisance de notre mode de répression, ont fini par frapper l’opinion publique. Des publications retentissantes, des manifestations nombreuses, sorties de tous les rangs de la société, ont, dans ces dernières années, réclamé avec instances des mesures préservatrices, contre le danger qu’un pareil état de choses fait courir à la sécurité publique et à l’ordre social.
 La loi du 14 août 1885 fut votée, établissant le principe de la relégation. Cette loi éloigne pour toujours les récidivistes incorrigibles condamnés à des peines courtes, mais nombreuses, et qui ne connaissent l’usage de la liberté que pour en abuser au préjudice des honnêtes gens. La relégation, peine éliminatrice et complément de la peine principale, parut un grand progrès elle résolvait pour les délinquants endurcis et non amendables la question si délicate de la libération.
La loi du 14 août 1885 fut votée, établissant le principe de la relégation. Cette loi éloigne pour toujours les récidivistes incorrigibles condamnés à des peines courtes, mais nombreuses, et qui ne connaissent l’usage de la liberté que pour en abuser au préjudice des honnêtes gens. La relégation, peine éliminatrice et complément de la peine principale, parut un grand progrès elle résolvait pour les délinquants endurcis et non amendables la question si délicate de la libération.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la peine subie à la Nouvelle-Calédonie fut acceptée avec enthousiasme par les condamnés. L’administration fit preuve d’une mansuétude exagérée. Le climat était doux, la vie agréable, et la peine exemplaire qu’on voulait infliger fut plutôt désirée par un grand nombre que redoutée. Une légende s’était créée qui présentait « la Nouvelle » comme un nouveau paradis terrestre.
On écrivit des récits romanesques pleins de descriptions enchanteresses ; des poètes mirent le bagne en chansons. On vit des condamnés à la peine de la réclusion assassiner des gardiens pour se faire condamner aux travaux forcés et être envoyés dans l’île du Pacifique.
Le danger devint si grand que, le 25 décembre 1880, il fallut voter un nouveau texte pour dire que lorsqu’à raison d’un crime commis dans une prison par un détenu, la peine des travaux forcés serait appliquée, la Cour d’assises devrait ordonner que cette peine serait subie dans la prison même où ce crime aurait été commis.
On était loin, comme on voit, des atrocités dont on parle aujourd’hui. S’il avait fallu élever quelque critique, c’eût été seulement en faveur de la sévérité.
Un décret du ministre des Colonies du 16 novembre 1889 répartit alors les condamnés entre la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, selon leur degré de perversité.
Depuis 1896 tous les bagnards ont été envoyés en Guyane où ils sont plus spécialement répartis dans la région du Maroni.
Un décret du 13 décembre 1894 permet à l’administration pénitentiaire de les transférer dans d’autres colonies et sous le nom de sections mobiles de forçats, pour y exécuter certains travaux. Il n’est pas mauvais d’indiquer que jamais aucune colonie n’a fait appel à cette main-d’œuvre redoutable qu’on veut nous ramener en France. Les territoires d’outre-mer auxquels on les a offerts à diverses occasions se sont toujours empressés de décliner l’offre.
Les forçats sont, au Maroni, répartis en trois classes et peuvent passer de l’une à l’autre selon leur conduite. La troisième est plus rigoureuse que la seconde et la première plus douce que la deuxième.
La troisième classe, par laquelle on débute, comprend une section d’incorrigibles soumis dans des camps disciplinaires à un régime particulièrement rude. Pour parvenir à la première classe, il faut déjà avoir subi une partie de la peine qui est en principe de deux ans pour les condamnés de dix ans au moins, de quatre ans pour les condamnés de plus de vingt ans, de cinq ans pour les condamnés de plus de vingt ans ou à perpétuité. Un décret du 4 septembre 1891, modifié par le décret du 26 février 1907, permet à l’administration d’abréger ces délais dans des cas exceptionnels.
La loi veut astreindre les forçats aux travaux les plus pénibles, mais en même temps elle veut permettre parfois « l’autorisation de travailler soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales ». En accordant une « concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte », on a bien donné l’indication que l’amendement du condamné ne doit pas être négligé.
Enfin et surtout, tout condamné à moins de 8 ans est astreint après sa libération à une résidence dans la colonie égale à la durée de sa peine, et ceux qui ont subi une peine de huit ans ou plus sont astreints à une résidence perpétuelle. Cette disposition résoud, au moins quant à la métropole, la question de la libération.
Ce fameux doublage dont on parle aujourd’hui avec tant d’indignation est, à la vérité, l’une des principales raisons de la transportation.
Si l’on examine la réglementation des bagnes, il semble qu’elle ait été conçue avec prudence. Ce serait pourtant une erreur de croire que son application est sans reproches.
Les protestations qui s’élèvent aujourd’hui, et qui sont légitimes, ne sont pas neuves. S’il naît un sujet d’étonnement, il doit venir de ce qu’on n’a point encore remédié à d’intolérables abus depuis longtemps connus et dénoncés et qui semblent montrer de la part de l’administration une coupable incurie.
Dans de nombreux congrès pénitentiaires et en particulier à celui de Paris de 1895, on avait signalé la mauvaise organisation des établissements du Maroni. Plusieurs condamnés libérés et qui avaient connu les rigueurs du régime, en avaient fait d’abominables récits. Citons notamment Eugène Grave dans son ouvrage Le Bagne[1] en 1901, Liard Courtois dans ses Souvenirs du Bagne[2]. Naguère encore, un excellent journaliste, M. Jacques Dhur, avait également jeté un cri d’alarme. M. Albert Londres, à la suite d’une enquête qui révèle une persistance inadmissible dans la mauvaise volonté de réparer les erreurs signalées, est enfin parvenu à émouvoir le gouvernement lui-même au point de le conduire à une exagération inconsidérée dans le choix des remèdes.
La vérité est qu’il faut presque tout changer à la Guyane et qu’on ne doit pas hésiter à reconnaître les lourdes erreurs qui ont été commises.
Les règlements sont excessifs. Après avoir connu une période humanitaire où le bagne n’en était plus un, on en fait aujourd’hui un véritable enfer.
Il faut d’abord bien nourrir les hommes et les bien vêtir. On avait cru devoir, en raison de leurs crimes, leur infliger de véritables souffrances physiques. Ce procédé, qui n’est jamais légitime, est intolérable sous un climat rigoureux. Au mois de mars dernier, sur un effectif de
4.495 détenus, 1.509 étaient à l’hôpital. C’est une proportion scandaleuse et qu’un régime sain doit faire cesser.
Pour cela il ne faut pas seulement changer le régime, mais aussi le personnel des gardiens. Il est d’observation que le contact des détenus et la nécessité d’appliquer sans cesse une discipline énergique donnent à ceux qui sont chargés de la surveillance sous un ciel tropical des habitudes d’autorité qui sont parfois inconciliables avec l’humanité. A vivre dans la promiscuité des forçats dont la moralité est souvent pire qu’on ne pourrait imaginer, les hommes sains se contaminent et montrent parfois une détestable perversité. Il conviendrait donc, par le changement fréquent des gardiens, de ne point leur laisser le temps de se démoraliser.
On propose actuellement d’établir pour chaque condamné un triple dossier judiciaire, pénitentiaire, et sanitaire. Judiciaire, il contiendrait des renseignements d’ordre généraux sur l’homme et l’avis motivé du président des assises et du magistrat qui a requis contre lui ; pénitentiaire, il ferait connaître les aptitudes professionnelles du forçat, ses antécédents et sa conduite dans les divers lieux de détention où il est passé ; sanitaire, il signalerait les tares du condamné, ses maladies, son passé physiologique et sa force physique.
Ce serait là une mesure excellente et qui permettrait à des administrateurs humains de mieux tirer parti de la population soumise à leurs soins.
On a trop compté sur la crainte pour maintenir l’ordre. Il faut plutôt tabler sur l’espérance d’un sort meilleur. La douceur vaut souvent mieux que la brutalité et la terreur.
Il faut surtout supprimer les châtiments actuels, les cachots sans air et sans lumière où les condamnés dépérissent sous un climat torride, supprimer le régime dit de réclusion cellulaire imposé dans certains cas à la suite de crimes commis au bagne même, défendre la mise aux fers et à la boucle, sinon dans les cas de violences où aucun autre moyen n’a pu être employé. Il faut aussi ne plus obliger au silence tel qu’il est actuellement imposé, même en dehors des heures de travail, ce qui est inhumain.
On pourra réduire les punitions à quelques jours de cellule, mais dans des locaux clairs, aérés.
La moralité est déplorable. Le bagne n’en a n’a malheureusement pas le privilège et, à ce point de vue, beaucoup de maisons centrales de la métropole n’ont rien à lui envier. Comment en pourrait-il être autrement alors qu’on sépare l’homme de l’humanité et qu’on enferme des corps jeunes dont la plupart, au temps de la liberté, avaient pris des habitudes d’excès qu’un brusque sevrage transforme en irrésistibles besoins ? On pourra essayer d’apporter quelque remède à ce mal certain en transformant toutes les organisations actuelles de couchage, en séparant le plus possible les condamnés pendant la nuit et en n’ayant point de ces tolérances véritablement infâmes comme celles que M. Albert Londres signale et contre lesquelles il s’élève avec une indignation facilement compréhensible.
Il reste, on le voit, beaucoup à faire dans le domaine du régime de la transportation : trop indulgente d’abord, la peine ne fut pas exemplaire ; trop sévère aujourd’hui, elle est devenue inconciliable avec les sentiments .humains que nous devons éprouver lorsque nous envisageons la nécessité d’assainir la société par l’éloignement de ses membres gangrenés.
 Mais s’il reste à transformer, est-il raisonnablement possible de supprimer ?
Mais s’il reste à transformer, est-il raisonnablement possible de supprimer ?
Déjà la question s’est posée, notamment en 1911 lorsque le sénateur Chautemps déposa une double proposition de loi tendant à supprimer la transportation et la relégation.
Les deux projets échouèrent parce qu’en vérité ils avaient le même inconvénient que celui actuel : ils voulaient détruire, mais ne proposaient aucune mesure raisonnable de remplacement.
Quels que soient les inconvénients très réels de la transportation, le principe comporte de très réels avantages.
Avant de ramener les forçats en France ou d’y maintenir ceux de l’avenir, il faudrait savoir où les loger. On parle des maisons centrales, il ne les faut pas croire extensibles à volonté. Leur contenance et leur effectif moyen sont les suivants :
Maisons centrales / contenance / effectif moyen
Beaulieu. 695 / 600
Clairvaux.1.253 / 750
Fontevrault 640 / 700
Loos 1.200 / 800
Melun 664 / 650
Nîmes. 887 / 550
Poissy. 1.050 / 800
Riom 600 / 450
Thouars. 522 / 400
TOTAL / 7511 / 5700
Il reste donc en temps normal environ 1800 places vacantes.
Encore cette disponibilité est-elle plus apparente que véritable. Il faut ajouter aux condamnés des ‘maisons centrales ceux qui sont autorisés par décision spéciale à subir leurs peines dans des établissements cellulaires et qui sont en moyenne au nombre de 400 environ : ils peuvent pour des raisons de service ou de discipline être replacés en maison centrale.
Il n’y a donc actuellement point d’établissements en France susceptibles de recevoir les forçats à moins que, oubliant qu’une des raisons données pour supprimer les bagnes coloniaux est l’effroyable promiscuité qu’on y impose, le Gouvernement songe à les loger dans les locaux dits de désencombrement. Ce sont dans les prisons de la Métropole de grandes salles prévues pour des cas exceptionnels, mais où rien n’est préparé ni au point de vue du couchage ni au point de vue de l’hygiène. Dans ces locaux où les forçats seraient entassés pêle-mêle, la promiscuité serait plus grande encore.
Il faudrait d’abord envisager la construction de nouvelles maisons de force, l’acquisition de tout le matériel administratif, de lingerie, d’approvisionnement et enfin la mise nécessaire à l’organisation du travail.
Ainsi les raisons qui avaient fait abandonner les projets anciens de réforme demeurent entières avec cette différence que l’augmentation du coût des choses rend, à l’heure actuelle, irréalisable un projet un peu sérieux.
Le défaut de toutes les déclarations actuelles du Gouvernement, c’est qu’après avoir très fermement affirmé le principe de la modification de la transportation et avoir annoncé que les condamnés resteraient provisoirement en France, ce qui est illégal, on oublie de dire où et comment.
Mais en supposant réalisée la réforme, en supposant résolues les questions de logement, d’organisation de la discipline et du travail des condamnés en France, le principal problème demeurerait encore sans solution Que fera-t-on des libérés ?
Tous les travaux des pénalistes du XIXe siècle ont tendu à mettre en lumière la distinction du délinquant d’occasion et du délinquant professionnel ou d’habitude.
Le criminel d’occasion n’est pas un insociable. Contre lui une peine est assurément légitime et nécessaire parce qu’elle doit être exemplaire, mais elle est surtout corrective, car on peut espérer ramener le délinquant au bien.
Tout autre est le criminel d’habitude. Pour celui-là l’idée de prison moralisatrice est un rêve dangereux. On a dit de lui qu’il était le délinquant professionnel, l’incorrigible.
On dit aussi, selon une expression assez juste, qu’il est en état dangereux.
Dans une théorie qui domine encore beaucoup de législations positives et qui survit dans la pratique, l’auteur d’un crime est puni pour expier l’acte mauvais qu’il a commis : la mesure de la peine est donc d’une part la gravité objective de cet acte et d’autre part son degré de culpabilité morale. Cette doctrine est d’autant plus forte qu’elle a ses racines profondes dans la conception théologique du péché.
Mais si l’on examine ses conséquences, on constate que partout elles ont été les mêmes : l’abus des courtes peines, l’affaiblissement de la répression et un accroissement redoutable de la criminalité. Pour prétendre mesurer la peine à la faute morale on trouve des excuses à tous les criminels.
Le droit pénal ne peut s’accommoder de ces faiblesses.
Pour fixer la peine, il faut tenir compte beaucoup moins de l’acte poursuivi, et remplacer cette considération par le concept nouveau de l’état dangereux. Contre ces délinquants on ne prononcera plus de peines correctives convaincues d’impuissance, on aura recours à des mesures de sûreté qui maintiendront l’ordre et la discipline sociale par l’élimination des malfaiteurs.
Il est une idée qu’on rencontre assez fréquemment et qui voudrait que le délinquant exécutant sa peine paye une dette à la société. La dette payée il serait quitte : cette idée est fausse.
La Société n’est pas en compte avec les malfaiteurs; la peine n’est pas le prix dont on rachète un crime.
 Avant tout, la société a pour devoir impérieux de se préserver, et si, la peine faite, le malfaiteur reste un danger, il le faut éloigner : la transportation est le meilleur remède qui ait été donné jusqu’à présent.
Avant tout, la société a pour devoir impérieux de se préserver, et si, la peine faite, le malfaiteur reste un danger, il le faut éloigner : la transportation est le meilleur remède qui ait été donné jusqu’à présent.
Revenu à la liberté, le condamné devra rester dans la colonie tantôt un temps déterminé, tantôt perpétuellement. Le laisser errer dans la métropole c’est lui créer, puisqu’il est en état dangereux, des occasions nouvelles de commettre de nouveaux forfaits, et mettre la société en état de moindre défense.
On objecterait en vain que l’interdiction de séjour empêcherait les malfaiteurs de revenir dans les agglomérations. Outre qu’il n’est pas nécessaire d’infecter les campagnes et les petites villes, l’interdiction de séjour est une barrière illusoire et une institution en faillite qui n’a jamais arrêté un bandit résolu.
C’est ce qu’avait parfaitement compris Waldeck-Rousseau lorsqu’il exprimait clairement qu’il voulait en finir avec les délinquants qui, par la répétition de leurs délits, avaient démontré leur impossibilité à s’adapter à la vie sociale.
Il fit voter la loi sur la relégation.
Peut-être n’est-il pas opportun de songer à supprimer cette prudente institution au moment où Paris, quelques grandes villes et certains départements même voient la criminalité augmenter et se multiplier avec une rapidité inquiétante.
Sans vouloir jeter un cri d’alarme inutile devant cette recrudescence de criminalité, on peut trouver imprévoyant un Gouvernement qui propose de supprimer la relégation et la transportation, seules peines qui garantissent sérieusement et efficacement la sécurité publique.
Une grande erreur a été de présenter la transportation comme une œuvre de colonisation. Ce principe anglais à l’origine est peu raisonnable. Les malfaiteurs sont en général paresseux et l’on ne doit pratiquement pas espérer grand’chose d’une main-d’œuvre mauvaise, composée de mauvais ouvriers qui n’ont pas su se soumettre pour la plupart à la discipline du travail libre. Il faut savoir voir le mal où il est. La main-d’œuvre est déplorable et ne fournira jamais qu’un travail déplorable.
Le principe qui doit dominer est celui de l’élimination pour toujours, afin que les honnêtes gens puissent vivre en paix. Si l’on peut tirer quelque chose des forçats, tant mieux mais on ne doit pas se leurrer, on n’en fera généralement rien de bon.
On doit les traiter humainement, apporter tous les soins possibles à leur amendement, tâcher de ne point les rendre pires, mais par-dessus tout il faut les tenir à l’écart de la population honnête.
Le projet du Gouvernement est un acte de faiblesse. On veut supprimer pour satisfaire une opinion publique généreuse, mais mal informée, et l’on n’a rien prévu. Lorsque le prisonnier libéré aura repris sa place dans la société, il recommencera ses méfaits. La criminalité augmentera et on peut craindre que l’opinion éprouve alors de terribles réactions.
Contre le danger que fera sentir l’audace croissante des criminels, on exigera des peines exemplaires, il deviendra nécessaire de jeter un effroi d’autant plus grand que les crimes seront plus nombreux. On peut craindre que, dans un légitime désir de rétablir l’ordre, la répression devienne si rude que les erreurs du bagne soient dépassées.
La peine de mort deviendra nécessairement plus fréquente. C’est un moyen plus radical que la transportation pour éviter la récidive. Ce jour-là on comprendra peut-être, mais trop tard, que l’envoi à la Guyane, qui évitait la guillotine et respectait la vie, constituait une sauvegarde plus simple et plus humaine.
MAURICE GARÇON.
[1] Stock, edit.
[2] Fasquelle, edit.
Tags: Albert Londres, Alexandre Jacob, bagne, bagne portuaire, galères, Guyane, Louis Rousseau, Maurice Garçon, Mercure de France, Nouvelle Calédonie, peine de mort, suppression, transportation
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
 Envoyer par mail
Envoyer par mail
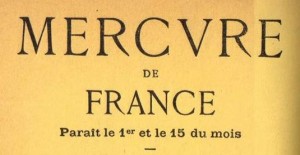


4 avril 2015 à 11:21
Salut les aminches !
xxA aucun moment il n’est venu à l’esprit de Me Garçon (de café) que le condamné à la déportation, l’a était pour des causes économiques ,et tant que ces causes perdureront, des hommes courageux se révolteront .Messieurs les exploiteurs, vous pourraient construire tous les bagnes et les prisons que vous voudrez , jamais vous ne serais à l’abri d’un coup de flingue dans le buffet .Ouille !
MAROCHON .
4 avril 2015 à 12:51
Je crois savoir que le petit Alexandre J lui a répondu de fort belle manière lorsqu’il témoignait sur ce qu’il a pu vivre dans l’enfer guyanais. Ce que Jacob appelait « le droit de compétence ».