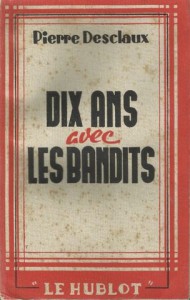 [1]Pierre Desclaux (1885-1961) a utilisé de nombreux pseudonymes (Pierre Barbance, Jean Frick, Georges Jardin, Tommy, Sylvio Pelliculo, etc.) pour exercer ses talents d’écrivain et de journaliste. Il nous montre à voir le monde édifiant du crime dans ses Dix ans avec les bandits. Le livre est publié aux éditions toulousaines du Hublot en 1946. L’auteur semble connaitre son sujet. Et pour cause ! Après avoir collaboré à de nombreuses feuilles, dont Le Figaro et Gil Blas, et avoir été scénariste des Pieds Nickelés de 1921 à 1924, il dirige la revue Mon Ciné au début des années 1930 avant de devenir rédacteur en chef de Police Magazine à la fin de cette décennie. Il signe d’ailleurs en décembre 1938 deux articles consacrés aux relégués et au dépôt pénitentiaire de Saint Martin de Ré. En toute logique, le monde du bagne apparait dans les chapitre II et III de son ouvrage.
[1]Pierre Desclaux (1885-1961) a utilisé de nombreux pseudonymes (Pierre Barbance, Jean Frick, Georges Jardin, Tommy, Sylvio Pelliculo, etc.) pour exercer ses talents d’écrivain et de journaliste. Il nous montre à voir le monde édifiant du crime dans ses Dix ans avec les bandits. Le livre est publié aux éditions toulousaines du Hublot en 1946. L’auteur semble connaitre son sujet. Et pour cause ! Après avoir collaboré à de nombreuses feuilles, dont Le Figaro et Gil Blas, et avoir été scénariste des Pieds Nickelés de 1921 à 1924, il dirige la revue Mon Ciné au début des années 1930 avant de devenir rédacteur en chef de Police Magazine à la fin de cette décennie. Il signe d’ailleurs en décembre 1938 deux articles consacrés aux relégués et au dépôt pénitentiaire de Saint Martin de Ré. En toute logique, le monde du bagne apparait dans les chapitre II et III de son ouvrage.
Nous ne mettons ici en ligne que le second chapitre : Bagne et bagnards. Le troisième, Un départ de relégués pour la Guyane, sera accessible le mois prochain.
Comme ses contemporains, Desclaux ne semble pas adhérer à l’idée régénératrice du système répressif français. Pour autant, il ne développe pas à l’instar de nombre de ses frères une vision critique de l’Administration Pénitentiaire à la suite des écrits d’Albert Londres. Pour lui le condamné ne peut s’amender, il doit expier et les surveillants exercent leur métier de manière plus qu’honorable. Pierre Desclaux développe une vision quelque peu réactionnaire et les quatre portraits anonymes de forçats (James, Raoul, renard et Jacques) qu’il donne à voir dans son chapitre II mettent ainsi en relief la nécessaire méfiance de l’honnête homme vis-à-vis du condamné qui sera toujours marqué du sceau de l’infamie. Parmi ces quatre destins brisés de l’entre-deux-guerres se cache peut-être celui de René Belbenoit (voir notes de bas de page). Le récit ne manque pourtant pas d’intérêt et, quoiqu’un brin voyeuriste, il se termine en toute logique à Saint Martin de Ré, dernier escale avant la Guyane.
Dix ans avec les bandits
Editions du Hublot
Toulouse, 1946, p.12-41
Chapitre II : BAGNE ET BAGNARDS
Les anciens bagnards et même les évadés du bagne, rendent souvent visite aux journalistes. Leurs anecdotes sont savoureuses. Elles ont pourtant un défaut : elles se ressemblent étrangement. De sorte qu’après avoir interviewé quatre ou cinq bagnards, on peut aisément deviner ce que vous diront les cinquante ou soixante autres qui vous feront par la suite leurs confidences.
Je me souviens du premier que je vis. Il ne s’habillait pas comme tout le monde et se donnait l’allure d’un rapin de La Vie de Bohème, chapeau de feutre à larges bords, cravate Lavallière noire aux pans flottants. Il était resté à la Guyane une quinzaine d’années et il demeurait marqué pour le reste de ses jours. Je ne saurais définir exactement son regard qui demeurait inquiétant, en dépit du ton bon garçon adopté par le personnage. L’homme vous regardait bien en face, mais il se produisait un phénomène singulier : les yeux braqués fixement sur les vôtres se dérobaient, ou plutôt répétaient une lueur bizarre qui semblait glauque, privée de vitalité.
Cet ancien bagnard, condamné pour un crime de droit commun, avait expié, et, une fois libéré, avait dû subir cette abominable peine supplémentaire et injuste du « doublage » qui astreignait avant guerre les forçats à séjourner dans la colonie pénitentiaire un nombre d’années égal à celui de la peine initiale. Le bagnard devenait un libéré contraint de répondre à certains appels, dans l’impossibilité de quitter la Guyane, obligé de gagner sa vie tant bien que mal.
Que de libérés, pourtant désireux de se racheter, se voyaient dans la nécessité d’entreprendre des besognes malhonnêtes, car personne, pour ainsi dire, ne voulait les aider ! Ils végétaient lamentablement, lèpre répugnante qui déshonorait la colonie.
Ce bagnard était parvenu, à force de volonté, à amasser une petite fortune en organisant avec courage et méthode la prospection de l’or. Il put ensuite rentrer en France, mais il perdit la plus grande partie de son bien dans de mauvaises spéculations. Je crois même qu’il fut, à son tour, victime d’escrocs.
Ses aventures semblaient avoir influé sur son caractère. Il pontifiait volontiers, se livrait à des improvisations oratoires fougueuses. La question sociale le passionnait, et il exprimait ses idées non sans exaltation. Que de fois je l’ai vu pérorer au coin d’une rue, ne lâchant plus le patient qu’il cramponnait férocement ! Le pauvre homme – je parle du passant – devait subir la torture de son éloquence ampoulée jusqu’au bout, c’est-à-dire pendant une heure ou deux.
L’ex-forçat avait, naturellement, écrit ses mémoires. Il les trimballait d’éditeur en éditeur. Ce travail était inimprimable, parce que les récits se suivaient sans aucun lien, dans une incohérence qui fatiguait. Le tout s’émaillait de réflexions philosophiques d’une banalité affreuse. Lorsque l’auteur évoquait simplement la vie au pénitencier, il réussissait à se rendre intéressant. Malheureusement, ces passages ne suffisaient pas à donner une valeur à l’ensemble
Toutes les anecdotes concernant bagne, qui ont traîné dans les salles de rédaction depuis vingt ans, y figuraient avec des variantes les forçats ne voient pas, tous, les événements de la même façon. Aussi est- il difficile d’ajouter foi dans leurs propos.
Vraiment, le forçat dont je parle, ne représentait plus le moindre danger pour la société. La vie s’était chargée de le « dresser » et de le ramener à des sentiments bourgeois Il menait une existence modeste et tranquille. Il souffrait même des privations et se considérait comme un homme complètement blanchi par son expiation. Il faisait allusion à son séjour au bagne comme à une chose toute naturelle dont il ne rougissait aucunement. Anarchiste dans le sens le plus noble du mot, il s’élevait au-dessus des événements, jugeait ses contemporains sans indulgence, mais aussi sans haine. Au demeurant, il vivait dans un rêve et ne réalisait pas exactement sa situation sociale qui était précaire La malchance, en s’acharnant sur lui, rongeait ses facultés cérébrales comme un acide.
Ce premier libéré du bagne qu’il me fut donné de voir, m’inspira de la pitié. J’ignore ce qu’il est devenu. Je l’ai perdu de vue peu de temps avant la guerre. Peut-être est-il mort, peut-être continue-t-il à s’occuper de politique et de haute philosophie tout en crevant magistralement de faim.
J’eus l’occasion de voir d’autres forçats. Et, notamment, un gaillard en parfaite santé qui sortait d’un bagne canadien. Celui-là ne conservait pas un bon souvenir de son passage dans les geôles canadiennes. Car les travaux forcés au Canada s’accomplissent, comme aux Etats-Unis, dans des prisons, et non pas dans une colonie, selon l’usage de notre avant-guerre. Les détails que me confia mon visiteur sur le bagne où il avait séjourné deux ou trois ans, ne donnaient pas envie d’y aller voir.
Naturellement, il jugeait avec sévérité ses anciens gardiens. Bizarre cette déformation d’esprit chez les forçats qui, avec une entière sincérité, oublient leur faute initiale et protestent contre les procédés inqualifiables dont ils se sont trouvés victimes dans les pénitenciers ! J’ai pu constater que cette mentalité était rigoureusement la même pour tous les anciens forçats de n’importe quel pays, car il m’a été donné d’en connaître appartenant à diverses nationalités. Pas un ne m’a dit : « La justice des hommes m’a durement frappé, mais je ne dois m’en prendre qu’à moi-même, puisque je m’étais rendu coupable d’un grave délit. »
Ce Français qui, par la force des choses, avait effectué une « retraite » dans un établissement canadien, ignorait les « douceurs » de la vie en maison centrale française. Il les connaissait seulement par ouï-dire et en faisait un éloge chaleureux. Par voie de comparaison, nos maisons centrales sont, en effet, un paradis pour les prisonniers, quand on sait ce qui se passe au Canada, où l’on est très strict sur les questions de discipline pénale. Le régime des cellules de punition est terrible. Ces cellules, situées dans le sous-sol, sont privées d’air et de lumière. Les hommes qui y vivent pendant des jours et des semaines en sortent dans un piteux état. De plus, des châtiments corporels sont infligés aux forçats. Le fouet est notamment employé avec une méthodique barbarie.
Il s’agit d’extirper le vice de l’âme des mauvais garçons. Et les Canadiens emploient la méthode violente, sans renoncer toutefois à se servir en même temps de méthodes persuasives, moins terribles.
Le système est-il bon ? Le forçat canadien qui me prit pour confident manifestait son horreur du bagne où il avait enduré les pires supplices. Il exerçait en France un métier paisible, bénéficiant d’une situation spéciale, car son casier judiciaire français était vierge et il pouvait travailler normalement.
Il avait appartenu à une bande de gangsters qui mettait les banques en coupe réglée. Elève de bandits américains fameux, il s’était exercé, d’abord, dans l’Etat de New-York. Puis il avait franchi la frontière, trouvant avantageux d’opérer au Canada pour le compte d’une petite bande qui procurait beaucoup plus de bénéfices à ses membres que les organisations de gangsters américains.
Je n’oublierai jamais avec quel accent pondéré cet individu – nommons le James, pour la commodité du récit – me racontait ses exploits. Voilà un garçon qui paraissait définitivement acquis à la vie tranquille et qui ne rougissait pas des actes criminels pour lesquels il avait été retranché de la vie normale durant de longs mois. Il prenait plaisir à m’exposer de quelle façon le chef dirigeait l’affaire, dressait le plan de l’expédition, postait ses hommes, leur confiait le rôle à tenir, les jetait à l’assaut le moment venu. Et James me confessait qu’un employé de banque s’était effondré, tué net par une balle de browning, au cours d’un de ces raids. Il ajoutait :
– Je crois bien que c’est moi qui l’ai descendu. Je n’en suis pas absolument sûr, parce que nous étions plusieurs à tirer. Mais il m’a semblé que cet « imbécile » se trouvait dans mon champ de tir.
James possédait un teint rose d’individu bien portant, et il souriait en prononçant ces paroles. Je ressentais une gêne que je ne pouvais dissimuler. Alors je lui demandai :
– Cela ne vous a pas contrarié de voir tomber ce garçon?
– Non, me répondit-il avec bonhomie, car je risquais ma peau, n’est-ce pas? L’employé de banque qui se trouve témoin d’une attaque contre ses patrons est un idiot, s’il oppose une résistance quelconque. Il ne sera pas plus avancé à la fin de la semaine lorsqu’il touchera l’enveloppe renfermant ses appointements. Qu’il se dresse, revolver au poing, ou qu’il se couche à plat ventre sous une table, c’est la même chose. Ses patrons ne lui en savent pas plus de gré. Nous autres, les gangsters, nous ne nous attaquions pas aux employés, mais aux millions de dollars de la caisse. Sentez-vous la différence?
James cherchait à me convaincre, persuadé que j’allais l’approuver.
– La différence, mon vieux, fis-je, j’avoue que je ne la saisis pas très bien. J’admets qu’un employé, par conscience professionnelle, veuille défendre la caisse de ses patrons. C’est une question qui ne se discute pas. Vous admettrez bien qu’il y ait des gens honnêtes?
– D’accord ! Alors qu’ils laissent les autres se débrouiller comme ils l’entendent! Et qu’ils ne se dressent pas sur leur chemin, revolver au poing, s’ils ne veulent pas écoper! Tous ces raids de banque pourraient se passer sans histoires si quelques employés trop zélés ne faisaient pas des bêtises.
– Et c’est pour cet employé « descendu » que vous avez été envoyé au bagne?
– Non! On n’a jamais pu prouver que j’étais dans le ‘coup. C’est pour une autre expédition. Vous n’y pensez pas ! J’étais bon pour la potence ou la chaise électrique, si la mort de ce scribouillard m’avait été imputée.
Décidément, James conservait encore son âme de gangster. La mort de l’employé de banque ne pesait guère sur sa conscience. Je l’examinais, tandis qu’il me contait ses impressions. Il jouissait en apparence d’un équilibre normal. Aucun remords ne l’habitait et pourtant il s’accusait lui- même de la mort d’un homme. Cela ne l’empêchait ni de rire, ni de manger, ni de dormir.
Il m’avoua avoir fondé un foyer en France et être père de famille. Il m’assura que sa femme et ses beaux-parents ignoraient totalement son passé aventureux. Je crois qu’il ne mentait pas. Je compris que ce passé le fascinait et que, seule, la crainte du châtiment le maintenait dans le droit chemin. Le dur système pénitentiaire canadien avait obtenu ce résultat que James fronçait les sourcils d’un air épouvanté lorsqu’il évoquait les heures vécues « là-bas ».
S’il me confiait ses souvenirs, celui-là, ce n’était pas pour gagner de l’argent, mais pour « prendre un bain de passé ». James pouvait enfin évoquer des heures qui marquaient dans son existence. La fougue qui animait ses propos, la rougeur qui teintait ses joues, le feu de son regard, prouvaient à quel point le banditisme l’avait happé jadis et marqué à jamais.
Je n’avais pas peur en l’entendant s’exprimer de la sorte. Je réalisais parfaitement que je ne risquais rien, qu’il me considérait comme un camarade, que j’étais sacré à ses yeux. Mais ce scélérat, mué en employé de commerce jouissant d’un prestige d’honnêteté auprès de son entourage, regrettait le temps où il volait les banques et assassinait les caissiers récalcitrants. Et c’est pourquoi la bête fauve ressuscitait. Et c’est pourquoi un sentiment de dégoût me saisissait, car James me donnait le spectacle du démon malfaisant qui savoure la volupté de commettre un crime, qui se délecte à se rappeler des souvenirs abominables.
Il se tut. Et, comme de mon côté je gardais le silence, il comprit peut être ma répulsion.
– Je me laisse entraîner à bavarder, dit-il, et je vous dérange…
– Non, fis- je, je pense à votre femme et à vos enfants. Etes-vous, certain qu’ils ne sauront pas, un jour, votre secret ?
Le rire forcé qui s’échappa de ses lèvres, traduisit une angoisse.
– Ah ! bien sûr !, reprit-il, je serais malheureux s’ils venaient à apprendre… Vous êtes la première personne en France à qui je raconte cette histoire. Ce n’est pas drôle, vous pouvez me croire. Mon secret m’étouffe parfois. Il y a des jours où j’ai envie de tout avouer à ma femme…
– Je n’ose vous conseiller. Vous êtes heureux en ménage?
– Il n’y a pas plus uni. Je gagne assez d’argent. On ne manque de rien à la maison. Les petits grandissent. Oh! je ne voudrais pas qu’un jour ils sachent… On les élève bien… Non et non ! ils ne seront pas comme j’ai été. Je préférerais les tuer tout de suite si je pensais qu’ils tourneront mal.
– Alors, je ne vous comprends pas. Vous regrettez le passé et vous vous révoltez à l’idée que vos petits pourraient vous ressembler ?
Mes réflexions le consternaient. Un duel se livrait entre les deux personnalités de cet ancien forçat. Il s’épongea le front avec son mouchoir. Une sueur perlait à ses tempes. Je cherchais à ne pas trop le heurter et, cependant, il m’était difficile de cacher mon trouble.
– Vous ferez mieux, repris-je au bout de quelques secondes, de ne jamais révéler la vérité à votre femme. Qui sait si son amour pour vous ne serait pas tué sans espoir ? Ce sera votre véritable expiation, de conserver en vous l’affreux secret. Il faut qu’elle vous considère toujours comme un honnête homme…
James me regardait d’un air égaré. Puis ses yeux gris eurent des reflets d’acier. Il se ressaisissait, redevenait maître de lui et il paraissait avoir honte de sa défaillance.
– Vous avez raison! C’est la faute à tout ce passé dont je viens de vous parler. J’ai eu comme une crise de paludisme, quoi ! Vous ne m’en voulez pas ? Je suis bête de m’en faire… La vie est belle, je gagne bien ma croûte, je suis heureux. Que demander de plus ?
Il me quitta, rasséréné en apparence. James n’est plus revenu me voir.
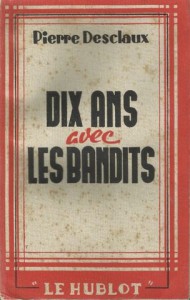 [1]J’ai connu un autre forçat qui, lui, n’avait pas de tels scrupules. Il montrait à qui le désirait ses papiers attestant sa qualité d’ancien forçat. C’était un hâbleur de première classe, fort habile dans l’art de mentir et de se faire passer pour un héros. Mais oui, un héros ! Il donnait d’amples détails sur les aventures vécues en Guyane, aventures où il avait joué un rôle, magnifique. Son courage, son dévouement lui avaient valu une sérieuse remise de peine et une libération anticipée. Il n’exigeait guère d’argent, et se contentait de petites sommes dont il donnait à l’avance l’emploi. Appelons-le Raoul.
[1]J’ai connu un autre forçat qui, lui, n’avait pas de tels scrupules. Il montrait à qui le désirait ses papiers attestant sa qualité d’ancien forçat. C’était un hâbleur de première classe, fort habile dans l’art de mentir et de se faire passer pour un héros. Mais oui, un héros ! Il donnait d’amples détails sur les aventures vécues en Guyane, aventures où il avait joué un rôle, magnifique. Son courage, son dévouement lui avaient valu une sérieuse remise de peine et une libération anticipée. Il n’exigeait guère d’argent, et se contentait de petites sommes dont il donnait à l’avance l’emploi. Appelons-le Raoul.
Raoul, donc, désirait revoir au plus tôt sa vieille maman qui habitait encore un petit village de Lorraine. Malheureusement, il ne possédait pas un sou pour prendre son billet. On lui avançait donc deux ou trois cents francs, pas davantage. Je dis « on », car le roublard entreprenait la tournée des journaux, des hebdomadaires aussi bien que des quotidiens.
Partout il se lamentait de façon identique et… il encaissait.
Pendant quelques jours on ne vit plus Raoul. Sans doute se retrempait-il au sein de sa famille? Puis, il réapparut. Grand bonhomme, maigre, le regard humble, toujours prêt à s’incliner devant vous, à vous appeler avec obséquiosité « Mon bienfaiteur ! » Raoul vous exaspérait par sa politesse. Je mettais cette attitude, par trop effacée, sur le compte des années passées à trembler devant les gardiens.
Raoul répétait sans cesse
– Je veux refaire ma vie. Si je pouvais découvrir quelqu’un qui m’aide à trouver un bon petit emploi… Je ne suis pas difficile. Je me contenterai de peu. L’essentiel est que je gagne de quoi m’entretenir très modestement.
Et il énumérait ses qualités. Au bagne, il était cuisinier. Il s’était aussi « distingué » dans la menuiserie et la serrurerie. Mais son véritable métier était celui de pâtissier.
Lorsqu’on le questionnait sur le délit qui lui avait valu sa condamnation aux travaux forcés, il se montrait moins bavard. De mauvaises fréquentations l’avaient poussé à commettre des vols en compagnie de camarades plus coupables que lui.
Il n’aimait guère ce genre d’explications. Par tact, on n’insistait pas. La curiosité d’un journaliste peut torturer un ancien bagnard, qui a honte de son passé. Comment poursuivre un interrogatoire qui afflige le partenaire ?
Raoul devenait un peu « crampon ». Presque chaque matin, il poussait la porte de la salle de rédaction.
– Je viens voir si vous ne m’avez pas trouvé un emploi ?
Nous avions un rédacteur très sympathique, ayant vécu aux colonies et qui, après un divorce pénible, n’aspirait qu’à la tranquillité. Il souffrait de voir son intérieur livré aux fantaisies indolentes d’une femme de ménage peu consciencieuse.
Il m’entendit parler de Raoul et de son désir, quotidiennement affirmé, de découvrir un emploi.
– Mais au fait, dit-il, votre bagnard, si je l’engageais comme valet de chambre ?
Je confesse que l’idée ne m’enthousiasma pas. Raoul finissait par me lasser avec ses jérémiades continuelles. Notre rédacteur, en revanche, désira voir le bonhomme et eut une bonne impression. L’affaire ne traîna pas. Vingt- quatre heures après, voilà mon Raoul installé au domicile de l’ancien colonial, ravi de son « acquisition ».
Tout marcha bien les premiers jours. Raoul s’acquittait de ses fonctions avec zèle. Il pourchassait la poussière sans répit, frottait les meubles, mettait de l’ordre dans les armoires, rangeait les livres qui traînaient un peu partout et respectait le fouillis de la table de travail, se contentant de donner quelques coups de plumeau sur les manuscrits.
Au bout de quinze jours, son zèle parut se ralentir. Raoul reçut une admonestation de son patron, et cela seul suffit à le stimuler, il y eut une nouvelle période de quinze jours qui fut… satisfaisante.
Le valet de chambre maintenait l’ordre dans la maison. Quant au cuisinier, il se distinguait… Il se distinguait même à tel point qu’on lui confia le soin d’organiser un grand dîner à quatre couverts. Les trois invités étaient des gens de marque qu’il s’agissait de bien traiter.
Raoul accomplit des merveilles, et le dessert fut, en particulier, délicieux. L’ancien pâtissier n’avait décidément pas oublié l’art de confectionner crèmes et gâteaux.
Vous voyez d’ici le tableau. Les invités examinaient à la dérobée le valet de chambre imperturbable qui servait. Dès qu’il avait le dos tourné, on chuchotait :
– Il n’est pas mal ce garçon! Il a somme toute une bonne mine…
Quel triomphe pour Raoul! Le maître de maison exultait
– Et vous n’avez pas peur ? lui demandait-on.
– Pensez-vous! Je ne songe même pas que mon valet de chambre sort du bagne. Il ne faut pas avoir de ces préventions! Elles sont indignes des gens civilisés. Nous devons être humains.
Un peu après le café et le pousse-café, notre rédacteur décida que ses invités et lui iraient assister à la présentation d’un grand film. Il disposait d’une loge. Tout le monde partit. Raoul, qui avait reçu de bons pourboires, s’inclina cérémonieusement en refermant, sur le dos de son patron et des invités, la porte de l’appartement.
Il attendit cinq minutes, puis entreprit l’exécution d’un plan qu’il mûrissait depuis quelques jours, c’est-à-dire le cambriolage en règle de la maison. Il emporta près de deux mille francs en numéraire, un browning, une pelisse, un complet veston, du linge en abondance, une collection de vieilles monnaies, bien d’autres choses de valeur encore!
Le vol ne fut découvert que le soir.
L’administration de mon journal, estimant que nous devions une compensation à notre collaborateur, me demanda d’intervenir auprès de la sûreté, afin qu’on entreprît aussitôt des recherches très sérieuses.
Je vis alors M. D…, qui était en relations suivies avec nous et qui exerçait les fonctions de contrôleur en chef de la Sûreté, rue des Saussaies. M. D… eut un sourire narquois en écoutant l’histoire.
– Vous êtes de’ grands naïfs, me dit-il. Ainsi vous avez cru que cet individu allait se contenter de mener l’existence d’un excellent valet de chambre? Si vous aviez ma vieille expérience des prisons et des maisons centrales, vous vous seriez montrés un peu plus sceptiques. Voyez-vous, ces bonshommes-là nous craignent comme la peste, nous autres, policiers. Et vis-à-vis de vous, les journalistes, ils se paient votre tête. Ils se paient votre tête, parce que vous coupez dans tous les panneaux qu’ils vous tendent. Pourris ils sont et pourris ils restent. Rien à faire. Leur relèvement moral ? Belle fumisterie ! Votre type, si nous réussissons à le rattraper, déclarera, je le parie, que votre rédacteur l’exploitait, qu’il ne lui donnait pas des gages suffisants, et qu’il l’humiliait en lui faisant sentir sa situation d’ancien forçat. Croyez-moi, que cette mésaventure vous serve de leçon ! Montrez-vous plus perspicace une autre fois. Il est heureux que votre rédacteur en soit quitte pour la perte d’argent et de quelques objets. Cela pouvait finir par un empoisonnement. Sait-on jamais avec des cocos pareils !
Le signalement de Raoul fut envoyé à toutes les gares frontière, dans les ports. On ne retrouva pas l’individu. Trois ans après, sur la Côte d’Azur, un de mes amis, magistrat au parquet de cette ravissante ville de Grasse, m’apprit que Raoul était l’objet de recherches et qu’un mandat d’arrêt avait été décerné contre lui, pour escroqueries.
Raoul ayant délaissé la capitale, exerçait maintenant ses talents sur la Riviera. A la veille de la guerre, en 1939, j’étais en Normandie, à Vernon, sur la place de la Mairie, en compagnie d’un commerçant du pays. Il me désigna une petite troupe de quatre hommes qui allait passer à nos côtés.
– C’est insupportable, me déclara-t-il, Vernon est une ville où les interdits de séjour ont le droit de venir. Alors, quand ils sortent de la maison centrale de Poissy, on les dirige d’abord chez nous. En voilà quatre qui ont dû être libérés .ce matin. Je les reconnais à leur pelochon et à leur allure générale. Ils ont tous la même dégaine.
Parmi les quatre hommes, il y avait Raoul…
Sortait-il de centrale, où se trouvait-il simplement avec des camarades qui en venaient ?
Me reconnaissant, il rougit. Peut-être pensa-t-il que j’allais le faire arrêter ? Il y avait justement deux gendarmes devant la mairie, à quelques mètres. Un geste, et l’ex- bagnard était coffré.
Je ne sais à quels réflexes j’obéis…
Je ne fis pas le geste.
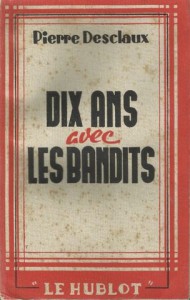 [1]Je me rappelle un autre forçat, qui ne ressemblait à aucun de ceux que j’avais vus jusque-là. Condamné aux travaux forcés pour faux et usage de faux, vol qualifié, tentative d’homicide, il possédait une certaine instruction. Je l’appellerai Renard, ce qui correspond bien à sa finesse, à sa roublardise.
[1]Je me rappelle un autre forçat, qui ne ressemblait à aucun de ceux que j’avais vus jusque-là. Condamné aux travaux forcés pour faux et usage de faux, vol qualifié, tentative d’homicide, il possédait une certaine instruction. Je l’appellerai Renard, ce qui correspond bien à sa finesse, à sa roublardise.
Renard ne se livrait pas facilement. Je me demande comment un homme si habile, si prudent, s’était laissé prendre.
Il pesait ses paroles, ne regardait jamais en face.
J’avoue avoir été gêné par sa présence.
Il suait l’hypocrisie froide.
Renard devait être dangereux.
Il ne prononçait sur le pénitentier de Saint-Laurent-du-Maroni que des appréciations mesurées. Il calculait l’importance de la plus petite réflexion. Sortant de sa poche un carnet bourré de notes, il le consultait avant de répondre,
Ce comptable méticuleux et… expert en fausses écriture devenu bagnard, n’avait pas perdu l’habitude de tenir le « compte courant » de ses moindres actions. Il calculait tout, ne livrait rien au hasard.
Je l’ai soupçonné de chercher une mirifique combinaison – malhonnête bien entendu – pour faire fortune, et de prendre ses précautions afin de ne pas être pincé, cette fois.
Il y a de ces gaillards, foncièrement mauvais, qui s’endurcissent dans le mal et qui fortifient leur expérience. Renard devait être de ceux-là. Tout ce que j’ai appris par lui, je le savais déjà. Il se gardait d’ailleurs de porter sur des fonctionnaires des jugements défavorables. Il avait eu la précaution de me demander si j’avais quelques relations dans le personnel pénitentiaire. Je n’avais dit ni oui, ni non. La question me déplaisait. Je voyais bien où le fourbe voulait en venir. Il pensait que je répéterais ses propos à qui de droit, et qu’il pourrait lui en cuire, tôt ou tard.
Renard m’a beaucoup appris par son attitude. Il m’a enseigné que le bagnard conserve parfois de son séjour au pénitentier une marque ineffaçable, surtout quand son naturel est foncièrement mauvais.
Sa force de dissimulation, dans ce cas, est énorme, inimaginable. Il peut mentir en vous regardant les yeux dans les yeux et chercher à vous nuire à la minute même où il vous adresse les meilleures protestations d’amitié. Il a touché le fond de l’abîme. Il a souffert, et il est tout à fait décidé, non pas à éviter le crime, mais à éviter la répression de la justice. Toutes ses facultés intellectuelles et physiques, il les mettra en œuvre pour ne pas retomber aux mains des gardes-chiourme.
S’il y a de par le monde – et il doit bien y en avoir – d’anciens forçats, libérés ou évadés, qui ont refait leur vie et mènent une existence relativement tranquille, je suis sûr qu’ils montent farouchement la garde autour de leur bonheur. C’est assez naturel, je ne songe pas à m’en étonner.
Mais où je vois que le bagne ne possède aucun pouvoir régénérateur, c’est en constatant qu’il fournit des armes à ceux de ses pensionnaires qui veulent continuer à mener leur vie en marge des lois de la société. Le bagne rend l’être malfaisant encore plus redoutable qu’il ne l’était avant d’y entrer. Il le cuirasse contre les fautes qu’il pourrait commettre dans l’art d’échapper aux poursuites policières.
Et cela est tellement vrai que, pendant des années, des individus, évadés ou libérés de Guyane, ont pu se livrer à d’épouvantables actes commis au préjudice de la société, sans avoir été inquiétés par la police, tant ils étaient habiles à éviter de se faire prendre.
Hélas ! le bagne est bien l’école du vice. Tous ceux qui ont étudié son fonctionnement se déclarent unanimes sur ce chapitre.
Les Américains prétendent avoir obtenu des résultats merveilleux en organisant leurs maisons de répression. On connaît la réputation mondiale de Sing-Sing où tant de gangsters fameux, tels Al. Capone, ont accompli des… périodes de repos. L’administration pénitentiaire américaine se flatte d’être parvenue à corriger de très mauvais sujets en ne les perdant pas de vue lorsqu’ils étaient emprisonnés, en établissant des catégories de prisonniers, en favorisant ceux qui paraissaient s’amender.
Je reste un peu sceptique et j’ai des raisons sérieuses pour cela. Cependant, je retiens du système judiciaire, plutôt que pénitentiaire américain, un enseignement : le condamné, lorsqu’il a terminé sa peine aux Etats-Unis, n’est pas marqué au fer rouge comme en France. Il peut recommencer une carrière ou continuer celle qu’il avait entreprise avant d’entrer en prison.
On ne s’acharnera pas sur lui. On ne l’arrêtera pas parce qu’un crime a été commis dans son quartier. On ne lui jettera pas tout le temps à la face qu’il a été condamné déjà et qu’il sort de prison.
Notre caractère français s’adapterait mal à de telles coutumes. Le Français moyen a horreur, en principe, du « monsieur qui a eu des démêlés avec la justice ». Il ne fait qu’une exception à la règle, en faveur – et j’ai quelque honte à l’écrire – des gros escrocs qui ont su amasser des millions et peuvent se permettre, à la sortie du bagne ou de la maison centrale, de mener grand train. L’argent purifie tout; et notre époque si désaxée est indulgente à l’égard de ceux qui ont le portefeuille bien garni.
J’ai lu à peu près tous les livres, tous les reportages qui ont été consacrés au bagne. Et j’y ai appris – ceci à l’appui de ma thèse – que les condamnés riches, partis avec les autres, ceux de la plus basse pègre, parvenaient toujours à se créer une situation privilégiée là-bas. Je ne sais si cette entorse à la justice la plus élémentaire sera encore possible lorsque les peines de travaux forcés accompliront intégralement dans la métropole, comme ce fut le cas pendant la durée de la guerre, la suppression du bagne de Cayenne ayant été décidée par l’administration que soutenait le Parlement.
J’ai questionné d’innombrables personnes qui avaient vécu en Guyane ou qui avaient fait des enquêtes sur place. Toutes sont unanimes à déclarer que le bagne a porté tort à une admirable colonie, et au point de vue moral, a toujours fait faillite.
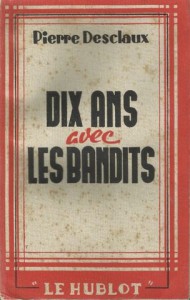 [1]J’ai eu un collaborateur bagnard. Je m’explique. Un jour, j’entrai en relations avec un évadé qui, de l’étranger, nous avait fait parvenir un énorme manuscrit, bourré d’anecdotes, de commentaires, de protestations véhémentes contre la direction du bagne. Ce manuscrit manquait de cohésion, mais il contenait d’excellentes choses, susceptibles d’être remaniées par un homme de métier et d’intéresser le public. Nous échangeâmes une correspondance avec l’auteur de ce travail et nous tombâmes d’accord. Je ne veux pas imprimer le véritable nom de ce forçat, afin de lui éviter des ennuis. Je ne sais pas exactement ce qu’il est devenu dans la tourmente. Son plus cher désir était de rentrer en France et de redevenir un honnête homme. Il le clamait dans toutes ses lettres, et je crois qu’il était sincère.
[1]J’ai eu un collaborateur bagnard. Je m’explique. Un jour, j’entrai en relations avec un évadé qui, de l’étranger, nous avait fait parvenir un énorme manuscrit, bourré d’anecdotes, de commentaires, de protestations véhémentes contre la direction du bagne. Ce manuscrit manquait de cohésion, mais il contenait d’excellentes choses, susceptibles d’être remaniées par un homme de métier et d’intéresser le public. Nous échangeâmes une correspondance avec l’auteur de ce travail et nous tombâmes d’accord. Je ne veux pas imprimer le véritable nom de ce forçat, afin de lui éviter des ennuis. Je ne sais pas exactement ce qu’il est devenu dans la tourmente. Son plus cher désir était de rentrer en France et de redevenir un honnête homme. Il le clamait dans toutes ses lettres, et je crois qu’il était sincère.
Au moment où il nous fit parvenir son premier manuscrit, il habitait un pays de l’Amérique latine, et nous annonçait qu’il se considérait comme ne devant plus rien à la justice de son pays, ayant expié.
Je vous fais remarquer justement le grand défaut de tous les bagnards. Ils deviennent raisonneurs, ergoteurs et ils discutent les lois, les interprètent à leur façon. Ils connaissent les règlements mieux que les employés de l’administration pénitentiaire. S’ils écrivent une réclamation, ils signalent qu’en vertu de tel ou tel article de la circulaire de telle ou telle date, ils ont le droit de faire ceci ou cela.
C’est une des maladies du bagne.
Jacques – je précise bien que ce n’est pas son nom – était atteint de cette maladie. Voici son cas. Condamné à sept ans de travaux forcés à la suite d’un vol qualifié, il avait accompli son temps, non sans avoir connu mille mésaventures. Il s’était évadé, avait été repris, condamné à nouveau pour son évasion, puis libéré mais astreint à la peine de doublage – cette iniquité sociale.
Son doublage, Jacques ne l’admettait pas. Aussi s’était-il évadé de nouveau, persuadé qu’en se rendant en France, il parviendrait à émouvoir les juges et à obtenir le « quitus » définitif. Je lui écrivis alors de ne pas tenter l’aventure, persuadé qu’il n’obtiendrait aucune grâce. D’autant plus qu’il jouissait d’une fort piètre réputation, non seulement au bagne, mais à Paris, dans la haute administration pénitentiaire. Ce garçon, encore jeune, avait écrit à tous les fonctionnaires possibles et imaginables. Ï1 les avait harcelés de lettres, de protestations, de réclamations. C’était la bête noire des gardes-chiourme. S’appuyant sur les règlements qu’il étudiait sans cesse, il réclamait, réclamait toujours.
Je ne me rappelle plus exactement s’il répondit aux missives que je lui adressai en quelque lointaine Colombie. Toujours est-il qu’il reçut le paiement d’une partie de son manuscrit et que nous publiâmes certains de ses articles, émondés et mis au point par un de nos rédacteurs très au courant des questions du bagne où il avait séjourné deux ans à titre de fonctionnaire[1] [2].
Un matin, arriva une lettre de Jacques. Elle émanait de la maison centrale de Caen. Notre rédacteur occasionnel m’annonçait qu’il était victime d’un déni de justice. Sans écouter mes conseils de prudence, il s’était embarqué comme passager clandestin à bord d’un gros cargo se dirigeant sur le Havre. Découvert au cours de la traversée, il avait été remis aux autorités policières du Havre et emprisonné. Forçat en rupture de ban, son compte était bon. Il devait être traduit devant un tribunal à son retour au bagne.
Jacques me suppliait d’intervenir, en reprenant sa fameuse thèse. Il avait accompli sa peine. Le doublage était inique. Il ne demandait qu’à recommencer une vie d’honnêteté. Il jurait qu’il tiendrait parole, qu’on n’aurait plus à se plaindre de sa conduite.
Je lui répondis aussitôt à Caen que j’allais m’occuper de son affaire, mais que d’après les premiers renseignements recueillis, je n’espérais pas réussir. Sur ces entrefaites, nous arriva d’Amérique un énorme manuscrit de Jacques.
Il l’avait expédié avant son départ. Les mémoires de Jacques ! Que dis-je, le commencement de ses mémoires. Car il entendait bien leur donner une longue suite.
Oui, ce manuscrit était vraiment énorme… par le nombre de ses pages et ses développements. Toutes les rancœurs, toutes les tristesses d’un forçat s’y exprimaient. Il y avait matière à une intéressante série.
Mais que de verbosité, que de détails inutiles, que de répétitions ! Jacques – et c’était tout naturel ! – ignorait le métier d’écrivain. Il ne savait pas doser les effets, provoquer l’émotion par des artifices de style. Il enregistrait pêle-mêle toutes ses impressions, sans suivre un ordre chronologique.
Le même rédacteur qui avait si bien tiré parti des précédents articles de Jacques, fut chargé de débroussailler ce manuscrit. Ce fut promptement exécuté. Nous l’annonçâmes au prisonnier, mais il ne nous répondit pas ou ne put nous répondre. On le « promenait » d’une maison centrale à l’autre.
Nous apprîmes enfin qu’il se trouvait maintenant à l’île de Ré, dans la vieille forteresse convertie en antichambre du bagne et où, avant la guerre, les forçats attendaient avec impatience leur départ pour la Guyane. Jacques s’impatientait. Il continuait à protester. Il lassait ses geôliers par ses perpétuelles réclamations.
Je n’avais pas perdu de temps et m’étais mis en campagne pour obtenir sa grâce. M. Albert Lebrun, président de la République, voulut bien me dire que le dossier allait être examiné avec bienveillance. Or, la commission des grâces était hostile à Jacques, en raison de sa conduite indisciplinée et de toutes les plaintes qu’il avait portées contre tant de fonctionnaires, à commencer par le gouverneur de la colonie.
J’acquis vite la conviction que Jacques ne serait pas gracié. Son départ approchait. Je tins à faire la connaissance de ce garçon et sollicitai auprès du ministre de la Justice la permission de me rendre au bagne de l’île de Ré pour voir Jacques. Nous avions des comptes à régler. Nous lui devions de l’argent pour la publication d’une partie de ses mémoires. Grâce à l’appui d’un haut fonctionnaire dit service pénitentiaire du ministère de l’Intérieur, j’obtins enfin du ministre de la Justice l’autorisation de m’entretenir librement avec Jacques au bagne de l’île de Ré. Dès que je fus en possession de la pièce nécessaire, je pris la route pour La Rochelle.
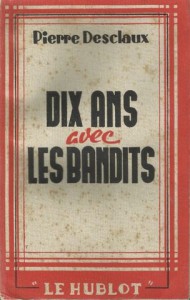 [1]Le pénitencier est situé à l’extrémité de l’île de Ré, face à l’Océan, au lieudit Saint-Martin-de-Ré. Il occupe une vieille forteresse qui a été aménagée en prison. En réalité, caserne inconfortable à laquelle on a mis des barreaux. J’y venais pour la première fois. Mais j’y avais déjà envoyé des collaborateurs lors de départs de convois pour le bagne. Je savais dans quelles conditions vivaient les détenus.
[1]Le pénitencier est situé à l’extrémité de l’île de Ré, face à l’Océan, au lieudit Saint-Martin-de-Ré. Il occupe une vieille forteresse qui a été aménagée en prison. En réalité, caserne inconfortable à laquelle on a mis des barreaux. J’y venais pour la première fois. Mais j’y avais déjà envoyé des collaborateurs lors de départs de convois pour le bagne. Je savais dans quelles conditions vivaient les détenus.
Le directeur me reçut avec affabilité. L’administration pénitentiaire l’avait prévenu de mon arrivée. Il ne me cacha pas que Jacques lui donnait du fil à retordre.
– Le roi des raisonneurs, me. dit-il Il me tarde, je vous assure, qu’il soit parti. Des hommes comme lui sont bien gênants. L’idée fixe qu’il est innocent le hante. Que voulez- vous que je fasse ? Je suis ici pour garder des condamnés qui doivent aller en Guyane et je n’ai pas à discuter les règlements. Ce n’est pas moi qui les fabrique. Jacques ne paraît pas comprendre cela. J’enregistre ses doléances. Si je les trouve justifiées et si elles concernent le régime intérieur du pénitencier, je lui accorde satisfaction. Mais s’il s’agit de son cas particulier, je ne peux que l’inciter à la patience, à la résignation. Tous les bagnards sont astreints â. la peine supplémentaire de doublage. Il n’a pas complètement accompli la sienne, et il s’est évadé de Saint-Laurent- du-Maroni. On l’a pincé à son débarquement en France. On me l’expédie ici. Ma mission particulière consiste à le compter parmi mon effectif, à le surveiller. Un point, c’est tout !
« Or, le bougre, n’arrête pas de décolérer. Oh! le plus réglementairement du monde. Il ne se met jamais dans son tort. Mais il argumente. II écrit, par la voie administrative, aux plus hautes personnalités. »
– Jouit-il d’un certain prestige aux yeux de ses camarades ? questionnai-je.
– Je ne voudrais pas vous paraître de parti pris à son égard. Mais je préfère vous ôter toute illusion. Dans d’autres milieux, Jacques, sûrement, serait considéré comme un « rouspéteur » et exercerait quelque influence sur les copains de chambrée ou d’atelier. Ici, nous avons affaire à une « clientèle » particulière. Les êtres qui vivent en ce moment au pénitencier sont des condamnés qui ont traîné dans les prisons et maisons centrales et qui se montrent impatients de nous quitter. A tort ou à raison, ils se figurent qu’en Guyane ils seront heureux. Ils ignorent le plus petit détail sur la colonie, et pourtant se croient au courant de tout. Jacques, qui connaît la vérité, devrait théoriquement leur en imposer. C’est le contraire qui se produit. Il ne faut pas chercher la logique chez les forçats. Jacques leur tient tête. Il en a vu d’autres au cours de sa vie vagabonde.
« Ce n’est pas un mauvais « pensionnaire ». S’il n’avait pas cette manie de réclamer sans arrêt, je pourrais le citer en exemple. J’ai là son dossier individuel. Vous pouvez le consulter, vous n’y découvrirez rien de grave. Depuis qu’il est entré à Saint-Martin-de-Ré, je n’ai eu à le punir que pour un délit insignifiant. Il fumait une cigarette. Que voulez-vous, nous ne sommes pas ici dans un pénitencier américain. Le règlement interdit de fumer. Nous fermons les yeux tant qu’il nous est permis. Mais il y a des cas où mon personnel est contraint de sévir, sous peine de perdre toute autorité. »
L’autorisation du ministre de la Justice stipulait que je venais au pénitencier effectuer un règlement financier. On m’avait prévenu avant de partir que je devais verser l’argent entre les mains du directeur. Mais ce dernier m’avertit qu’il valait mieux ne pas déposer une somme trop élevée, car elle risquait d’être confisquée pour le paiement des frais de justice.
– C’est le règlement, dit le directeur. Jacques le connaît bien. Vous n’aurez qu’à le prévenir tout à l’heure.
Accompagné du fonctionnaire, je pénétrai dans les locaux du bagne. Il fallait franchir une imposante porte de fer que gardaient quelques Sénégalais. De l’autre côté de cette porte, il n’y avait plus que des gardiens du service pénitentiaire sans armes, précaution indispensable en cas d’émeute. La force armée ne devait intervenir à l’intérieur des locaux pénitentiaires qu’en cas de nécessité absolue et si l’alarme était donnée. Certains dispositifs électriques d’alerte étaient d’ailleurs prévus pour mettre le personnel en sûreté le plus rapidement possible.
Pendant qu’on allait chercher Jacques, le directeur m’offrit de me faire visiter quelques ateliers. Je le suivis. Nous étions dans une vaste cour de caserne, bordée par des bâtiments et des murs fort élevés. Çà et là, dans la cour, de petites constructions garnies de cases. Des latrines dépourvues de portes… intentionnellement.
– S’il en était autrement, m’expliqua le directeur, les hommes échapperaient à toute surveillance. Or, dites-vous bien qu’avec des loustics pareils, il faut toujours se tenir sur ses gardes. On ne sait jamais à quoi on s’expose.
Nous passions justement près d’un des édifices. Il y avait là un bagnard accroupi. C’était un homme d’une quarantaine d’années, à la figure ravagée. Il nous dévisageait. J’eu honte pour lui car je devinais sa gêne. Il se moquait bien du directeur et des gardiens qui nous suivaient : il avait l’habitude de leur présence dans sa vie de chaque instant. Mais il se demandait qui je pouvais être et son amour-propre souffrit visiblement. J’évitais son regard.
Le directeur, qui m’observait, se mit à rire.
– Vous avez bien la mentalité du bon public, me dit-il. Vous plaignez cet homme. Vous faites de la sentimentalité. Si nous étions ainsi, nous autres, nous serions perdus. Tous, tant qu’ils sont, les forçats, oublient pourquoi ils vivent ici. Ils se considèrent encore comme des citoyens libres. Il faudrait avoir des égards pour eux. Dès qu’ils nous sentent faiblir, ils en abusent. Bêtes fauves, momentanément impuissantes, ils n’attendent que la seconde propice. Notre métier, certes, présente de durs côtés. Nous devons être justes, mais intransigeants. Notez que tous, au bout du compte, s’inclinent devant notre fermeté et qu’ils la comprennent.
Nous étions arrivés devant une porte qu’ouvrit un gardien.
– Voici un atelier, me dit le directeur, où se fabriquent des émouchets. Ce sont des sortes de résilles que l’on place, dans certaines régions du Sud-Ouest, sur la tête du bétail quand il va aux champs. Ce travail est assez facile. Les forçats confectionnent fort bien les émouchets au bout de quelques jours de présence ici. Il faut les occuper, autrement on ne parviendrait pas à maintenir l’ordre. Dans la période qui précède les grands départs, quand nous recevons des forçats en provenance de toutes les prisons de France, nous sommes obligés de fermer les ateliers et de laisser les bagnards dans les cours. Il en résulte une situation vraiment chaotique qui, souvent, nous inquiète. Pensez, tous ces hommes inoccupés qui bavardent, qui s’énervent ! Rien n’est si préjudiciable au maintien de l’ordre.
Nous entrâmes. J’eus une impression atroce. Dans cette salle travaillaient environ cinquante hommes. Assis face à l’entrée, leurs mains continuaient à manier les outils, puisque telle était la consigne et qu’ils n’avaient pas le droit de s’arrêter. Mais les yeux de tous étaient fixés sur moi.
Ces yeux ! Je ne puis oublier leur expression douloureuse, effroyable. Des yeux chavirés par un effroi perpétuel, par le-souci de l’avenir, par l’amertume du présent. Des yeux de bandits, évidemment, des yeux qui trahissaient toutes les tares, toutes les ignominies. Mais des yeux de suppliciés des enfers.
Et les mains toujours accomplissaient leur geste machinal, nouaient et renouaient le fil des émouchets…
Nul bruit qu’un frémissement imperceptible. Cela grouillait devant moi. Des larves, ces déchets d’humanité ! Des larves et pas autre chose !
Nous sortîmes et visitâmes d’autres ateliers. Partout le même spectacle. Le directeur devina mon écœurement.
– Je sais, fit-il, ce n’est pas joli, joli. Nous y sommes habitués et nous n’y prêtons plus attention.
– Je plains surtout, dis-je, les malheureux innocents qui ont à souffrir d’une telle promiscuité.
– Nous y voilà! se moqua le fonctionnaire. Vous avez tous cette manie, dans la presse, de voir des innocents partout, et le public vous emboîte le pas. Allons, soyez juste et convenez que les erreurs judiciaires ne sont pas si fréquentes.
– N’y aurait-il qu’une seule erreur…
– Oui, interrompit vivement le directeur, nous sommes d’accord. On doit éviter les erreurs judiciaires. Elles sont abominables. A quelque degré de l’administration pénitentiaire que nous appartenions, nous nous efforçons toujours de comprendre la mentalité des forçats et de vérifier, si cela nous est possible, leur degré de culpabilité. C’est une question de conscience; et vous pouvez croire que nous sommes les premiers à signaler les hommes qui nous paraissent intéressants. Notre tâche est difficile, car nous nous trouvons en présence de maîtres dissimulateurs. Si vous les écoutiez, ils sont tous innocents. Bien rares ceux qui se vantent de leur crime, au moins devant nous. Tous, vous m’entendez, sont ici à tort. Dans de telles conditions, comment voulez-vous que nous sachions la vérité ? Le problème est plus compliqué que ne pense le public.
« Et puis, la grande coupable en la circonstance, excusez- moi, est la presse. Elle a fait revenir de Guyane des victimes d’erreurs judiciaires, en ayant soin de discréditer le système pénitentiaire. Le public, qui a l’habitude de généraliser, s’est mis dans la tête que le bagne est rempli de créatures toutes plus honnêtes les unes que les autres. Ces créatures, j’entends, sont les bagnards. Car nos gardiens se distinguent par leur férocité, leur absence de scrupules. Ah ! mon pauvre monsieur ! Si vous saviez combien notre personnel a du mérite !
– La presse n’en a jamais douté.
– Bien sûr! Mais on a tellement publié d’opinions péjoratives sur les prétendus mauvais traitements subis par les forçats, que ces derniers sont considérés par beaucoup de gens comme de petits saints. Vous venez de les voir, ces petits saints ! Dans ces salles où je viens de vous conduire, de lâches assassins ne pensent toute la journée qu’à leur arrivée en Guyane, ferre bénie d’où ils pourront s’évader afin de recommencer leurs actes de banditisme sous d’autres deux, ou même en France. Car, ne vous y trompez pas, ils ne songent qu’à ça : s’évader.7
– Avouez que ce sentiment est assez humain.
– Humain! Vous vous placez toujours au point de vue humanitaire. Je soutiens qu’il faut être juste avec les bagnards, mais se méfier d’un humanitarisme qui nous conduirait à une faiblesse périlleuse. Est-ce qu’ils ont été humains, ces misérables assassins, lorsqu’ils ont tué et parfois torturé leurs victimes ? Je ne fais d’exception que pour les criminels d’occasion qui ont tué sous l’empire de la colère ou de la passion. Ceux-là sont, jusqu’à un certain point, susceptibles de relèvement. Ils se repentent souvent très sincèrement et rêvent de refaire leur vie. Mais les autres! Ah! les autres! Si vous viviez comme nous au milieu d’eux, vous les connaîtriez mieux et vous auriez moins de pitié à leur égard.
Nous devisions ainsi en cheminant à petits pas dans la direction du corps de garde des surveillants. Je me serais gardé de mettre en doute ta bonne foi du directeur qui s’animait en me parlant et voulait me convaincre. J’avoue que ses paroles, en un tel lieu, m’émouvaient fortement. J’étais encore sous la déplorable impression que m’avaient causée ces êtres déchus, parqués dans cette antichambre du bagne.
– Patientez quelques instants, reprit le directeur en me faisant entrer dans le corps de garde. Jacques ne va pas tarder à arriver. Vous allez le voir, ce… grand ténor. Je vous laisserai avec lui. Mais le règlement est formel : deux surveillants assisteront à votre entretien.
Quelques minutes s’écoulèrent. Le directeur me frappa sur l’épaule et m’invita à regarder la cour. A travers les carreaux de la porte-fenêtre, je distinguai un homme de taille moyenne qui se dirigeait vers le corps de garde. Coiffé du droguet brun, comme tous les autres forçats, il avançait sans se presser, assez à l’aise dans le large vêtement sombre d’uniforme.
– C’est lui, déclara le directeur. II ne sait pas que vous êtes ici. Il va avoir une surprise.
En effet, Jacques, à peine arrivé dans le corps de garde, fut tout étonné quand il apprit mon identité. Il se ressaisit vite et me tendit une main moite de fièvre.
– Vous m’apportez de bonnes nouvelles ? me questionna-t-il tout de suite, et son regard exprimait de l’angoisse.
– Hélas! non, répondis-je. J’ai sollicité votre grâce et je crains bien qu’elle vous soit refusée. Vous partirez certainement par le prochain convoi.
– C’est injuste ! cria Jacques en se tournant vers le directeur qui se disposait à quitter la pièce. Et après ? On veut me faire revenir au bagne, alors que j’ai purgé ma peine ! La belle affaire ! Je ne reviendrai là-bas que pour m’évader à nouveau. Je sais maintenant comment il faut s’y prendre. On ne me gardera pas longtemps, vous verrez.
Le directeur s’était arrêté et fronçait les sourcils.
– Je vous en prie, intervins-je, je suis la cause de cet emportement Je ne voudrais pas que vous punissiez cet homme…
Le directeur me rassura par un sourire et s’éloigna. Je demeurai en tête-à-tête avec Jacques et… les deux surveillants, personnages muets.
Mon rédacteur occasionnel s’efforçait de rester calme. Il me posait des questions sur la publication de la première partie de ses mémoires que nous allions entreprendre prochainement. I1 s’anima lorsque je lui montrai un paquet d’épreuves que j’avais apportées. Il les examina hâtivement et voulut les conserver.
Je clignai de l’œil et lui fis comprendre qu’il valait mieux ne pas laisser ces épreuves en sa possession, car elles pouvaient être confisquées par l’autorité pénitentiaire et devenir une cause d’ennuis. Je vis qu’il avait du mal à se résigner.
Nous convînmes que sa rémunération serait adressée à Saint-Laurent-du-Maroni. Il me donna une adresse chez la supérieure d’un couvent dont il n’avait qu’à se louer et qui le protégeait.
Puis il me parla longuement de son existence à Saint- Martin-de-Ré. Il me révéla qu’on l’avait incorporé à un groupe de relégués et non pas à un groupe de condamnés aux travaux forcés.
II en souffrait beaucoup.
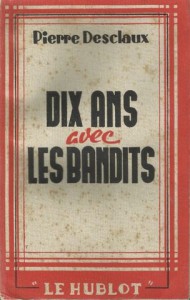 [1]Pour ceux de mes lecteurs qui ne seraient pas au courant, je vais fournir quelques précisions. Avant guerre, on envoyait au bagne deux catégories d’hommes : en premier lieu, ceux qui avaient été condamnés par les tribunaux aux travaux forcés, sauf les détenus trop malades et qui n’auraient pu supporter le voyage.
[1]Pour ceux de mes lecteurs qui ne seraient pas au courant, je vais fournir quelques précisions. Avant guerre, on envoyait au bagne deux catégories d’hommes : en premier lieu, ceux qui avaient été condamnés par les tribunaux aux travaux forcés, sauf les détenus trop malades et qui n’auraient pu supporter le voyage.
En second lieu, les hommes qui avaient atteint ou dépassé le nombre de condamnations prévu par la loi et qui étaient relégués. La condamnation à la relégation ne prévoit pas l’emprisonnement au bagne. Le relégué, une fois arrivé en Guyane, était simplement astreint à la résidence et soumis à des appels réguliers. Ces individus, qui avaient été assez habiles pour éviter des condamnations aux travaux forcés, constituaient vraiment une pègre affreuse, toute la lie de la société.
– Je ne comprends pas, se lamentait Jacques, pour quelle raison je me trouve ici en compagnie de relégués. Il paraît que ce serait régulier, en vertu d’un règlement qui m’assimile à un relégué puisque, lorsque je me suis évadé, j’avais purgé ma peine et vivais en Guyane comme libéré, astreint au doublage. Pourtant, je n’ai rien de commun avec un relégué, je me trouve maintenant en rupture de ban et je dois passer devant le conseil en arrivant à la colonie. Je serai sûrement condamné à une nouvelle peine de travaux forcés, un an ou deux au maximum. Tandis que les relégués qui sont ici en ont fini avec les tribunaux, à moins qu’ils ne commettent un délit quelconque là-bas. C’est une iniquité de me mettre en compagnie de ces arsouillés. Oui, des arsouilles ! Vous ne sauriez croire comme ces êtres sont ignobles. Je vous assure qu’il vaudrait mieux que je sois avec des voleurs et des assassins. Cela vous surprend, évidemment, de m’entendre m’exprimer de la sorte. Mais, si vous avez un doute quelconque sur la véracité de mes paroles, demandez aux surveillants. Vous verrez ce qu’ils en pensent
Je me tournai vers les surveillants qui souriaient, mais je vis qu’ils ne me donneraient pas leur opinion tant que Jacques serait là.
– Oui, reprit-il en haussant les épaules, c’est une infamie de m’imposer îa compagnie de ces gredins, je suis malheureux.
Jacques s’écria ensuite :
– Et puis, mieux vaut parler d’autre chose…
Il me demanda quelques renseignements sur Paris, m’entretint de sa famille. Il me confia ses projets, rêvant de se marier dès qu’il aurait été gracié, pour avoir enfin un foyer.
Les surveillants avaient repris leur immobilité, semblant se désintéresser de la conversation. Jacques faisait appel à toutes les ressources de son imagination pour se suggestionner, se figurer qu’il était dans la vie normale et qu’il s’entretenait libre, avec un ami, dans une demeure hospitalière. Nous eûmes vite épuisé tous les sujets. Il me surprit jetant un regard bref à mon bracelet-montre. Ses yeux eurent une lueur de mélancolie.
– Vous repartez aujourd’hui même pour Paris? s’enquit-il.
– Tout a l’heure.
– Je ne voudrais pas vous retarder. En somme, nous avons dit tout ce qui était utile. Je crois que nous pourrions nous séparer…
– Vous n’avez plus rien à me demander ? dis-je.
– Non. Ah ! vous savez… nous ne serions pas gênés de bavarder jusqu’à la nuit…
– Evidemment, mon pauvre garçon. Mais… mais..,
– Hélas ! Vous avez raison. Il est préférable d’en finir. Merci d’être venu. Cela m’a fait tant de bien. Je vais y penser longtemps. Je vous rendrai votre visite, bientôt peut- être, à Paris, dans votre bureau…
– Je vous le souhaite, Jacques. Soyez courageux.
Un surveillant s’avançait. Il barrait la route au prisonnier qui s’apprêtait à me suivre dans fa cour.
– Passez par là ! dit le fonctionnaire en ouvrant une- porte au forçat.
Jacques eut un sourire contraint, me serra la main longuement. 11 était moins fébrile qu’à l’arrivée. Je devinais cependant qu’une émotion l’étreignait Je représentais pour cet infortuné, la liberté qui était venue à lui. Pendant de longs instants, ne lui avais-je pas donné l’illusion qu’il ne résidait plus dans un bagne ? En ma compagnie, il venait d’oublier sa misère présente. Ne devais-je pas m’apitoyer sur son sort ? A peine entrevue, cette liberté que chaque homme chérit avec une si intransigeante affection, cette liberté s’évanouissait. Il devait retourner à l’atelier, à la geôle, il devait continuer à mener cette vie de refoulements perpétuels avec l’espoir, toujours si lointain, d’un avenir meilleur.
Immobile devant la porte restée ouverte, je regardais Jacques qui s’en allait sans se retourner avec une démarche qui voulait être indifférente et qui, par un certain balancement des épaules et un fléchissement des jambes, trahissait peut-être quelque accablement.
– Pauvre type ! dis-je.
– Oh ! il n’est pas méchant, déclara un des surveillants; il est simplement embêtant avec sa manie de fouiller dans les règlements pour nous prendre en défaut. Ils sont quelques-uns dans ce cas-là. Mais à lui le pompon. Un surveillant de Saint-Laurent-du-Maroni, de passage ici l’autre jour, nous racontait qu’on avait fini par le prendre en grippe à cause de cette habitude. Et puis, ce qui a achevé d’indisposer le personnel contre lui, c’est qu’il écrit. Il se vante de vous avoir vendu ses mémoires, alors qu’il se trouvait à l’étranger, après son évasion. Alors, vous devez bien vous rendre compte qu’il n’a pas dû ménager les fonctionnaires du bagne.
– Vous faites erreur, répliquai-je. J’ai lu ses mémoires, ils ne contiennent rien d’injurieux pour personne. D’ailleurs, vous pensez bien que, dans le propre intérêt de Jacques, nous ne laisserions passer quoi que ce soit de nature à lui nuire dans sa situation présente. S’il est gracié, plus tard, il aura probablement davantage son franc-parler. Est-il exact qu’il soit en compagnie de relégués en ce moment, et qu’il ait raison de se plaindre de ses compagnons de captivité ?
– Tout à fait exact. Le relégué est un être qui a traîné dans les prisons, qui connaît toutes les ficelles du vol et du crime. Nous-mêmes, préférons avoir affaire aux condamnés bagnards. Ils ont à tous points de vue une mentalité meilleure. Parmi eux, se trouvent des gens susceptibles de s’amender. Le relégué est incorrigible. Il est comme ces ivrognes invétérés qui s’adonneront toute leur vie à la boisson et qu’aucune remontrance n’améliore. Jacques est positivement malheureux avec les relégués. Ils se moquent de lui quand il leur raconte des histoires du bagne; ils croient en savoir plus long que lui sur la question. Tous se figurent qu’en Guyane ils mèneront une existence, de rêve et que, d’ailleurs, ils vont pouvoir s’évader facilement.
« Jacques, qui s’est enfui plusieurs fois et qui a failli périr au cours de sa dernière évasion, tente en vain de leur représenter les gros dangers de l’entreprise. Ils l’injurient, le traitent de rabâcheur. S’il était avec des forçats, il serait davantage écouté. »
Avant de quitter le quartier pénitentiaire, les surveillants me conduisirent dans la chambrée où Jacques passait la nuit. Chambrée de caserne, à cette différence près que ses croisées étaient garnies de grillage et d’épais barreaux. Une de ses parois, en partie grillagée et garnie également de barreaux, permettait aux gardiens de surveiller, la nuit, et d’entendre, s’il le fallait, les conversations.
Sur des bat-flanc, des paillasses et des couvertures soigneusement pliées. L’endroit était propre, mais il s’en exhalait une affreuse odeur de ménagerie, je ne m’attardai pas.
Au dehors, le directeur m’attendait.
– Eh bien, me dit-il, pas trop déçu par mon pensionnaire ?
– Non, répondis-je. Il est bien l’homme de ses écrits, je vous demande d’être aussi bienveillant qu’il vous sera possible à son égard.
– Je m’efforce d’être le même homme pour tous. Du moment qu’on se conduit bien, je n’ai pas à sévir. Je vous l’ai déjà dit : jusqu’à présent je n’ai pas eu à me plaindre de Jacques. J’espère que cela continuera.
Jacques m’avait déclaré : « je vous rendrai votre visite, bientôt peut-être, à Paris, dans votre bureau… »
Je ne devais plus le revoir.
Ainsi qu’il l’avait promis devant le directeur du bagne de Saint-Martin-de-Ré, Jacques s’évada peu de temps après son arrivée en Guyane, et il passa en Colombie, je crois. Au préalable, il m’avait expédié deux caisses remplies de collections de papillons et objets divers que je devais distribuer à certaines personnalités et vendre.
J’eus beaucoup de mal, d’ailleurs, à me débarrasser du contenu de ces caisses. Je réussis à vendre des papillons à quelques amis et rédacteurs de mon journal. Francis Carco[2] [3], à qui Jacques avait fait cadeau d’une collection de papillons, en acheta une autre. La grande artiste Ida Rubinstein[3] [4], qui s’était intéressée au bagnard, fut très touchée de constater que Jacques, reconnaissant, lui adressait un souvenir. Je pense qu’elle n’abandonna pas l’infortuné et qu’elle resta en correspondance avec lui.
Bref, chacun y mettant du sien, je pus faire parvenir à Jacques une somme qui dut lui être utile pour vivre dans le pays où il se trouvait, car, d’après ce qu’il m’écrivit, les autorités locales ne se montraient pas particulièrement indulgentes à son égard, et le menaçaient d’expulsion.
A cette époque, je crois me souvenir que Jacques m’adressa de nouveaux manuscrits qui constituaient la deuxième partie de ses mémoires. Ils étaient « illustrés », ces mémoires, par des croquis de l’auteur ou d’un de ses amis, je ne me souviens plus très bien. Ces croquis donnaient une idée pittoresque du pays où se déroulaient les événements dont parlait l’auteur. Ils étaient exécutés au crayon de couleur et à la mine de plomb. L’artiste n’avait disposé que de ce matériel peu compliqué pour effectuer ses œuvres. Le résultat se montrait assez satisfaisant et méritait d’être reproduit sans retouches.
Malheureusement, mes éditeurs ne voulurent pas tenter l’aventure. La crise de la librairie, qui précéda la grande guerre, commençait déjà. Je fis savoir à Jacques que son œuvre ne pouvait nous intéresser. Il me pria alors de communiquer le manuscrit à Francis Carco qui, disait-il, était averti, je m’empressai de lui donner satisfaction.
Je n’ai pas revu, depuis, l’auteur de Jésus la Caille, et j’ignore ce qu’il est advenu de cet énorme manuscrit bourré d’anecdotes et aussi de documents sur l’administration pénitentiaire. Il y a tout lieu de croire que cette œuvre est encore inédite ; soit qu’elle ait été gardée par l’ami Carco « en attente » de jours meilleurs, soit qu’elle dorme dans un carton, chez un éditeur.
En tout cas, j’ai appris que Jacques avait réussi à passer aux Etats-Unis où la presse lui consacre de longs articles. Le libéré en rupture de ban fit parler de lui. Il critiquait notre régime pénitentiaire avec l’appui moral de la presse américaine.
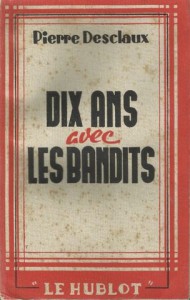 [1]C’est alors qu’un livre de lui parut à New-York[4] [5]. Sans doute était-il composé des mêmes éléments que le manuscrit « illustré » ? Ce livre, traduit en anglais, obtint du succès, si j’en juge d’après les articles américains que j’ai pu lire.
[1]C’est alors qu’un livre de lui parut à New-York[4] [5]. Sans doute était-il composé des mêmes éléments que le manuscrit « illustré » ? Ce livre, traduit en anglais, obtint du succès, si j’en juge d’après les articles américains que j’ai pu lire.
Je sus que le gouvernement américain voulait expulser mon ex-collaborateur occasionnel. Le garçon se remua et obtint un assez long sursis, je reçus une lettre de lui dans laquelle il se lamentait de ne pas être gracié par le gouvernement français. Il ne rêvait qu’à un retour définitif dans la mère patrie. Il formait des projets, désirant, plus que jamais, se marier chez nous et fonder une famille.
Puis, ce fut le silence. Et j’appris que l’administration pénitentiaire américaine, estimant la « haute compétence » de Jacques, l’avait admis comme membre d’une sorte de comité de perfectionnement des maisons de détention auquel appartenaient des personnalités yankes s’occupant de fa réforme des bagnes.
C’est par un journal américain que j’ai eu ces détails, et j’ignore jusqu’à quel point il faut les considérer comme rigoureusement exacts. Toujours est-il que Jacques ne m’a plus donné de ses nouvelles. Je me demande s’il ne s’est pas engagé dans l’armée américaine, de façon à venir combattre sur notre sol, pour tout effacer.
De ce geste, Jacques était capable.
[1] [6] Est-ce Jean Normand, alias Raoul Lematte, ami de Jacob, et auteur des Mystères du bagne ?
[2] [7] 1886-1958, Francis Carco est l’auteur notamment de Jésus la Caille en 1914 ou encore de L’homme traqué en 1922.
[3] [8] 1885-1960, danseuse d’origine russe, Ida Rubinstein fit ses débuts en 1909 avec un rôle dans le Salomé d’Oscar Wilde, se déshabillant complètement lors de la Danse des sept voiles. Véritable icône parisienne de la Belle Époque, elle fut célébrée dans tous las arts.
[4] [9] S’agit-il de René Belbenoit dont le livre est publié chez Dutton à New york en 1938 ? Dans ce cas, l’anecdote narrée par Pierre Desclaux se situerait en 1933, date à laquelle René Belbenoit se trouve à Saint Martin de Ré en compagnie d’un certain Henry Charrière !