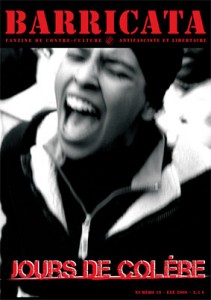[1]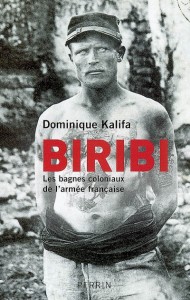 [2]L’imaginaire collectif se construit sur le mode binaire. Binaire et le plus fréquemment manichéen. Le bien et le mal s’incarnent de la sorte au travers de personnages historiques devenu mythiques. Il est également des lieux qui peuvent susciter les uns le rêve chimérique d’une vie meilleure, les autres, à l’opposé, le trouble, l’angoisse et l’inquiétude, et qui éveillent finalement l’effroi. Institutionnalisés ces espaces constituent une espèce de ciment social engendrés par l’effet de peur. De fait, si le paradis terrestre peut se trouver dans quelques vertes contrées, l’enfer existe bel et bien ici bas dans sa vocation d’éloignement et d’élimination des mauvais sujets sociaux.
[2]L’imaginaire collectif se construit sur le mode binaire. Binaire et le plus fréquemment manichéen. Le bien et le mal s’incarnent de la sorte au travers de personnages historiques devenu mythiques. Il est également des lieux qui peuvent susciter les uns le rêve chimérique d’une vie meilleure, les autres, à l’opposé, le trouble, l’angoisse et l’inquiétude, et qui éveillent finalement l’effroi. Institutionnalisés ces espaces constituent une espèce de ciment social engendrés par l’effet de peur. De fait, si le paradis terrestre peut se trouver dans quelques vertes contrées, l’enfer existe bel et bien ici bas dans sa vocation d’éloignement et d’élimination des mauvais sujets sociaux.
« A vue d’œil, c’est ravissant » écrit Albert Londres à propos des îles du Salut en 1923 « Décor pour femmes élégantes et leurs ombrelles ! Les îles sont la terreur des forçats ». Cette problématique se retrouve aisément dans celle des bagnes militaires français d’Afrique. Le soleil. La chaleur. Le Travail. Les coups. La crapaudine. La mort. Le sable et les cailloux pour seuls horizons. Biribi. La seule évocation de ce nom suffisait à faire trembler il y a peu encore. Biribi ? « C’est en Afrique » chantait Aristide Bruant. Le flou de la localisation accroît d’autant la crainte d’un envoi dans les bataillons disciplinaires. Mais la mémoire a effacé le souvenir de ces centaines de milliers d’hommes punis envoyés quelque part en Afrique, au Sahara, pendant plus de cent cinquante ans pour honorer leurs obligations militaires.
Dominique Kalifa, professeur à la Sorbonne, nous restitue dans son dernier livre l’histoire de ces réprouvés des XIXe et XXe siècles. Et c’est bien la monstruosité légale et carcérale qui s’ensuit. De Barricata au Figaro, en passant par le Monde et Télérama, nous n’avons guère trouvé de critiques négatives d’un ouvrage qui ne peut que faire date dans l’étude de ce que l’auteur qualifie lui-même de non lieu de la recherche historique.
 [3]Car rares ont été les écrits sur la question. Quelques journalistes bien sûr (Jacques Dhur, Albert Londres), quelques médecins (Lacassagne), un chanteur (Bruant) et un écrivain (Georges Hyppolite Adrien dit Darien) ont certes alerté l’opinion publique ou consigné leur impression de ces endroits dans leurs souvenirs ou dans leur roman. Il est vrai que la très glorieuse et néanmoins Grande Muette n’avait aucun intérêt à dévoiler les pratiques orchestrées dans les rangs de ses bat’ d’Af’, dans les geôles de ses ateliers de travaux publics. Silence, on tue. Silence, oubli obligatoire.
[3]Car rares ont été les écrits sur la question. Quelques journalistes bien sûr (Jacques Dhur, Albert Londres), quelques médecins (Lacassagne), un chanteur (Bruant) et un écrivain (Georges Hyppolite Adrien dit Darien) ont certes alerté l’opinion publique ou consigné leur impression de ces endroits dans leurs souvenirs ou dans leur roman. Il est vrai que la très glorieuse et néanmoins Grande Muette n’avait aucun intérêt à dévoiler les pratiques orchestrées dans les rangs de ses bat’ d’Af’, dans les geôles de ses ateliers de travaux publics. Silence, on tue. Silence, oubli obligatoire.
Les sources, aussi rares soient-elles, existent pourtant. Elles se logent parfois dans la peau même des mauvais garçons. Dominique Kalifa les fait parler et de bien belle manière. Après avoir exploré la légende noire de Biribi, l’historien offre à ses lecteurs le descriptif d’une organisation totalitaire implacable dont tout le monde (ou presque) cherche à effacer les traces quand on revient de là-bas. S’ensuit alors l’histoire dans ses plus intimes confinements de ces vies brisées par les coups, la chaleur du Sahara, l’arbitraire et la vindicte sociale et militaire. A Biribi comme à Cayenne, l’innommable répression peut prendre forme dans son horreur quotidienne. Et, pour le moblot récalcitrant, pour l’apache, pour le politique estimé dangereux, elle a duré jusqu’en 1972 !
La presse n’a pas manqué de souligner l’excellence du livre de Dominique Kalifa. Nous remarquerons juste la comparaison douteuse et malvenue de la part de l’historien Jean-Pierre Rioux qui, en louangeant l’entreprise de son confrère, minimise par force de comparaison le système éliminatoire et civil de la Guyane dans les colonnes du Figaro. Or, il convient de rappeler que si beaucoup sont revenus de Birbi, entre 1830 et 1972, ce ne fut guère le cas, de 1854 à 1938, pour les fagots de la colonie pénitentiaire d’Amérique du Sud. Pénitentiaire avec un « t » même si le nom commun prend un « c », ce que semble ignorer l’article du Monde en date du 24 avril 2009. Mais ce ne sont là que peccadilles qui nous ferait presque oublier le prix légèrement plus élevé annoncé par Alternative Libertaire qui coupe de deux pages le livre de Dominique Kalifa.
23 avril 2009
Jean-Pierre Rioux
Pas de pitié pour les soldats réfractaires
Dominique Kalifa est le premier à lever le voile sur les terribles établissements pénitentiaires d’Afrique du Nord où 700 000 militaires indisciplinés de l’armée française furent envoyés.
«Biribi» est le nom imaginaire de l’archipel pénitentiaire de l’armée française. Il a été connu des civils et des politiques grâce à deux cris alarmés : celui d’un des très rares condamnés qui aient parlé après leur sortie, Georges Darien, dans son Biribi de 1890, et celui d’un journaliste célèbre, Albert Londres, dans Dante n’avait rien vu, en 1924. De 1818, date de création des « fusiliers et pionniers de discipline » par Gouvion-Saint-Cyr, à la lente extinction des « corps spéciaux » après 1920, ce furent 1 à 2 % des militaires qui ont subi violences et turpitudes dans les compagnies disciplinaires regroupées en Afrique du Nord : 7 500 hommes sous le second Empire, plus de 13 000 au temps de Darien et 5 000 en 1925 ; soit, au total, en cent trente ans, de la prise d’Alger à la fin de la guerre d’Algérie, de 600 000 à 800 000 délinquants-victimes, de six à huit fois plus qu’au bagne civil.
Dans les pénitenciers, les sections « d’exclus » (condamnés dans le civil, incorporés et passibles de double peine) et surtout chez les « Bat’ d’Af’ », ces « corps d’épreuve » où étaient tenus en laisse tous ceux qui auraient pu contaminer les unités régulières, les « gars qu’ont pas eu d’veine » chantés par Bruant ont subi le « marche ou crève » et les pires sévices, « de Gabès à Tatahouine, de Gafsa à Médinine ».
Féroce et indigne
Avant Dominique Kalifa, nul n’avait examiné à fond cette zone de non-droit où des sous-offs indignes orchestrèrent les basses besognes et laissèrent proliférer le vice et le crime. Preuves en main, toutes archives consultées, il montre que l’épreuve fut longue, massive, extrême ; qu’elle vulgarisa sous l’uniforme, outre le travail forcé sous soleil de plomb dans le désert et la rocaille, l’usage de la violence, du viol, du règlement de comptes : une barbarie qui n’amenda personne.
Chez les bagnards, « nature vicieuse et tout à fait incorrigible » aux yeux de l’autorité militaire, chez les « hommes » et les « durs » survivants, une bonne moitié étaient dégénérés ou demi-fous, l’homosexualité galopait, les poings et le sexe tenaient lieu de langage, les supplices et le crime au quotidien avaient force de loi : ce fut féroce et indigne de la patrie des droits de l’homme.
L’armée fit ainsi de l’Afrique du Nord un cachot, laissa répandre dans l’opinion de métropole une image viciée de la colonisation, légitima un peu plus les violences qui assaillaient le « bled ». Oui, l’armée, l’Afrique, la République ont été environnées longtemps, là-bas, à Biribi, du cliquetis des fers et des cris de haine et de détresse. Jamais avant Kalifa cela n’avait été dit, preuves en main, avec autant de force.
Biribi Les bagnes coloniaux de l’armée française de Dominique Kalifa Perrin, 344 p., 21 €.
Vendredi 24 avril 2009
Dans l’enfer de « Biribi »
Dominique Kalifa revient sur le terrible univers des bagnes et pénitentiers coloniaux
Biribi », « Tataouine », « les bat’ d’Af’»… Autant de mots qui évoquent l’inquiétante atmosphère de bagnes lointains, de soldats punis que l’on imagine travaillant écrasés sous le soleil d’Afrique, soumis aux violences des sous-offs, empreints de la dureté des rapports entre apaches. L’ouvrage de Dominique Kalifa ne dément pas les images que charrient les bagnes et pénitenciers militaires coloniaux. Mais il les précise et, surtout, il en donne une histoire minutieuse, documentée.
Il fallait d’abord s’y retrouver dans le maquis de cet « archipel pénitentiaire » que l’on désigne sous le terme générique de « Biribi » (à l’origine un jeu de hasard) rendu populaire par le roman du même nom signé Georges Darien (1890). Il y a d’abord les fortes têtes de l’armée que l’on envoie dans les compagnies disciplinaires. Il y a aussi ceux qui, après être passés devant un conseil de guerre pour désertion, vol, outrage ou autres, sont expédiés dans un établissement de répression comme les ateliers de travaux publics. Il y a encore les « exclus », ces hommes condamnés aux assises, que l’on ne peut incorporer dans les régiments ordinaires. Et puis, les fameux « Bat’ d’Af’ » (bataillons d’Afrique) qui accueillent en particulier des soldats libérés de « Biribi ».
Chacune des ces expérience est déjà une véritable épreuve en soi. Mais nombreux sont ceux qui les multiplient, comme en témoigne en 1912 le médecin Louis Combes, peu amène pour les condamnés :
« C’est souvent le même homme qui, de 25 à 40 ans, tour à tour chasseur léger, se promène d’un corps à l’autre, du bataillon au pénitencier, du pénitencier à la section de discipline, de la section au bataillon d’Afrique (…), changeant d’univers, non de caractère, de casernement, non de milieu ».
Il est vrai que « Biribi » compose une « immense armée de punis ». Entre 600000 et 800000 hommes de 1830 à la fin des années 1960, 1% à 2% de l’armée française selon les époques. Cette « armée » rassemble surtout des éléments des classes populaires urbaines, souvent les moins intégrées, mais aussi certains condamnés politiques, communards ou anarchistes par exemple, ou encore le marin rebelle de 1919, futur dirigeant communiste et chef de la Résistance, Charles Tillon, qui évitera de devenir « cinglé » en y tenant son carnet, précieux confident. Plus ordinairement, « Biribi » des durs à cuire comme Jean R., garde républicain qui boit au cabaret l’argent emprunté à ses copains, abusant de son statut pour soutirer des sous aux dames qu’il séduit. En 1876, le voilà finalement dirigé vers les compagnies disciplinaires. Le choix de l’Afrique tient notamment à un des objectifs de la répression : « purger » l’armée de ses « mauvais éléments », homosexuels compris, voire de les éliminer.
Violence et humiliation
L’univers qui y attend les condamnés est terrifiant. Un quotidien de violence et d’humiliation : interdiction de porter librement barbe ou moustache, contrôle du courrier, brimades physiques … « On tapait sur nous comme sur des ânes. Le bruit de la trique sur le corps des hommes devenait un bruit ordinaire », rapporte un détenu. Les dénonciation de cet « enfer » n’ont pas manqué, des campagnes antimilitaristes d’avant 1914 au souci technocratique de réforme en passant par les reportages – en particulier celui d’Albert Londres, paru en volume en 1924 sous le titre Dante n’avait rien vu.
Les détenus eux-mêmes ne se sont pas toujours laissés faire comme le montre la multiplication des formes de résistance, individuelles ou collectives. Théoriquement interdit, le tatouage – « la grande affaire de Biribi » – en est un aspect, tel ce « vaincu mais non dompté » … En 1930 c’est la section spéciale d’Oléron qui entre en rébellion, excitée par « quelques meneurs » – selon l’interprétation officielle habituelle des mutineries – et dirigée par le « caïd ». Les drapeaux rouges se déploient, les entonnent l’Internationale avant que la faim, apparemment, ne permettent de réduire la révolte. Les réformes seront nombreuses, plus ou moins bénéfiques aux condamnés, notamment après la grande Guerre, qui avait autorisé de multiples abus de la justice militaire. Mais « Biribi » perdure jusqu’à la décolonisation même si son déclin est entamé dès les années 1930.
Cette histoire longue n’ »avait jamais été faite. « Biribi » était resté « un non-lieu de recherches » avant le travail de Dominique Kalifa. Celui-ci pose les cadres permettant d’ouvrir de nouveaux chantiers. Car, pour l’historien d’aujourd’hui, attentif à la construction des sources et soucieux de ne pas s’enfermer dans les discours publics tenus sur un sujet, la saisie de l’expérience disciplinaire demeure difficile : la parole des détenus est souvent absente, écrasée par celle des rapports officiels, des médecins ou des publicistes. Pour reconstituer ces histoires de vie, il faut surmonter à la fois le silence voulu par les autorités et le mutisme redoublé des hommes punis : se taire pour survivre à « Biribi » et ensuite oublier.
Nicolas Offenstadt.
n° 3093
25 avril 2009
Biribi les bagnes coloniaux de l’armée française
Ed. Perrin, 344p., 21€
Biribi, c’est l’enfer. Pourtant, Biribi n’est pas un lieu précis, il désigne une constellation de prisons, bataillons disciplinaires et autres bagnes où les autorités militaires, depuis 1818 jusqu’au seuil des années 1970, ont expédié les « indisciplinés », les « fortes têtes » ou les « mauvais sujets ». Dominique Kalifa plonge dans les bas-fonds de cet univers carcéral et redonne la parole aux chansonniers, journalistes et romanciers qui ont su alerter l’opinion publique sur ces mouroirs d’Afrique du Nord. Il rappelle aussi les épouvantables sévices infligés à ces soldats perdus. Si Georges Darien, Blaise Cendrars, Mac Orlan, Aristide Bruant ont dénoncé la violence insoupçonnée de ces prisons militaires, Albert Londres, lui, dans Dante n’avait rien vu, publié en 1924, est parvenu à provoquer, comme il l’avait fait pour le bagne de Cayenne, des débats parlementaires. Dépouillant les archives et relisant dans les témoignages de l’époque le quotidien des victimes, les brimades, la palette des sévices et tout l’imaginaire qui se déploie autour de Biribi, Dominique Kalifa signe un beau livre d’histoire et lève le voile sur ces milliers d’hommes expédiés au « pays perdu » d’Afrique.
Gilles Heuré
Juin 2009
N°343
Par Dominique Kalifa
Perrin, 2009, 344 p., 21 euros.
Albert Londres avait parlé du « monstre Biribi » dans Le Petit Parisien, en 1924, l’année qui avait suivi sa dénonciation du bagne de Cayenne, et Georges Darien, dans un roman éponyme, paru en 1890, avait popularisé ce nom étrange dont on ne savait pas exactement quel lieu il désignait.
Biribi ? A l’origine, une sorte de loto italien en faveur au début du XIXe siècle, un jeu gouverné par le hasard comme l’étaient, depuis la Restauration, les fortes têtes de l’armée française, humiliées et torturées dans des camps disciplinaires disséminés en Afrique du Nord surtout, à Madagascar aussi, au Sénégal et en Nouvelle-Calédonie. Biribi, c’était cet « archipel » pénitentiaire, ce lieu fantasmé d’un non-droit bien réel, et que Dominique Kalifa ressuscite ici pour la première fois.
La chanson, par le truchement de Bruant, s’est emparée de ces bas-fonds de la justice militaire, mais la cruauté des « chaouchs », les sous-officiers sadiques qui usaient des fers, du silo et de la crapaudine contre les mauvais garçons de la troupe jusqu’à les tuer, passe-t-elle par des rimes pour être prise au sérieux ? L’élégante écriture de l’auteur contribue en tout cas à nous renvoyer en pleine figure l’image grinçante d’une « Grande Muette » qui n’a renoncé qu’assez récemment – le dernier camp de Biribi, apprend-on, n’a fermé qu’en 1972 à Obock, sur le Territoire des Afars et des Issas, futur Djibouti – à une pratique aussi déshonorante.
Biribi, Perrin, 2009, 344 p., 21 euros.
N°186
Eté 2009
Kalifa, « Biribi, les bagnes coloniaux de l’armée française »
Il y a un siècle, pas un jeune Français n’ignorait ce qu’était Biribi, dont le nom seul suffisait à faire frissonner les plus durs. Des histoires terrifiantes circulaient sur les horreurs qui s’y commettaient, les sévices qu’on y infligeait : « le silo », la crapaudine, « les barres de justice ». Biribi, c’était le surnom donné à l’ensemble des structures disciplinaires et pénitentiaires de l’armée coloniale en Afrique du Nord. L’armée les avait baptisés « corps spéciaux » ; les antimilitaristes les appelaient des « bagnes militaires ». Les jeunes soldats qu’on y envoyait étaient des fortes têtes en tous genres : voyous, rebelles à la discipline ou militants condamnés pour propagande antimilitariste.
Des romans (Biribi, de Georges Darien, en 1890), des chansons (A Biribi, d’Aristide Bruant, en 1891), des reportages (Dante n’avait rien vu,d’Albert Londres, en 1924) ont largement nourri l’imaginaire autour de cet enfer. Au maximum de son extension, dans les années 1910-1914, entre 10.000 et 15.000 hommes y cassaient des cailloux sous un soleil de plomb. L’atmosphère qui y régnait était d’une violence extrême et la hiérarchie sociale entre détenus, fondée sur l’homosexualité systématisée, implacable.
La lutte pour l’abolition de Biribi fut à l’époque un des grands thèmes du mouvement anarchiste et syndicaliste, ainsi que de la Ligue des droits de l’homme. En février 1912, 120.000 personnes manifestèrent à Paris contre Biribi, en suivant le cercueil du jeune soldat Aernoult, assassiné par un « chaouch » (un sous-officier).
Le milieu du gangstérisme, dans les années 1920, fut en partie l’héritier d’une culture développée à Biribi : tatouages, hiérarchie stricte, règlements de comptes et amitiés viriles.
L’historien Dominique Kalifa livre, pour la première fois, une histoire politique, économique et culturelle de cet « archipel du goulag » à la française dont les derniers îlots, implantés à Djibouti, ne furent abolis que dans les années 1970.
Guillaume Davranche (AL Paris-Sud)
Dominique Kalifa, Biribi, les bagnes coloniaux de l’armée française, Perrin, 2009, 342 pages, 21 euros.
Publié le 2 juillet 2009 par Commission Journal (mensuel)
N°19
Eté 2009
Lire …
Dominique Kalifa
Biribi les bagnes coloniaux de l’armée française
Perrin, 2009, 21€
Biribi, un nom aujourd’hui oublié, fit trembler la jeunesse pendant plus d’un siècle. Biribi, c’était les compagnie disciplinaires et les bagne éparpillés en Afrique du Nord, cet « archipel punitif de l’armée française » où étaient envoyés les victimes de l’arbitraire militaire : paysans perdus, opposants politiques et apprentis pégriots formaient une « immense armée de punis » (600000 hommes en un siècle et demi). Avec la précision d’un universitaire et dans un style clair et fluide, Dominique Kalifa retrace la terrible survie des « mauvais garçons », des « pas de chances » et des « incorrigibles »dans les différents cercles de cet enfer militaire et carcéral : Bat’ d’Afs, compagnies de disciplines, sections spéciales de répressions, ateliers de travaux publics. Les lecteurs de Barricata devraient être particulièrement sensibles à deux bons passages : l’un est relatif à l’implication des libertaires dans la lutte contre l’injustice militaire lors de l’affaire Aernoult-Rouset, « le Dreyfus des ouvriers », et l’autre à la pratique du tatouage, « une protestation permanente, dressée en caractères indélébiles ».
DD.